
Maquettes Ferroviaires
et Collections


La 141P de Jouef, une nouveauté majeure de la période en 1975
 En 1973 Jouef est le premier producteur de jouet en France, son chiffre d’affaires atteint 9 milliards de francs. Avec ses chiffres, la firme attire les investisseurs. Elle est rachetée par la Générale Occidentale,
dépendant du milliardaire anglais Jimmy Goldsmith. Elle devient la société anonyme « le Jouet Français » associé à Heller (producteur de maquettes) et Solido (les voitures au 1/43ième). C’est l’époque des
gestionnaires et des économistes. C’est aussi en 1973 la crise économique liée au pétrole et le début du chômage en France. Après le départ de Georges Huard, la firme est dirigée par Léo Jahiel de 1972 à 1978.
C’est un homme issu de l’entreprise et qui a fondé la fameuse firme Heller, l’a vendu au Jouet Français et en prend la présidence. La période Jahiel sera la dernière période sereine de Jouef.
En 1973 Jouef est le premier producteur de jouet en France, son chiffre d’affaires atteint 9 milliards de francs. Avec ses chiffres, la firme attire les investisseurs. Elle est rachetée par la Générale Occidentale,
dépendant du milliardaire anglais Jimmy Goldsmith. Elle devient la société anonyme « le Jouet Français » associé à Heller (producteur de maquettes) et Solido (les voitures au 1/43ième). C’est l’époque des
gestionnaires et des économistes. C’est aussi en 1973 la crise économique liée au pétrole et le début du chômage en France. Après le départ de Georges Huard, la firme est dirigée par Léo Jahiel de 1972 à 1978.
C’est un homme issu de l’entreprise et qui a fondé la fameuse firme Heller, l’a vendu au Jouet Français et en prend la présidence. La période Jahiel sera la dernière période sereine de Jouef.
Le catalogue 1974 se caractérise par ses motifs de bandes rivetées colorées que l’on retrouve sur les nouveaux coffrets. Les nouveautés sont riches et pleines d’optimisme.
En matériel moteur il y a les BB 15000 et la BB 67407 qui sont d’un bon niveau de détail. Pour les voitures, 4 modèles de banlieue Romilly.
Au début des années 70, il y a un besoin de disposer d’une locomotive puissante sous caténaire 25Kv. Avec l’augmentation des tonnages et des vitesses, les BB 16000 sont à leurs limites. Il est tout d’abord
envisagé de recourir à une formule CC à l’image des CC 6500 pour le courant 1500V continu. Mais les progrès de l’électronique de puissance permettent d’envisager une formule BB pour les mêmes
performances. Les BB 15000 dérivent donc assez directement des CC 65000 et 21000 en version raccourcie. Elle appartient à la famille des « nez cassés » d’après le dessin de Paul Arzens. Construites à
65 exemplaires par Alsthom et MTE, elles sont livrées à partir de 1971, pour remplacer progressivement les BB 16000 sur les trains de prestige sur l’étoile Paris-Strasbourg-Metz- Reims-Mulhouse. Les BB
15000 se distinguent par leur unique pantographe. Elle dispose du freinage électrique par récupération d’énergie. C’est la première locomotive de la SNCF à utiliser les thyristors pour la commande de ses
moteurs à courant continu. Ce sont des locomotives reconnues pour leur fiabilité exemplaire à la SNCF. Les 5 premiers exemplaires arborent la livrée verte très sobre style CC 65000 Maurienne.
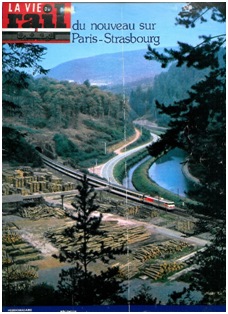
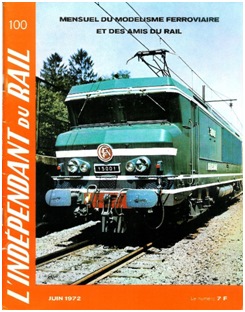 Les suivantes disposent de la belle livrée « Arzens » inox et rouge avec des filets orange. Ainsi elle peut s’assortir TEE de l’artère Est comme le Kléber Paris-Strasbourg ou le Stanislas Paris-Nancy. D’abord uniquement
affectées sur l’Est, les BB 15000 muteront avec l’arrivée du TGV vers l’ouest en arborant de nouvelles livrées comme celle du type « En voyage ».
Les suivantes disposent de la belle livrée « Arzens » inox et rouge avec des filets orange. Ainsi elle peut s’assortir TEE de l’artère Est comme le Kléber Paris-Strasbourg ou le Stanislas Paris-Nancy. D’abord uniquement
affectées sur l’Est, les BB 15000 muteront avec l’arrivée du TGV vers l’ouest en arborant de nouvelles livrées comme celle du type « En voyage ».
Les BB 15000 apparaissent dans l’est à partir de 1971. Ce sera durant une trentaine d’années la locomotive vedette sur Paris-Strasbourg.
 Les deux versions de la BB 15000, la 15005 de la première série en décoration verte et la 15006 en décoration « Arzens ». A noter que Jouef a gravé en relief les deux immatriculations
en relief.
Les deux versions de la BB 15000, la 15005 de la première série en décoration verte et la 15006 en décoration « Arzens ». A noter que Jouef a gravé en relief les deux immatriculations
en relief.
 Photo officielle de la première BB 15001 à sa sortie de l’usine Alsthom à Belfort au primptemps 1971. Les cinq premiers exemplaires reçoivent une livrée verte plutôt sobre au début
de leur vie (Photo Y. Broncard).
Photo officielle de la première BB 15001 à sa sortie de l’usine Alsthom à Belfort au primptemps 1971. Les cinq premiers exemplaires reçoivent une livrée verte plutôt sobre au début
de leur vie (Photo Y. Broncard).
 La livrée verte est plutôt destinée à la traction de voitures classiques comme ici les voitures inox.
La livrée verte est plutôt destinée à la traction de voitures classiques comme ici les voitures inox.
 A partir de la BB 15006, c’est la livrée « Arzens » inox et rouge à lisérés orange qui est adoptée. Beaucoup plus seyante elle est assortie aux récentes voitres grand confort. Ainsi il est
possible de composer des trains TEE sur la ligne Paris Strasbourg comme le Stanislas vu ici en mai 1973 (Photo Guy Rannou).
A partir de la BB 15006, c’est la livrée « Arzens » inox et rouge à lisérés orange qui est adoptée. Beaucoup plus seyante elle est assortie aux récentes voitres grand confort. Ainsi il est
possible de composer des trains TEE sur la ligne Paris Strasbourg comme le Stanislas vu ici en mai 1973 (Photo Guy Rannou).
 Il est ainsi possible avec du matériel Jouef de reproduire les TEE comme le Kléber ou le stanislas, les vedettes de la ligne Paris-Strasbourg (ici en version superdétaillée par Clarel,
montée sur un châssis Roco).
Il est ainsi possible avec du matériel Jouef de reproduire les TEE comme le Kléber ou le stanislas, les vedettes de la ligne Paris-Strasbourg (ici en version superdétaillée par Clarel,
montée sur un châssis Roco).
Les nouvelles locomotives sorties par Jouef en 1974, bénéficient d’un nouveau système de transmission par courroie en néoprène. Elle communique le mouvement du moteur 5 pôles a un axe longitudinal sur lequel sont calées deux vis sans fin qui attaquent un engrenage droit solidaire de chaque essieu. Ce dispositif est destiné à réduire sensiblement le bruit et éviter le cabrage des bogies. Ainsi équipé, les BB 15000 sont incomparablement plus silencieuses que les précédentes mécaniques. Mais la présence de vis sans fin rend la transmission irréversible et les arrêts sont courts en cas de coupure du courant. Il n’y a plus de châssis pour ces BB 15000, la caisse se présente comme une boite sans fond avec une toiture démontable fixée par deux vis Parker. Ce sont des modèles bien détaillés avec des mains courantes rapportées sur le nez de cabine et autour des portes. Disjoncteur, isolateur et klaxon sont rapportés sur la toiture. La décoration des deux versions est très soignée. Comme la BB 15000 de Jouef sera la seule reproduite dans ses versions d’origine, le détaillant Clarel en proposera plusieurs versions super-détaillées, équipées de pantographes Carmina. Certaines seront même équipées du châssis de BB 15000 de Roco.
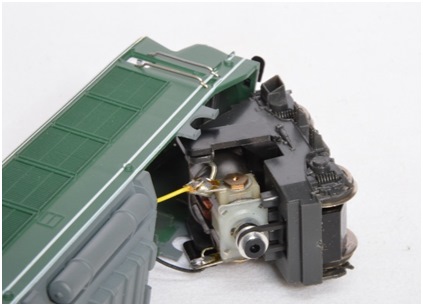
Nouveau type de transmission par courroie pour gagner en silence de fonctionnement.
 Pas de châssis pour les BB 15000, mais une boite qui s’ouvre par le toit.
Pas de châssis pour les BB 15000, mais une boite qui s’ouvre par le toit.
 Les BB 15000 seront aussi reproduites par Märklin (à gauche). Jouef sera la seule marque à proposer la BB 15000 de la première série dotée d’une petite cabine et de persiennes
latérales en polyester d’origine. Plus tard, toutes les BB 15000 seront dotées de persiennes inox comme les modèles Märklin. La version décoration « Arzens » s’assortit à merveille avec les voitures grand
confort.
Les BB 15000 seront aussi reproduites par Märklin (à gauche). Jouef sera la seule marque à proposer la BB 15000 de la première série dotée d’une petite cabine et de persiennes
latérales en polyester d’origine. Plus tard, toutes les BB 15000 seront dotées de persiennes inox comme les modèles Märklin. La version décoration « Arzens » s’assortit à merveille avec les voitures grand
confort.
 La 1524 s’attaque à la traversée des Vosges en utilisant les nombreux tunnels entre Saverne et Réding-Sarrebourg. Nous sommes en juillet 1994 et elle est en tête de voiture Corail
(Photo J.Bertsch)
La 1524 s’attaque à la traversée des Vosges en utilisant les nombreux tunnels entre Saverne et Réding-Sarrebourg. Nous sommes en juillet 1994 et elle est en tête de voiture Corail
(Photo J.Bertsch)
Les BB 15000 marquent un tournant à la SNCF dans l’emploi des composants d’électronique de puissance ou autour des moteurs de traction. En courant alternatif il y a la manière de le redresser pour en faire du courant continu. Jusque là la SNCF a utilisé différents moyens depuis les années 50 : L’ignitron avec les BB 12000, 16000 et 16500. L’Exicitron qui permettais déjà le freinage par récupération d’énergie en renvoyant le courant vers la caténaire. Vinrent ensuite les semi-conducteurs avec les diodes de puissance utilisées pour les BB 25100 et 25500. Avec la 15000 apparait le thyristor, extrapolé des diodes, permettant d’obtenir une tension redressée de valeur variable en retardant plus ou moins l’instant d’amorçage par rapport au passage du zéro de tension grâce à une électrode de commande dénommée « gâchette ». Ainsi le freinage par récupération redevient possible, alors qu’il ne l’était plus avec des diodes de puissance. L’emploi massif de thyristors dans les circuits de puissance des locomotives à partir des années 70 sera à l’origine des qualités exceptionnelles des machines modernes, dont les BB 15000. Pour ce qui concerne les engins de traction en courant continu, la BB 15007 aura un sort particulier. En 1973 elle est transformée en prototype BB 7003 pour réaliser des essais sous 1500V jusqu’en 1984 pour la mise au point des futures BB 7200 (mono-courant) et 22200 (bi-courants) dont 200 exemplaires seront commandés par la SNCF. A nouveau cette locomotive est innovante ; les contacteurs ont cédé la place à un « hacheur de courant » constitué de bancs de thyristors permettant de régler la vitesse du moteur par un découpage de la tension sous courant continu. La locomotive, ainsi transformée par les ateliers d’Hellemmes, se voit doté, en plus de cet équipement, de deux pantographes unijambistes pour courant continu, tout en conservant sa décoration Arzens d’origine. Ce prototype sera engagé pour de multiples essais sur la région Sud-Est et Sud-Ouest. Elle sera ensuite à nouveau transformée en BB 10003 en 1984 pour tester les moteurs Asynchrones, puis enfin en 1998, elle retrouvera sa configuration d’origine de BB 15007. Elle aura donc eu un destin très particulier.
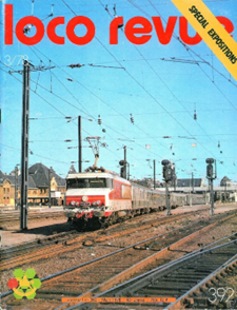
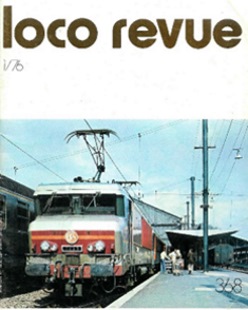
 Les couvertures de Loco Revue racontent l’histoire de la filiation des BB 15000, à gauche l’express Dunkerque- Milan quitte la gare de Metz. Au milieu, le prototype BB 7003 dérivé
de la 15007 au départ pour Bordeaux à Paris Austerlitz en 1975. Et à droite en 1978, la BB 7221 au départ de Paris-Lyon. Cette série est dérivée du prototype BB 7003.
Les couvertures de Loco Revue racontent l’histoire de la filiation des BB 15000, à gauche l’express Dunkerque- Milan quitte la gare de Metz. Au milieu, le prototype BB 7003 dérivé
de la 15007 au départ pour Bordeaux à Paris Austerlitz en 1975. Et à droite en 1978, la BB 7221 au départ de Paris-Lyon. Cette série est dérivée du prototype BB 7003.
La SNCF a toujours rêvé d’une locomotive universelle, capable, sans changement de démultiplication, d’entrainer un rapide à 200km/h ou de démarrer un train de marchandise de 2000t en rampe de 11/1000. Une voie est ouverte avec le développement de moteurs triphasés à thyristors. En 1981, la BB 15055 est équipées de moteurs synchrones pour tester cette nouvelle chaîne de traction. Elle est renumérotée BB 10004 et dotées d’une décoration Arzens, mais à dominante bleu roi. Ils sont autopilotés avec deux onduleurs et deux hacheurs pour faire varier la tension à leurs bornes. Ainsi la commutation est améliorée tout en étant capable de supporter de fortes intensités. Cette technologie sera utilisée sur les 234 BB26000 appelées Sybic et sur le TGV Atlantique avant d’être détrôné par la technologie des moteurs asynchrones au début des années 2000. Après les BB 15000, Jouef reproduira la BB 22200 en 1984, et la Sybic BB 26000 dans différentes versions à partir de 1991. Les prototypes BB 7003 et BB 10004 ne seront pas choisis par la firme de Champagnole, mais Lima, Roco, Märklin saisiront l’opportunité de reproduire cette dernière.
 La caisse de la BB 15000 Jouef sert de base au détaillant parisien Clarel pour une version superdétaillée à droite et pour une reproduction du prototype BB 7003 au premier plan. Ces derniers sont montés sur des
châssis Roco.
La caisse de la BB 15000 Jouef sert de base au détaillant parisien Clarel pour une version superdétaillée à droite et pour une reproduction du prototype BB 7003 au premier plan. Ces derniers sont montés sur des
châssis Roco.
 Le prototype BB 10004 construit sur la base de la BB 15055 est vu ici à Thionville en 1984 lors des essais. Elle est dotée de moteurs synchrones autopilotés (Photo 0. Constant).
Le prototype BB 10004 construit sur la base de la BB 15055 est vu ici à Thionville en 1984 lors des essais. Elle est dotée de moteurs synchrones autopilotés (Photo 0. Constant).
 La famille issue des BB 15000 avec la BB 7003 Clarel au premier plan, et les BB 15000, 7200, 10004 et 26000 de Märklin au fond.
La famille issue des BB 15000 avec la BB 7003 Clarel au premier plan, et les BB 15000, 7200, 10004 et 26000 de Märklin au fond.
En 1974 Jouef propose quatre types de voitures de banlieue Est modernisées dite Romilly. Cette série provient de la transformation des voitures TY construites de 1907 à 1923 pour la compagnie de l’Est. Le nom provient de l’atelier SNCF de Romilly sur Seine qui a réalisé une partie des transformations. Les voitures Ty possédaient une caisse en bois tôlée. Un prototype est réalisé en 1950, mais c’est à partir de 1957 que la transformation est engagée. Les voitures, entièrement métalliques possèdent deux doubles portes battantes sur chaque face. Leur vitesse était limitée à 120km/h. Elles sont déclinées en plusieurs versions ; 1ière classe, mixte 1ière/2Ième, 2ième classe et mixte fourgon. Au total ce sont 676 exemplaires qui sont transformés jusqu’en 1962. Affectées aux dessertes locales et régionales sur presque toutes les régions de la SNCF, elles sont retirées du service entre 1978 et 1985.
 Les belles voitures banlieue Est de Jouef sont dotées de rambardes rapportées et d’une belle décoration.
Les belles voitures banlieue Est de Jouef sont dotées de rambardes rapportées et d’une belle décoration.
Les 4 versions sont déclinées par Jouef, à l’échelle, correctement détaillées, et munies de rambardes rapportées en 1975. Jouef utilise sa nouvelle technique d’assemblage sans vis, avec le toit monobloc avec le vitrage. Le démontage est particulièrement délicat, et comme il n’y a pas d’aménagement intérieur ni de lest, ceci pose problème aux amateurs de l’époque. Néanmoins ce sont de très belles voitures, avec une belle décoration et des rambardes rapportées.

Le catalogue 1975 Jouef illustre les 4 versions des voitures Romilly proposées.
 Les voitures Romilly de Jouef sorties en 1974 assure une desserte régionale en campagne.
Les voitures Romilly de Jouef sorties en 1974 assure une desserte régionale en campagne.
 Les voitures Romilly de 4 types différents avaient été commercialisées par MMRG au tout début des années 70. Celles de Jouef sont bien plus démocratiques côté prix. Comparatif
entre les deux productions, les MMRG au premier plan et les modèles de Jouef à l’arrière-plan.
Les voitures Romilly de 4 types différents avaient été commercialisées par MMRG au tout début des années 70. Celles de Jouef sont bien plus démocratiques côté prix. Comparatif
entre les deux productions, les MMRG au premier plan et les modèles de Jouef à l’arrière-plan.

Pour éliminer définitivement la vapeur des lignes de la SNCF, il faut un nombre important de diesel. Après les séries de BB 67000 et 67200 (reproduite par Jouef dès 1964), ce sont les BB 67400 qui sont mises en service en 1969. D’une puissance intermédiaire de 2000cv, elles assurent le service voyageur et fret, souvent en unités multiples. Avec leur soute à combustible de 3400l elles ont une autonomie proche du millier de kilomètre. Ces locomotives complètent les grands axes électrifiés. Il y aura 229 exemplaires fabriqués jusqu’en 1975, affectés sur toutes les régions de France. Jouef interprète la BB 67400 brillamment en s’engageant sérieusement vers le modélisme de qualité à prix compétitifs. Le principe de construction est rigoureusement identique aux BB 15000, avec une caisse évidée et une toiture rapportée. Les bogies sont les même que la BB 15000, ce qui n’est pas tout à fait juste, même s’il y a une forte ressemblance. La gravure du toit est très fine, et les teintes restituent parfaitement le modèle réel.
 En comparant la BB 67001 de 1964 (à l’arrière-plan) et la BB 67407 de 1974 on mesure tout le chemin parcouru par Jouef en une décennie. Les BB 67400 sont équipées de chauffage électrique pour les voitures
voyageur. Mais lorsque les voitures n’en sont pas équipées, il faut toujours intercaler un fourgon chaudière.
En comparant la BB 67001 de 1964 (à l’arrière-plan) et la BB 67407 de 1974 on mesure tout le chemin parcouru par Jouef en une décennie. Les BB 67400 sont équipées de chauffage électrique pour les voitures
voyageur. Mais lorsque les voitures n’en sont pas équipées, il faut toujours intercaler un fourgon chaudière.
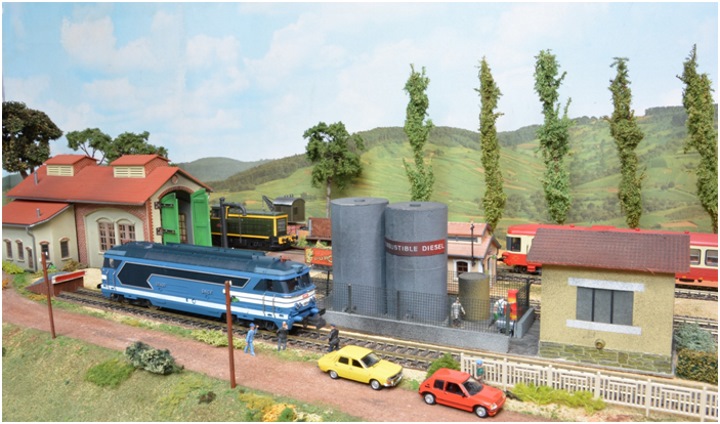 En pleine crise du pétrole après 1973, la traction diesel devient plus onéreuse. La réserve de gas-oil est un modèle de l’artisan Paul Soulleys. Il faut 3400l pour faire le plein qui assure
une autonomie de 1000km.
En pleine crise du pétrole après 1973, la traction diesel devient plus onéreuse. La réserve de gas-oil est un modèle de l’artisan Paul Soulleys. Il faut 3400l pour faire le plein qui assure
une autonomie de 1000km.
 Dans les années 80, la France mise sur l’énergie nucléaire pour son indépendance énergétique. Le transport du combustible usé vers les centres de recyclage est assuré par la SNCF
dans des wagons spéciaux. Ici la BB 67400 assure la traction d’un modèle de marque Lara-Maquette produit en 1988. Notez que la maréchaussée assure une surveillance serrée de la progression du convoi.
Dans les années 80, la France mise sur l’énergie nucléaire pour son indépendance énergétique. Le transport du combustible usé vers les centres de recyclage est assuré par la SNCF
dans des wagons spéciaux. Ici la BB 67400 assure la traction d’un modèle de marque Lara-Maquette produit en 1988. Notez que la maréchaussée assure une surveillance serrée de la progression du convoi.
Jusqu’à la fin des années 60, les trains de marchandises de la SNCF sont toujours composés de wagons couverts à deux essieux de capacité relativement faible ou des antiques wagons à bogies TP. Mais pour qu’un wagon soit rentable face à la redoutable concurrence de la route, il faut qu’il roule et qu’il puisse être chargé et déchargé le plus rapidement possible. Il faut en finir avec le coûteux et pénible travail de manutentionnaire, place à la mécanisation des opérations. Il faut aussi que les trains de marchandises puissent s’insérer plus facilement dans le trafic voyageurs en augmentant les vitesses au-delà de 100km/h. Pour cela un nouveau type de bogies est construit, l’Y 25, introduit en 1967, et toute une famille en sera dérivée. En 1967 naît le premier couvert à bogies modernes, le Gas, qui connaîtra encore la fin de la traction vapeur et les 141R.
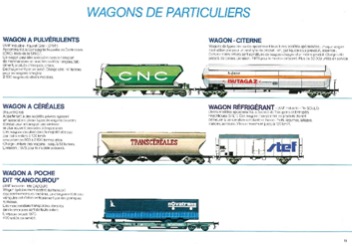
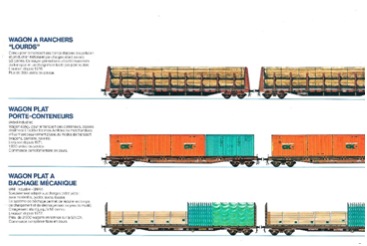 Doc 435/436 : Brochure de 1980 éditée par la SNCF, qui décrit le matériel de nouvelle génération. Les wagons de marchandises y tiennent une bonne place à côté des TGV et autres
voitures modernes.
Doc 435/436 : Brochure de 1980 éditée par la SNCF, qui décrit le matériel de nouvelle génération. Les wagons de marchandises y tiennent une bonne place à côté des TGV et autres
voitures modernes.
Afin de faciliter les déchargements et d’atteindre facilement la marchandise qui maintenant sont transportées sous forme de palettes, la SNCF met au point des wagons à parois coulissantes en 1972 (Habiss) e/ou des systèmes de bâchage mécanique « Débach’vit ». Pour augmenter les capacités, la SNCF se dote de nouveaux plats à ranchers (Ras) et des plats à dossier (Rloos). Idem pour les wagons réfrigérants avec le modèle de grande longueur Laehss. Les tombereaux aussi évoluent avec le modèle Eaos, de même que les trémies avec le type Fads.
Au début des années 70, les amateurs trouvent que le parc marchandises a besoin de s’étoffer. La gamme à bogie de la série Diamond date du début des années 60. Jouef a bien démarré une gamme de wagons
marchandises modernes avec un modèle de couvert à bogies Gas et une citerne de 110m3 pour le transport de butane en 1969.
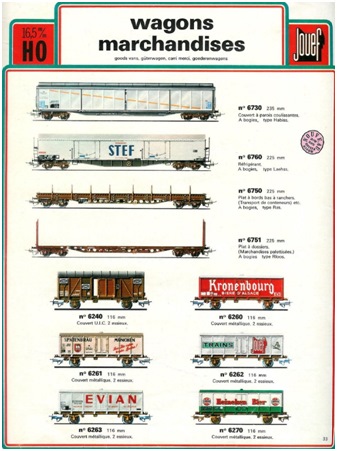 Mais l’année 1974 sera une seconde phase importante avec un couvert à parois
coulissantes (Habiss), un grand réfrigérant à Bogies STEF (Laehss), un plat à bords bas et ranchers (type Ras) et un plat à dossier pour le transport de marchandises palettisées (Rloos). En 1975, le plat à dossier
est livré en version bâchée (système Débach’vit). L’ensemble de ces wagons sont d’un très bon niveau de réalisme. Ils sont quasiment à l’échelle. Chose exceptionnelle chez Jouef, les plats sont équipés d’un
lest en tôle. Tous ces wagons seront déclinés dans de multiples décorations jusqu’aux années 2000. Plus rien à voir avec l’emblématique série des « diamond », mais ces derniers sont tout de même conservés
au catalogue, et encore pour de longues années.
Mais l’année 1974 sera une seconde phase importante avec un couvert à parois
coulissantes (Habiss), un grand réfrigérant à Bogies STEF (Laehss), un plat à bords bas et ranchers (type Ras) et un plat à dossier pour le transport de marchandises palettisées (Rloos). En 1975, le plat à dossier
est livré en version bâchée (système Débach’vit). L’ensemble de ces wagons sont d’un très bon niveau de réalisme. Ils sont quasiment à l’échelle. Chose exceptionnelle chez Jouef, les plats sont équipés d’un
lest en tôle. Tous ces wagons seront déclinés dans de multiples décorations jusqu’aux années 2000. Plus rien à voir avec l’emblématique série des « diamond », mais ces derniers sont tout de même conservés
au catalogue, et encore pour de longues années.
Encore illustrée à l’ancienne sous forme de dessins dans le catalogue 1974 de Jouef, la nouvelle génération des wagons de marchandises à bogies Y 25.
 Ces wagons sortis en 1974 sont d’un niveau de gravure et de réalisme inégalé jusque-là chez Jouef. Notez aussi les inscriptions sérigraphiées en différentes couleurs.
Ces wagons sortis en 1974 sont d’un niveau de gravure et de réalisme inégalé jusque-là chez Jouef. Notez aussi les inscriptions sérigraphiées en différentes couleurs.


 Un long de chemin a été parcouru avec le nouveau réfrigérant STEF type laehas avec une très belle reproduction des passerelles et ses inscriptions complètes.
Un long de chemin a été parcouru avec le nouveau réfrigérant STEF type laehas avec une très belle reproduction des passerelles et ses inscriptions complètes.
 Dans les années 70, des wagons de marchandise modernes avec un moyen de traction moderne, la CC 7200.
Dans les années 70, des wagons de marchandise modernes avec un moyen de traction moderne, la CC 7200.
 Les nouvelles décorations étrangères au premier plan du couvert SKw datant en décoration Evian Badoit de 1965.
Les nouvelles décorations étrangères au premier plan du couvert SKw datant en décoration Evian Badoit de 1965.
A côté des importantes nouveautés de cette nouvelle génération de wagon, il y a des re-décorations de matériel existant. Jouef ressort son couvert Evian type SKw dont le moule datait de 1965 (série 107mm). Commercialisé sous la réf 625 avec une décoration différente sur les 2 faces ; Evian d’un côté, Badoit de l’autre. Il disparait du catalogue en 1967. Début 1974 il réapparait avec une double décoration Evian début 1974 cette fois sous la référence 6263. La même caisse est aussi décorée aux couleurs de la brasserie Allemande « Spatenbräu Müchen » avec un slogan « Lass Dir raten trinke Spaten » (laisse toi conseiller, boit Spaten). Le wagon est immatriculé à la DB, une première pour du matériel marchandises chez Jouef. Il y a aussi une décoration purement Jouef avec le bonhomme de Monsieur Letourneur. Fin 1974 apparait encore une très belle version Heineken Bier à dominante verte et blanche. Il est immatriculé à la NS, les chemins de fer hollandais. A chaque fois, Jouef fait preuve de maestria au niveau de la décoration par tampographie en plusieurs couleurs. Pour les autres re-décorations, il y a le wagon à céréales type SB qui se transforme en transport de bauxite aux couleurs de Rhône Progil. Il y a aussi une nouvelle version du porte remorque routière Kangourou. La remorque bâchée est entièrement de couleur brune avec des marquages CIMT et SEGI.
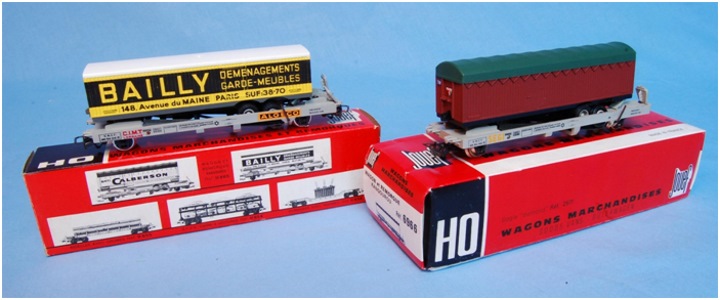 La décoration de la nouvelle remorque bâchée est entièrement brune. On la voyait déjà apparaitre de manière prémonitoire au coin du catalogue 1967.
La décoration de la nouvelle remorque bâchée est entièrement brune. On la voyait déjà apparaitre de manière prémonitoire au coin du catalogue 1967.
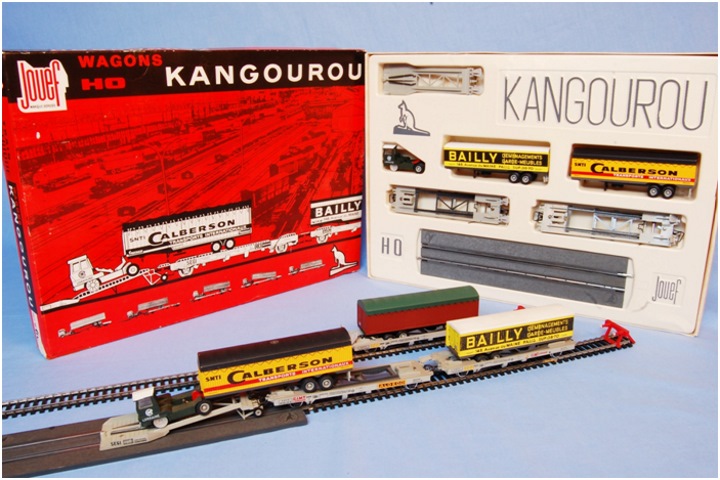 Après le coffret Kangourou sorti en 1967, Jouef propose un wagon complémentaire en 1974.
Après le coffret Kangourou sorti en 1967, Jouef propose un wagon complémentaire en 1974.
 Le transport de céréales évolue. Né Algeco en 1965, il devient Péchiney Saint Gobain en 1969, puis Rhone Progil en 1975.
Le transport de céréales évolue. Né Algeco en 1965, il devient Péchiney Saint Gobain en 1969, puis Rhone Progil en 1975.
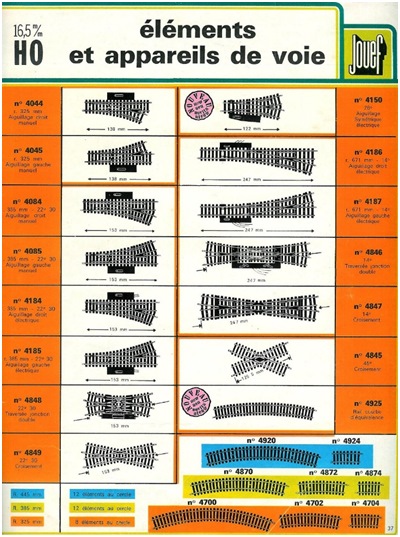 Du côté des accessoires et de la voie, les nouveautés 1974 sont : un rail extensible, un aiguillage symétrique à l’angle de 28° qui complète la gamme des aiguillages à grand rayon de 14° matériel et un rail
courbe grand rayon servant de contre courbe à ces aiguillages. Enfin un éclairage diffusant, destiné aux voitures longues sera proposé. Il est basé sur le même principe que celui de Märklin avec une pièce
en plastique transparent présentant des décrochés afin de répartir la lumière
Du côté des accessoires et de la voie, les nouveautés 1974 sont : un rail extensible, un aiguillage symétrique à l’angle de 28° qui complète la gamme des aiguillages à grand rayon de 14° matériel et un rail
courbe grand rayon servant de contre courbe à ces aiguillages. Enfin un éclairage diffusant, destiné aux voitures longues sera proposé. Il est basé sur le même principe que celui de Märklin avec une pièce
en plastique transparent présentant des décrochés afin de répartir la lumière
Les aiguillages à grands rayons sont complétés en 1974 d’un appareil symétrique et d’une contre courbe.
L’année 1974 est une grande année pour les coffrets. Sous l’impulsion de la nouvelle équipe de Jouef la gamme est complétée et leur packaging modernisé. C’est la fameuse série des coffrets à rayures, fenêtre et rivets de toutes les couleurs (assortie à la couleur du catalogue). L’objectif est bien d’attirer l’œil dans les grandes surfaces, nouvelle cible de la marque. Ce type de distribution prend progressivement la main sur les classiques magasins de jouets qui petit à petit vont disparaitre. Les anciens coffrets classiques sont conservés sous leur nouvelle présentation. Des nouveaux coffrets sont présentés : « Le Train bleu » ou des coffrets dotés de 3 aiguillages et d’éléments de pont classés « Prestige ». En tout on dénombre en 1974 : 4 coffrets mécaniques, 14 coffrets simples, 1 traditionnel « double express », 2 super 8 avec transformateur et pont, 4 coffrets avec transformateurs et aiguillages, 2 coffrets avec décor « transpanorama » et 2 coffrets « prestige ». Ainsi donc ce n’est pas moins de 29 offres que propose Jouef, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Ceci montre l’importance que la marque accorde à la recherche d’une clientèle renouvelée.
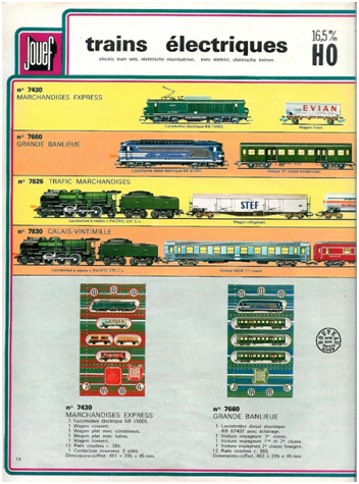
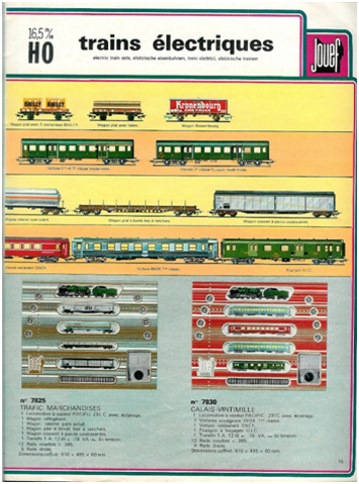 Une partie des nouveaux coffrets du catalogue 1974 ; Les nouvelles locomotives sont mises à l’honneur comme les BB 15000 et 67400. Mais curieusement, c’est aussi la vielle 231 C
qui fait sa réapparition. Les packagings rayés et à rivets marquent le nouveau look accrocheur des coffrets.
Une partie des nouveaux coffrets du catalogue 1974 ; Les nouvelles locomotives sont mises à l’honneur comme les BB 15000 et 67400. Mais curieusement, c’est aussi la vielle 231 C
qui fait sa réapparition. Les packagings rayés et à rivets marquent le nouveau look accrocheur des coffrets.
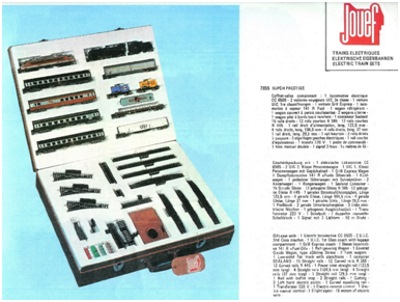 Le haut de gamme n’est pas oublié. En 1976 un coffret valise est présenté. Il contient une rame voyageur tractée par la CC 6500 et une rame marchandise tirée par une 141 R. Tout y est inclus, 3 aiguillages
électromagnétiques, le transformateur. La valise est du plus bel effet, en imitation (carton) de peau de crocodile. Qui dit mieux !
Le haut de gamme n’est pas oublié. En 1976 un coffret valise est présenté. Il contient une rame voyageur tractée par la CC 6500 et une rame marchandise tirée par une 141 R. Tout y est inclus, 3 aiguillages
électromagnétiques, le transformateur. La valise est du plus bel effet, en imitation (carton) de peau de crocodile. Qui dit mieux !
Un double train dans une valise en carton, façon « peau de crocodile ». Le très haut de gamme des coffrets Jouef.
 Les coffrets « Prestiges » Marchandises et l’Aquitaine sont des nouveautés 1974. Ils comportent 3 aiguillages électriques, des éléments de pont pour un passage supérieur, 4 rails
flexibles d’un mètre, un transformateur 1 ampère et une potence lumineuse. De quoi bien démarrer dans le modélisme ferroviaire. .
Les coffrets « Prestiges » Marchandises et l’Aquitaine sont des nouveautés 1974. Ils comportent 3 aiguillages électriques, des éléments de pont pour un passage supérieur, 4 rails
flexibles d’un mètre, un transformateur 1 ampère et une potence lumineuse. De quoi bien démarrer dans le modélisme ferroviaire. .
A partir des années 70 le trafic marchandise va vivre une évolution profonde. On parle beaucoup de déclin au profit de la route, mais pour le ferroviaire il s’agit de s’adapter à la montée en puissance du transport combiné multimodal (route, fer, voie navigable). La pièce centrale de ce mode de transport est le conteneur, des boites empilables dotées d’éléments permettant le levage, la manutention et le transfert entre les modes de transport. Les conteneurs répondent à une normalisation internationale ISO en différentes tailles de 20, 30 ou 40 pieds. Le chemin de fer n’étant pas adapté dans l’esprit des économistes à l’acheminement d’un train composé ayant chacun sa destination propre, c’est le déclin des triages qui disparaissent peu à peu. S’il est nécessaire de ventiler le chargement d’un train entre plusieurs destinations, il y a une solution des caisses mobiles avec les chantiers intermodales. Le chargement des conteneurs se mécanise avec des portiques dans des chantiers de transbordement. C’est donc la fin des charmants trains de marchandises à la composition hétéroclite pour des trains entiers de composition homogène. Fini les halles à marchandises avec ses manutentionnaires.
 Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie Nouvelle des Cadres)
Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie Nouvelle des Cadres)
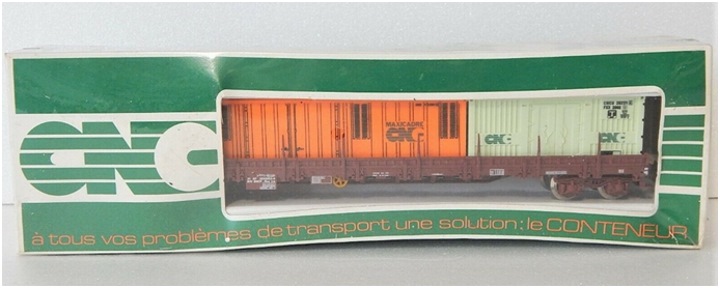 Un modèle promotionnel spécial de Jouef aux couleurs de la CNC, filiale de la SNCF spécialisée pour l’utilisation des conteneurs.
Un modèle promotionnel spécial de Jouef aux couleurs de la CNC, filiale de la SNCF spécialisée pour l’utilisation des conteneurs.
En miniature, les premiers conteneurs apparaissent chez Jouef début 1975. Ils sont aux couleurs de Sealand, Lessage,
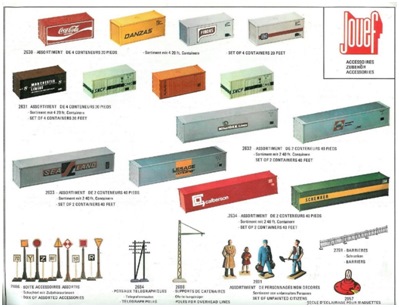 Mitsul O.S.K. Lines, Messagerie Maritime, Manchester Lines, Danzas, de la SNCF-CNC.
Ils seront d’abord, à partir de 1977, naïvement posés sur les antédiluviens wagons plats à ranchers à bogies diamond ou plats à deux essieux de la série 88. Mais ils sont ensuite aussi utilisés surs les plus
modernes un plat à bords bas et ranchers type Ras ou sur le plat à dossier type Rloos. Jouef proposera à la fois des assortiments de conteneurs 20 et 40 pieds en boites individuelles et des wagons chargés.
Mitsul O.S.K. Lines, Messagerie Maritime, Manchester Lines, Danzas, de la SNCF-CNC.
Ils seront d’abord, à partir de 1977, naïvement posés sur les antédiluviens wagons plats à ranchers à bogies diamond ou plats à deux essieux de la série 88. Mais ils sont ensuite aussi utilisés surs les plus
modernes un plat à bords bas et ranchers type Ras ou sur le plat à dossier type Rloos. Jouef proposera à la fois des assortiments de conteneurs 20 et 40 pieds en boites individuelles et des wagons chargés.
 L’ère du conteneur va devenir incontournable dans le monde ferroviaire et apporter une unité toute moderne aux convois de fret.
L’ère du conteneur va devenir incontournable dans le monde ferroviaire et apporter une unité toute moderne aux convois de fret.
 Avec l’ère du conteneur, l’aménagement des gares de marchandise évolue avec de nouveaux moyens de transbordement entre le rail et la route.
Avec l’ère du conteneur, l’aménagement des gares de marchandise évolue avec de nouveaux moyens de transbordement entre le rail et la route.
Pour une marque française, quoi de plus naturel que de chercher à conquérir le marché du pays voisin qu’est l’Allemagne. Pour cela Jouef utilise la technique habituelle des constructeurs, redécorer du matériel français aux couleurs de la DB. Ce sera le cas des voitures UIC, et aucun effort ne sera fait, même pas pour changer le type de bogies, les Y 24 de la SNCF sont conservés. Il y aura 4 versions, 1ière classe bleu, 2ième vert, 1ière classe TEE rouge et crème et une voiture restaurant de la DSG, aussi rouge et crème. C’est à partir de 1973 qu’apparait une locomotive électrique quadricourant de la DB type 184. Cette locomotive est un bon compromis, la caisse est spécifique, montée sur un châssis de BB 9200 en version simplifiée avec un seul essieu moteur.
 La gamme allemande de Jouef, des voitures UIC décorées version DB. Si elles ne sont pas exactes, elles bénéficient d’une belle finition. La BB 184 de possède une caisse exclusive et nouvelle, mais celle-ci est
montée sur un châssis de BB 9200 simplifié avec un seul essieu moteur.
La gamme allemande de Jouef, des voitures UIC décorées version DB. Si elles ne sont pas exactes, elles bénéficient d’une belle finition. La BB 184 de possède une caisse exclusive et nouvelle, mais celle-ci est
montée sur un châssis de BB 9200 simplifié avec un seul essieu moteur.
 Dans le catalogue Jouef 1974, la gamme des modèles Allemands de la DB
Dans le catalogue Jouef 1974, la gamme des modèles Allemands de la DB
 La caisse de la BB 184 est bien détaillée avec des inscriptions fines et conformes. Les vitrages avant servent aussi de conduit de lumière, et de ce fait sont peint en noir. La BB 184 utilise les pantographes issus
de la quadricourant française CC 40100.
La caisse de la BB 184 est bien détaillée avec des inscriptions fines et conformes. Les vitrages avant servent aussi de conduit de lumière, et de ce fait sont peint en noir. La BB 184 utilise les pantographes issus
de la quadricourant française CC 40100.
La période 1975-1976 se poursuit par une première avalanche de nouveautés qui caractérise la fin des années 70 chez Jouef. Curieusement, il n’y aura pas de catalogue Jouef 1975 (juste un dépliant).
Les nouveautés vont progressivement s’orienter vers les marchés étrangers. Pour preuve de cet intérêt, le catalogue 1976 est en trois langues à parts égales : Français, Allemand et Anglais. En plus des
modèles spécifiques pour d’autres pays, c’est aussi
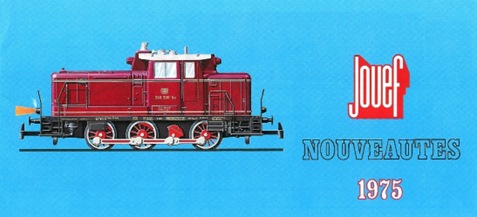 la période d’une multitude de décorations pour les réseaux étrangers. Un exemple, le couvert UIC est décliné en 6 nationalités. Pour 1975, côté matériel
moteur apparaissent la 141P et les locotracteurs DB et SNCB série 260. Pour le matériel remorqué, la grande nouveauté sera la série des voitures OCEM à rivets apparents.
la période d’une multitude de décorations pour les réseaux étrangers. Un exemple, le couvert UIC est décliné en 6 nationalités. Pour 1975, côté matériel
moteur apparaissent la 141P et les locotracteurs DB et SNCB série 260. Pour le matériel remorqué, la grande nouveauté sera la série des voitures OCEM à rivets apparents.
Dans l’histoire des locomotives à vapeur e France, la 141P a une place particulière. C’est la première machine de nouvelle génération conçue par la SNCF. De ces vapeurs « modernes » il n’y en aura que 2 types qui accèderont à la production en série : la 141P et la 241P. Elle préfigure ce qu’aurait été le parc prévu par les grands projets de la D.E.L. si la SNCF ne les avait pas très tôt abandonnés au profit de l’électrification. La 141P est en quelque sorte une synthèse de ce qui se faisait de mieux, esthétiquement et techniquement dans les anciens réseaux dont la SNCF est issue à partir de 1938. Ainsi le tablier est relevé depuis l’avant par-dessus les cylindres pour faciliter l’entretien comme sur les locomotives du Nord. La porte de boite à fumée à fermeture triangulée est aussi héritée de cette compagnie. Le dessus de la machine est hérité du PO avec la cheminée à chapiteau et les ballonnets du réchauffeur. L’abri en pointe « coupe-vent » est directement de style PLM. Quant au tender c’est une évolution des types 38m3 du Nord. La 141P est étudiée au début de la 2ième guerre mondiale par la D.E.L. sous la direction de Mr Chapelon. C’est une locomotive de type « Compound » à trois cylindres. Elle a été la plus puissante des Mikado européennes avec 3000ch au crochet. La série comprenait 318 exemplaires livrés jusqu’en 1948. Il était prévu un bien plus grand nombre d’exemplaires, mais la 141R commandée à 1340 exemplaires aux Etats-Unis par le gouvernement français provisoire, alors en Algérie, lui coupa l’herbe sous les pieds. La première locomotive est livrée le 25 avril 1942 en période de grande pénurie. On la retrouvera en service sur les régions Est, Ouest et Sud-Est jusqu’en 1968. Les premières locomotives amorties, sont celles produites durant la guerre, la mauvaise qualité des matériaux utilisés a contribué à écourter leur vie. Une carrière courte pour une belle locomotive qui a porté haut la technique vapeur française.

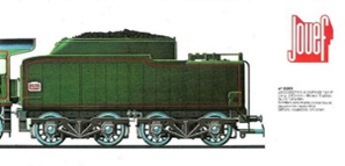 Le dépliant des nouveautés Jouef 1975 présente la 141P en double page centrale.
Le dépliant des nouveautés Jouef 1975 présente la 141P en double page centrale.
 Pour avoir une 141P sur leur réseau, les modélistes des années 60 doivent se contenter de modèles couteux fabriqués en petite série comme ici celui du revendeur parisien La Maison des trains.
Pour avoir une 141P sur leur réseau, les modélistes des années 60 doivent se contenter de modèles couteux fabriqués en petite série comme ici celui du revendeur parisien La Maison des trains.
En modélisme, les 141P sont des modèles modernes à la mode au début des années 50. Il y aura plusieurs marques artisanales qui tenteront sa reproduction. Citons les modèles FEX-Miniatrain, Maison des
Trains, TAB ou Chaumeil. De très beaux modèles, mais chers et de ce fait, rares. La firme JEP tentera une mémorable reproduction en métal moulé avec deux moteurs pour circuler sur la voie 0. Mais en H0,
point de modèle de grande série jusqu’à la nouveauté Jouef de 1975.
 La reproduction de la 141P Maison des trains disposait d’une caisse en bronze monté sur un châssis du commerce. Suivant l’utilisation en 2 rails CC il était d’origine Fleischmann
(modèle du bas) ou en 3 rails CA il était d’origine Märklin (modèle du haut)
La reproduction de la 141P Maison des trains disposait d’une caisse en bronze monté sur un châssis du commerce. Suivant l’utilisation en 2 rails CC il était d’origine Fleischmann
(modèle du bas) ou en 3 rails CA il était d’origine Märklin (modèle du haut)
 Les 141P sont des modèles modernes à la mode au début des années 50. En plus des modèles FEX-Miniatrain et Maison des Trains, on trouve le modèle TAB. C’est sans doute
le plus beau, mais aussi le plus rare (Collection et photo Didier Deleuze)
Les 141P sont des modèles modernes à la mode au début des années 50. En plus des modèles FEX-Miniatrain et Maison des Trains, on trouve le modèle TAB. C’est sans doute
le plus beau, mais aussi le plus rare (Collection et photo Didier Deleuze)
 Il existe de multiples versions de la 141P de Miniatrain, depuis les modèles en laiton assez fidèles jusqu’au modèles en zamac, permettant la construction modulaire de 231, 241
ou 150 imaginaires.
Il existe de multiples versions de la 141P de Miniatrain, depuis les modèles en laiton assez fidèles jusqu’au modèles en zamac, permettant la construction modulaire de 231, 241
ou 150 imaginaires.
 Avec 2,9kg de zamac et deux moteurs AP5, la 141P sortie en 1957 à l’échelle 0 sera le chef d’œuvre de JEP. Mais cette locomotive vaut une petite fortune, rien à voir avec la 141P
de jouef sortie en 1975 qui est à la portée de tous.
Avec 2,9kg de zamac et deux moteurs AP5, la 141P sortie en 1957 à l’échelle 0 sera le chef d’œuvre de JEP. Mais cette locomotive vaut une petite fortune, rien à voir avec la 141P
de jouef sortie en 1975 qui est à la portée de tous.
Le modèle de Jouef est dans la lignée de la 141R sortie en 1969. Un modèle détaillé, à l’échelle tout en restant à la portée de tous, la philosophie de Jouef. Les modèles vapeur dans cet esprit se succèdent,
la 241P en 1971, la 231K en 1973 et voilà la 141P en 1975. Pour celle-ci Jouef utilise logiquement le tender moteur type 36P de la 241P, ce qui limite notablement les investissements. La partie mécanique est
inchangée, seule la décoration évolue avec une affectation de la machine au dépôt de Vénissieux. La locomotive est composée de 3 éléments essentiellement en plastique, le châssis, le tablier et la chaudière.
La nouveauté est que l’embiellage, en tôle découpée et matricée, est bruni. Ce mode de traitement est une première chez Jouef, il touchera par la suite tous les modèles. Pas d’éclairage, mais des broches
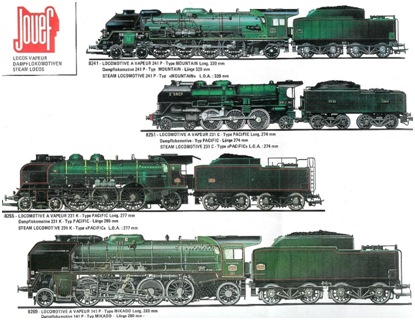 équipent la liaison tender-locomotive qui facilitent son installation par l’amateur. Beaucoup de détails, dont les mains courantes, sont rapportés, et la décoration à l’aide d’une peinture satinée donne un aspect
très réaliste à ce modèle. Incontestablement c’est la reproduction en H0 marquante pour l’année 1975. Le modèle de l’année en quelque sorte.
équipent la liaison tender-locomotive qui facilitent son installation par l’amateur. Beaucoup de détails, dont les mains courantes, sont rapportés, et la décoration à l’aide d’une peinture satinée donne un aspect
très réaliste à ce modèle. Incontestablement c’est la reproduction en H0 marquante pour l’année 1975. Le modèle de l’année en quelque sorte.
 La décoration satinée et l’embiellage pour la première fois bruni chez Jouef procure à ce modèle un excellent niveau de réalisme.
La décoration satinée et l’embiellage pour la première fois bruni chez Jouef procure à ce modèle un excellent niveau de réalisme.
 A partir de 1997 la 241P sera reprise avec une nouvelle motorisation dans son tender et en version superdétaillée (les deux versions à l’arrière-plan). Ainsi, elle survivra jusqu’à la fin
du Jouef d’origine Champagnole dans diverses décorations. Au premier plan, le modèle original que j’ai reçu pour Noël 1975.
A partir de 1997 la 241P sera reprise avec une nouvelle motorisation dans son tender et en version superdétaillée (les deux versions à l’arrière-plan). Ainsi, elle survivra jusqu’à la fin
du Jouef d’origine Champagnole dans diverses décorations. Au premier plan, le modèle original que j’ai reçu pour Noël 1975.
 Associée aux voitures OCEM à rivet apparent cette locomotive à vapeur 141P à prix démocratique comble les amateurs en 1975.
Associée aux voitures OCEM à rivet apparent cette locomotive à vapeur 141P à prix démocratique comble les amateurs en 1975.
Une série de voitures bien connue des amateurs est celle dite des OCEM. Elles doivent leur non à l’Office Central d’Etude du Matériel, une entité commune aux différentes compagnies et qui réalise des études
communes pour leur compte. C’est l’OCEM qui a en charge l’étude des voitures métalliques construites entre 1924 et 1938. Ce programme s’accélère avec le besoin de sécurité pour des trains de plus en plus
rapides. Il est en effet urgent d’abandonner les voitures à caisse en bois sur châssis métallique en raison de leur manque de résistance au choc. On déplorera des accidents terribles comme celui de
Lagny-Pomponne, le 30 décembre 1933, qui a fait près de 200 morts et 300 blessés. L’express à destination de Nancy est à l’arrêt lorsqu’il est percuté à l’arrière par un rapide. La locomotive balaye littéralement
les 5 dernières voitures qui sont pulvérisées en milliers de débris meurtriers. Les passagers sont écrasés par la masse métallique du rapide. Mais il n’y a eu aucun mort dans le rapide, équipé de voitures
métalliques : toutes les victimes sont du côté des voitures en bois.
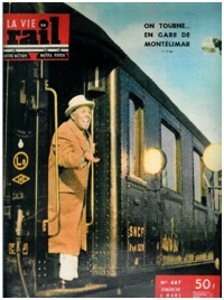 Les clients, passagers des compagnies, réclament des voitures métalliques pour se sentir en sécurité. Les compagnies font appel à l’OCEM
pour concevoir des voitures. Avec l’évolution du mode de construction, Il y aura 3 séries. De 1925 à 1931, c’est le premier modèle dit « à Rivets Apparents » ou RA. Le rivet est un mode d’assemblage historique,
et au début, ils restent bien visibles. Les voitures à rivets apparents circuleront aux couleurs des compagnies du PLM, du Midi, de l’Etat et de l’AL, avant la création de la SNCF. Les derniers éléments de
cette catégorie sont retirés du service au milieu des années 80.
Les clients, passagers des compagnies, réclament des voitures métalliques pour se sentir en sécurité. Les compagnies font appel à l’OCEM
pour concevoir des voitures. Avec l’évolution du mode de construction, Il y aura 3 séries. De 1925 à 1931, c’est le premier modèle dit « à Rivets Apparents » ou RA. Le rivet est un mode d’assemblage historique,
et au début, ils restent bien visibles. Les voitures à rivets apparents circuleront aux couleurs des compagnies du PLM, du Midi, de l’Etat et de l’AL, avant la création de la SNCF. Les derniers éléments de
cette catégorie sont retirés du service au milieu des années 80.
 Une voiture OCEM à rivets apparents en version SNCF au premier plan, nouveauté 1975. Autour des différents modèles en décoration PLM apparus à partir de 1977.
Une voiture OCEM à rivets apparents en version SNCF au premier plan, nouveauté 1975. Autour des différents modèles en décoration PLM apparus à partir de 1977.
 La 231K qui apparaitra en 1977 équipée d’un tender PLM permettra de composer une belle rame de cette compagnie d’avant 1938. (Ici un modèle Jouef superdétaillé par le détaillant
parisien Clarel).
La 231K qui apparaitra en 1977 équipée d’un tender PLM permettra de composer une belle rame de cette compagnie d’avant 1938. (Ici un modèle Jouef superdétaillé par le détaillant
parisien Clarel).
A côté du matériel moteur, les nouveautés 1975 de Jouef concernent presque exclusivement les matériels voyageurs, puisque les marchandises, ont uniquement des nouvelles décorations. Mais les trois voitures OCEM à rivets apparents sont certainement cette année-là, très appréciées des amateurs. Les reproductions des années 50 faites par SMCF de ce type de voiture commencent à dater. Il y a bien les modèles France Trains, mais ils ne sont pas à portée de toutes les bourses. Plus accessibles seront les modèles Jouef qui apparaissent en trois versions. La mixte 1ière/2ième classe A3-B5, la 2ième classe B9 et la mixte 2ième classe/fourgon B4D. Elles sont présentées en 1975 en marquage SNCF UIC à sigle allongé. Elles seront complétées à partir de 1977 par de très belles versions PLM dont une 1ère classe bicolore brune et noire. Le niveau de détail est élevé, avec les toitures dotées d’une ligne de commande du signal d’alarme et des rambardes rapportées au niveau des portes. La firme Rivarossi, qui reprendra Jouef après 2001, ressort ces voitures en version améliorée en 2003 dotées d’un ancien marquage SNCF.
Le matériel moderne est peu représenté parmi les nouveautés Jouef 1975. Il y a pourtant une voiture restaurant « Grand Confort » Vru type U68 qui manquait à la gamme pour constituer une rame complète.
Cet élément est homogène avec les autres voitures. A noter de belles inscriptions en relief « restaurant » sur le flanc.

Il manquait une voiture restaurant à la rame «Grand Confort » de Jouef. C’est chose faite avec cette nouveauté 1975.
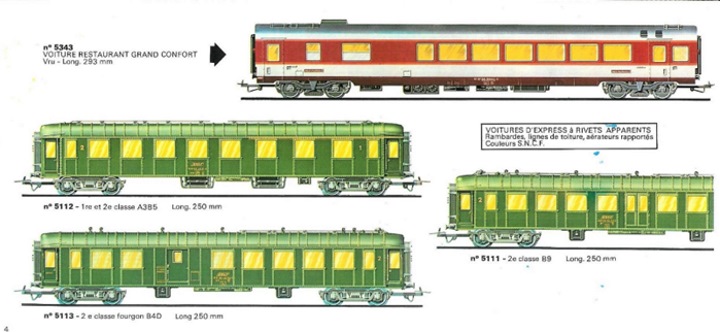 Le dépliant des nouveautés 1975 à la page des voitures. Les anciennes OCEM PLM côtoient la voiture restaurant Grand-confort.
Le dépliant des nouveautés 1975 à la page des voitures. Les anciennes OCEM PLM côtoient la voiture restaurant Grand-confort.
Longtemps cantonné au marché français, Jouef amorce à partir de 1975 Jouef des ambitions à l’exportation. Ce n’est plus comme au temps de Playcraft, le marché Britannique qui est visé, mais le premier consommateur de trains miniature d’Europe de l’Ouest ; l’Allemagne. Pour cela, l’atout de Jouef est son prix. Par contre le modéliste Allemand met la barre haute pour ce qui concerne le fonctionnement et la qualité. La marque de Champagnole vise donc plutôt le bas de gamme sur ce marché germanique. Important. Après avoir proposé des redécorations de voitures voyageur de type Français, ou des locomotives basiques comme la BB type 184 de la DB sortie en 1973, montée sur le châssis simplifié d’une BB 9200, arrive la périodes des modèles spécialement conçus, de A à Z pour l’Allemagne. Le premier de cette lignée sera en 1975 le locotracteur diesel hydraulique à 3 essieux série 260 de la DB (ex V-60). Le modèle réel a été construit à 941 exemplaires pour la DB à partir de 1953 par les usines Fried-Krupp à Essen. Il était donc présent sur presque tous les triages d’Allemagne pour effectuer les manœuvres. Ces locomotives développaient 650Cv et pouvaient rouler à 60 km/h pour assurer exceptionnellement des trafics marchandise régionaux. Le même type de locotracteur a également eu une carrière Belge. Le type C80 de la SNCB est construit en Belgique d’après les plans UIC semblables à ceux du type V60 allemand. Jouef saisira cette opportunité pour reproduire à la fois une version Belge et une curieuse version désigné type C Mak 3, censé être un matériel privé de la société des ciments Français. Mais la version la plus rare est sans aucun doute la référence 8904 des chemins de fer Grecs. Elle est discrètement représentée par un petit drapeau dans un coin du catalogue 1976.
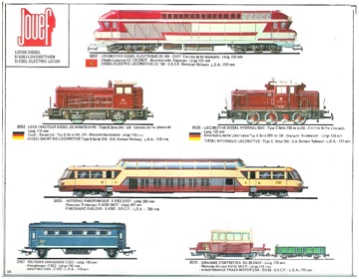
 Illustrés dans les pages du catalogue 1976, toute une profusion de modèles d’exportation. On y retrouve les 3 versions du locotracteur à 3 essieux Série 260 de la DB rouge, type C 80 de la SNCB verte et type
MAK 3 de la Société des Ciments Français. Jouef en profite aussi pour proposer dans ses modèles d’exportation dès 1975, une version DB de son locotracteur Y-51130 de la SNCF. Cet engin avait été livré
à la Sarre peu après la guerre, puis intégré au parc de la DB sous la série 245 (ex V45). Pour l’occasion, Jouef dote ses modèles de rambardes frontales et latérales.
Illustrés dans les pages du catalogue 1976, toute une profusion de modèles d’exportation. On y retrouve les 3 versions du locotracteur à 3 essieux Série 260 de la DB rouge, type C 80 de la SNCB verte et type
MAK 3 de la Société des Ciments Français. Jouef en profite aussi pour proposer dans ses modèles d’exportation dès 1975, une version DB de son locotracteur Y-51130 de la SNCF. Cet engin avait été livré
à la Sarre peu après la guerre, puis intégré au parc de la DB sous la série 245 (ex V45). Pour l’occasion, Jouef dote ses modèles de rambardes frontales et latérales.
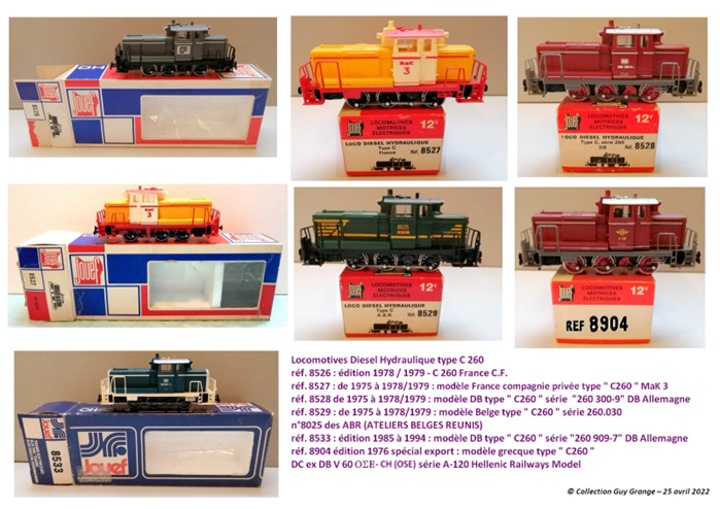 Les différents modèles de locotracteurs diesel Hydraulique C 260 de Jouef (Photo et collection Guy Grange).
Les différents modèles de locotracteurs diesel Hydraulique C 260 de Jouef (Photo et collection Guy Grange).
 Le locotracteur type C est intelligemment construit. Après avoir dégrafé la cabine, la seule vis devient accessible. Elle permet de séparer capot, platelage et le châssis. L’entrainement
se fait suivant la technologie de Jouef à cette époque, par courroie. Seule les 2 feux avant sont éclairés.
Le locotracteur type C est intelligemment construit. Après avoir dégrafé la cabine, la seule vis devient accessible. Elle permet de séparer capot, platelage et le châssis. L’entrainement
se fait suivant la technologie de Jouef à cette époque, par courroie. Seule les 2 feux avant sont éclairés.
 Avec le locotracteur série 260 (ex V60), Jouef s’attaque à un modèle emblématique reproduit par les grandes marques Allemandes. Fleischmann en propose une reproduction en métal
injecté dès 1959. Le modèle de Märklin sorti en 1964 sera plus fin et reproduit à l’échelle. Les deux marques avaient aussi produit la version verte belge.
Avec le locotracteur série 260 (ex V60), Jouef s’attaque à un modèle emblématique reproduit par les grandes marques Allemandes. Fleischmann en propose une reproduction en métal
injecté dès 1959. Le modèle de Märklin sorti en 1964 sera plus fin et reproduit à l’échelle. Les deux marques avaient aussi produit la version verte belge.
 Comparaison des modèles Belges A.B.R. (Ateliers Belges Réunis), Jouef au premier plan, Fleischmann (version 1959) et deux reproductions de Märklin dans les versions
1963 et 1979 (dans sa boite).
Comparaison des modèles Belges A.B.R. (Ateliers Belges Réunis), Jouef au premier plan, Fleischmann (version 1959) et deux reproductions de Märklin dans les versions
1963 et 1979 (dans sa boite).
 La comparaison des modèles Märklin (en haut) et Jouef donne plutôt l’avantage à cette dernière.
La comparaison des modèles Märklin (en haut) et Jouef donne plutôt l’avantage à cette dernière.
Le modèle de diesel série 260 est une remarquable reproduction tout plastique. Il n’y a qu’une vis d’assemblage dissimulée dans la cabine. Le capot et le platelage se dégagent ensuite du châssis par encliquetage . Le moteur 5 pôles de Jouef entraine l’essieu moteur médian par le système de poulie, courroie en caoutchouc et vis sans fin comme c’est la technique en 1975. Les deux autres essieux et les contrepoids sont entrainés par les bielles motrices. Une lampe d’éclairage est montée avec un conduit de lumière qui éclaire seulement les deux fanaux de la traverse situé du côté du grand capot. La version DB possède une caisse rouge à platelage gris. La version Belge possède une caisse verte à bande jaune et platelage noir. Et la curieuse version industrielle française possède un capot jaune (très) vif, une cabine ivoire et un platelage rouge. C’est une version très « kitch » fait plastique. Elle ne sera produite qu’une année, sans doute trop irréaliste pour les chiffres de vente. En 1978, elle sera remplacée par une version grise plus discrète.
 Le locotracteur en version Belge C80 de la SNCB tracte son lot de wagons de bière.
Le locotracteur en version Belge C80 de la SNCB tracte son lot de wagons de bière.
 Dans le Loco Revue de janvier 1977 la version industrielle française Mak 3 du locotracteur série 260 réf 8527 est qualifiée de « faisant horriblement jouet plastique, ce qui dessert totalement le modèle par ailleurs
réussi ». Il est conseillé de choisir la version belge si l’on veut un modèle industriel. C’est sans doute pour cela que le modèle « Mak 3 » sera rapidement abandonné par Jouef. Avec ce modèle, c’est un peu le
retour vers les modèles colorés des années 50, comme la 020T version Western comme ci-dessus.
Dans le Loco Revue de janvier 1977 la version industrielle française Mak 3 du locotracteur série 260 réf 8527 est qualifiée de « faisant horriblement jouet plastique, ce qui dessert totalement le modèle par ailleurs
réussi ». Il est conseillé de choisir la version belge si l’on veut un modèle industriel. C’est sans doute pour cela que le modèle « Mak 3 » sera rapidement abandonné par Jouef. Avec ce modèle, c’est un peu le
retour vers les modèles colorés des années 50, comme la 020T version Western comme ci-dessus.
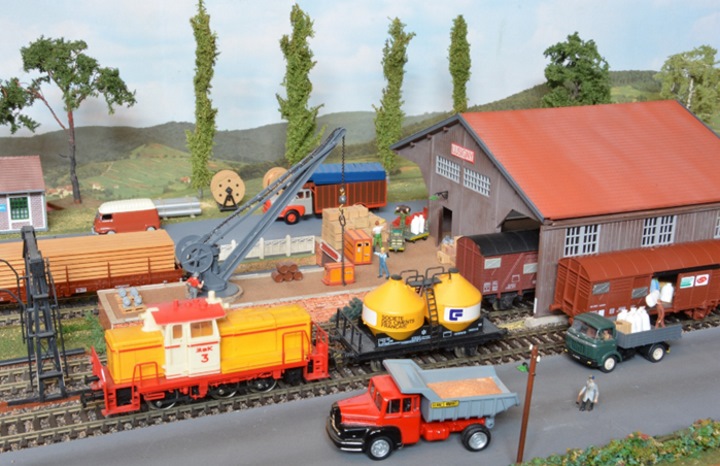 Il est certain que le diesel Mak 3 et la nouvelle version du wagon à silo à dans sa décoration jaune Ciment Français font « flash » dans le décor !
Il est certain que le diesel Mak 3 et la nouvelle version du wagon à silo à dans sa décoration jaune Ciment Français font « flash » dans le décor !
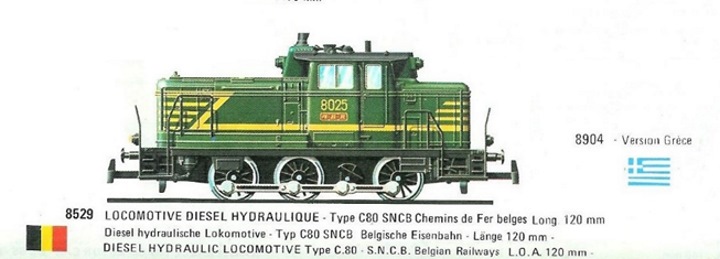 Avez-vous remarqué dans un coin du catalogue 1976, à côté de la version Belge, le drapeau Grec qui annonce la référence 8904 du locotracteur pour ce pays.
Avez-vous remarqué dans un coin du catalogue 1976, à côté de la version Belge, le drapeau Grec qui annonce la référence 8904 du locotracteur pour ce pays.

 Ce modèle d’exportation série A 120 des Hellenic Railwails a bien existé comme le prouve ces photos. (Photo et modèle collection Guy Grange).
Ce modèle d’exportation série A 120 des Hellenic Railwails a bien existé comme le prouve ces photos. (Photo et modèle collection Guy Grange).
En 1975, Jouef renouvelle son modèle de wagon citerne OCEM datant de 1963. Ce modèle déjà ancien, fait partie de la série 88mm à 2 essieux. En 1975 ils commencent à dater un peu. De plus, en l’utilisant
comme citerne du wagon nettoyeur de voie à partir de 1969,
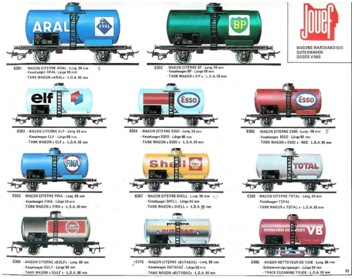 le moule a été modifié et une grande découpe assez visible apparait dans la partie inférieure du réservoir. Qu’à cela ne tienne, en 1975 Jouef ajoute
toute une série de nouvelles décorations à celles déjà excitantes. On peut citer les versions Elf blanche, Aral bleu, BP, verte, Esso en deux versions, rouge ou blanche à bande rouge, Schell jaune, Fina bleu,
Total et Gulf de couleur aluminium. A cela il faut y ajouter les versions Butagaz et VB d’entretien des voies, cela constitue pas moins de 11 modèles sur un même moule. On peut dire que ce dernier, datant
de plus de 10 ans est correctement rentabilisé.
le moule a été modifié et une grande découpe assez visible apparait dans la partie inférieure du réservoir. Qu’à cela ne tienne, en 1975 Jouef ajoute
toute une série de nouvelles décorations à celles déjà excitantes. On peut citer les versions Elf blanche, Aral bleu, BP, verte, Esso en deux versions, rouge ou blanche à bande rouge, Schell jaune, Fina bleu,
Total et Gulf de couleur aluminium. A cela il faut y ajouter les versions Butagaz et VB d’entretien des voies, cela constitue pas moins de 11 modèles sur un même moule. On peut dire que ce dernier, datant
de plus de 10 ans est correctement rentabilisé.
Le catalogue 1976 présente l’offre des citernes dans de multiples décorations.
 Au fond les 12 versions de la citerne OCEM à 2 essieux série 88mm sorties en 1975. Au premier plan à droite, deux versions initiales de Jouef en1963. A gauche la curieuse version
Schell/BP commercialisée par Playcraft en Angleterre dans les années 60.
Au fond les 12 versions de la citerne OCEM à 2 essieux série 88mm sorties en 1975. Au premier plan à droite, deux versions initiales de Jouef en1963. A gauche la curieuse version
Schell/BP commercialisée par Playcraft en Angleterre dans les années 60.
 De la couleur dans nos paysages français. Après le premier choc pétrolier, le slogan de l’époque est « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ». En attendant les trains
d’hydrocarbure restent de mise, et en traction diesel en plus.
De la couleur dans nos paysages français. Après le premier choc pétrolier, le slogan de l’époque est « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ». En attendant les trains
d’hydrocarbure restent de mise, et en traction diesel en plus.
Au chapitre des nouveautés pour le décor, il y aura en 1975 l’immeuble du XVIe siècle, de style Henri IV. Cette belle maquette est signée Philippe Valois. On lui dit déjà la gare de Castelnaudary et le très bel
ensemble du moulin Sarthois. Le niveau de réalisme atteint par Jouef sur les bâtiments fait encore ici un bond. L’immeuble à arcade est inspiré des bâtisses qui ceinturent la place des Vosges, en plein cœur
du quartier des Marais à Paris. La finesse des balustrades en fer forgé des fenêtres et des balcons est tout simplement époustouflante. Des bandes de papiers reproduisent les briques roses.
Le plafond-voûte
des arcades est scrupuleusement reproduit. Comme celà est clairement illustré sur le couvercle de la boite, l’immeuble est conçu pour une juxtaposition de plusieurs éléments (comme c’est le cas, place des
Vosges).
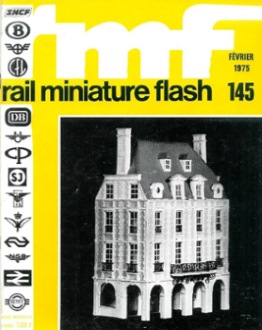
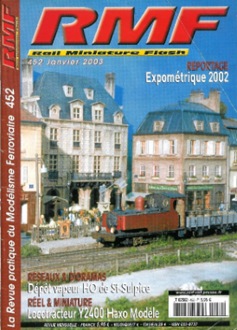 Un très beau modèle, mais qui aura du mal à se vendre, car difficile à placer sur un réseau.
Un très beau modèle, mais qui aura du mal à se vendre, car difficile à placer sur un réseau.
Le numéro RMF de février 1975 présente traditionnellement les nouveautés Jouef en avant-première de Nuremberg. Pour illustrer le futur immeuble du XVIième siècle, la maquette prototype de Philippe Valois qui a servi à son élaboration, est illustrée en couverture. La version moulée en plastique sera du même niveau. 28 ans plus tard, la même revue RMF illustre sur sa couverture un réseau d’Expométrique qui met en avant l’immeuble du 17ième siècle. Il est entré dans le patrimoine des modélistes.
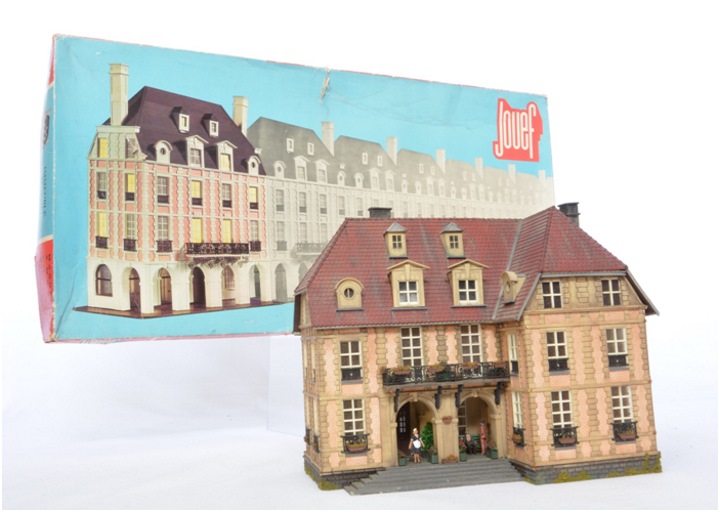 L’énorme boite Jouef permet de construire l’immeuble du 17ième siècle. Comme illustré, plusieurs unités peuvent êtres juxtaposées. Au premier plan un Kit-bashing de l’auteur à partir
de la boite Jouef. Il y a très longtemps, dans ma jeunesse, je m’étais permis de modifier l’immeuble Jouef en un hôtel particulier doté d’un toit en tuile et d’un étage en moins.
L’énorme boite Jouef permet de construire l’immeuble du 17ième siècle. Comme illustré, plusieurs unités peuvent êtres juxtaposées. Au premier plan un Kit-bashing de l’auteur à partir
de la boite Jouef. Il y a très longtemps, dans ma jeunesse, je m’étais permis de modifier l’immeuble Jouef en un hôtel particulier doté d’un toit en tuile et d’un étage en moins.
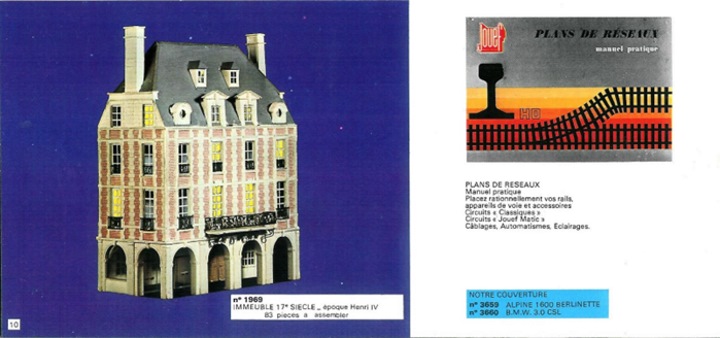 Dans le catalogue des nouveautés 1975, c’est le prototype fait par Philippe Valois du très bel immeuble du 17ième siècle qui est illustré. Par rapport aux anciennes créations,
il a abandonné l’échelle du 1/100ième pour le 1/87ième. A noter aussi la nouvelle brochure de plan de réseau.
Dans le catalogue des nouveautés 1975, c’est le prototype fait par Philippe Valois du très bel immeuble du 17ième siècle qui est illustré. Par rapport aux anciennes créations,
il a abandonné l’échelle du 1/100ième pour le 1/87ième. A noter aussi la nouvelle brochure de plan de réseau.
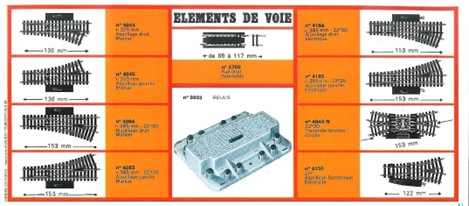 Pas de véritable nouveauté dans le domaine de la voie, mais une modernisation des moteurs de commande des aiguillages pour un fonctionnement amélioré. Les cosses de
connection sont remplacées par des fils. A noter le nouveau relais inverseur avec interrupteur de fin de course, pour ne plus griller la bobine de commande.
Pas de véritable nouveauté dans le domaine de la voie, mais une modernisation des moteurs de commande des aiguillages pour un fonctionnement amélioré. Les cosses de
connection sont remplacées par des fils. A noter le nouveau relais inverseur avec interrupteur de fin de course, pour ne plus griller la bobine de commande.
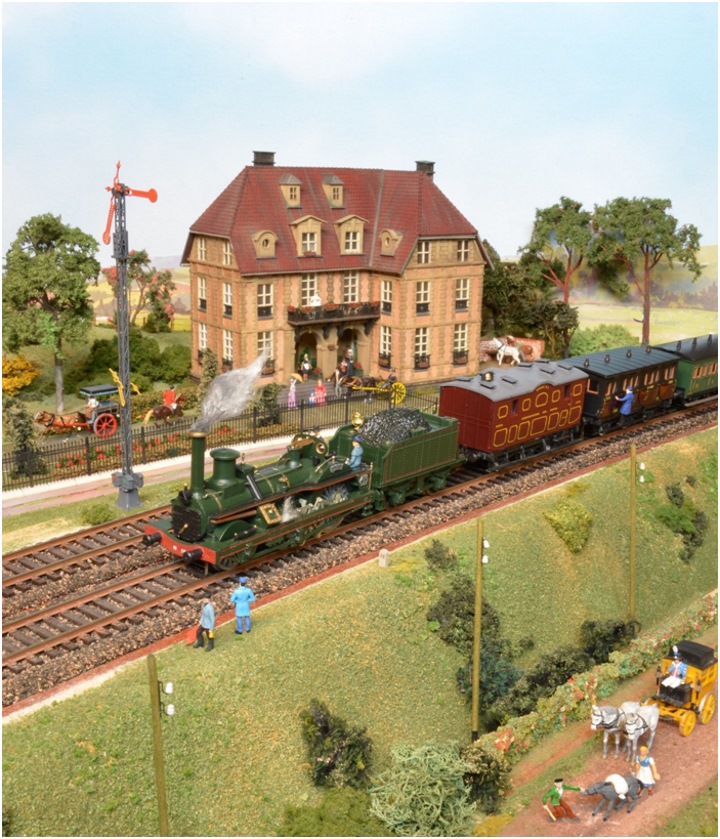 Avec l’achat de ma Crampton du RMA, j’ai ressorti cette adaptation pour servir de décor situé autour des années 1860.
Avec l’achat de ma Crampton du RMA, j’ai ressorti cette adaptation pour servir de décor situé autour des années 1860.
 Le manoir style Henry IV sert cette fois d’écrin au passage des rames Capitole de Jouef.
Le manoir style Henry IV sert cette fois d’écrin au passage des rames Capitole de Jouef.
L’année 1976 est marquée par une forte sécheresse durant l’été. Ce n’est pas du tout le cas pour ce qui concerne la production chez Jouef. Plus de 50 références nouvelles s’ajoutent au catalogue. Bien entendu, ce ne sont pas 50 productions entièrement nouvelles qui verront le jour. On dénombre aussi toute une série de variantes de décoration de modèles anciens ou nouveaux. Jouef continue à jouer la carte de l’international avec des modèles Suisses, Belge, Luxembourgeois, Anglais ou Hollandais. Mais le catalogue 1976 propose aussi des variantes qui concernent des marchés plus surprenant pour l’Espagne, le Maroc ou le Portugal. Ces variantes, seront pour certaines, jamais commercialisées. A noter que contrairement à l’année précédente, 1976 est en majorité consacré au matériel moderne, le Old-timer est provisoirement mis de côté avec une seule semi-nouveauté vapeur, la 140C doté d’un tender 34X.

L’un des catalogues parmi les plus prolifiques en nouveautés Jouef, celui de 1976. La 141P partage la vedette avec la moderne CC 6500. Pour le plus grand plaisir des modélistes, la marque alterne Old-timer et modernisme.
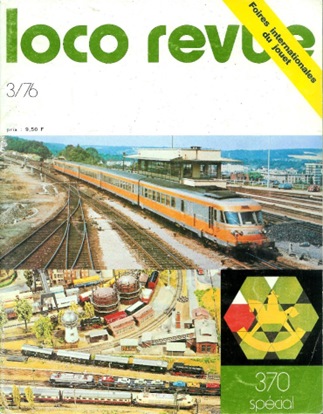
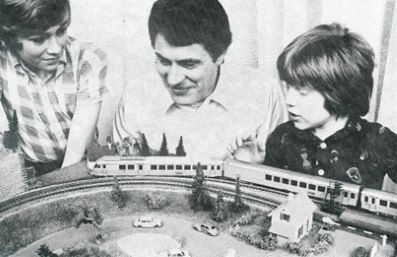
Le Loco Revue « Spécial nouveauté Nuremberg 1976 » met en avant en couverture et dans ses pages la principale nouveauté de Jouef ; la rame RTG.
Au milieu des années 70, le trafic banlieue augmente régulièrement de 2 à 3% par an. Il convient alors pour la SNCF de massifier encore la capacité de ses matériels. Le concept à deux étages renvient sur le
devant de l’actualité avec les VB2N (Voitures de Banlieue à 2 Niveaux) construites à 589 exemplaires. Les rames disposent de voitures- pilotes et elles sont donc réversibles. Capables de rouler à 140km/h, elles
peuvent comporter 7 à 8 caisses. La traction (ou la pousse) est assurée par des BB 8500, 16500, 17000 ou 25500.
 Les voitures sont décorées par Paul Arzens avec des tons très à la mode à cette époque,
du gris et de l’orange TGV à l’origine. Elles reçoivent ensuite une livrée « bleu-blanc-rouge Ile-de-France » et, pour finir, la décoration aux couleurs du Transilien. Entre-temps, pour gagner encore de la place,
la SNCF a investi à partir de 1983 dans les premières automotrices Z5600, disposant aussi de deux étages passagers (Z2N). C’est le début d’une longue lignée, et, pour ce qui est du concept à deux étages,
les TGV Duplex ou les rames de banlieue le perpétuent de nos jours.
Les voitures sont décorées par Paul Arzens avec des tons très à la mode à cette époque,
du gris et de l’orange TGV à l’origine. Elles reçoivent ensuite une livrée « bleu-blanc-rouge Ile-de-France » et, pour finir, la décoration aux couleurs du Transilien. Entre-temps, pour gagner encore de la place,
la SNCF a investi à partir de 1983 dans les premières automotrices Z5600, disposant aussi de deux étages passagers (Z2N). C’est le début d’une longue lignée, et, pour ce qui est du concept à deux étages,
les TGV Duplex ou les rames de banlieue le perpétuent de nos jours.
Document publicitaire édité par la SNCF en 1978, présentant les nouveaux matériels pour la banlieue, dont les rames 0 deux niveaux VB2N.
C’est en 1976 que Jouef va s’attaquer à cette rame, avec pas moins de 4 références associées à une motrice BB 17000. On y trouve une voiture de tête, une 2ième classe, une 1/2ième et la voiture-pilote. Le mode de construction, s’agissant de voitures à deux étages, est complexe. Elles disposent d’un aménagement intérieur et de vitres teintées en orange pour les baies de l’étage supérieur. Spécialement pour ces voitures, Jouef a créé des bogies Y30P assez fidèles. En 1983 ces véhicules seront déclinés en décoration Ile-de-France.
 La 205 GTI, vedette automobile des années 80, piaffe d’impatience au PN automatique en attendant le passage.
La 205 GTI, vedette automobile des années 80, piaffe d’impatience au PN automatique en attendant le passage.
 Les cinq modèles de Jouef permettant de recomposer les rames VB2N, bien connues de millions de banlieusards de la région parisienne. La BB 17029 de Jouef est en livrée spéciale,
assortie à la rame à deux niveaux.
Les cinq modèles de Jouef permettant de recomposer les rames VB2N, bien connues de millions de banlieusards de la région parisienne. La BB 17029 de Jouef est en livrée spéciale,
assortie à la rame à deux niveaux.
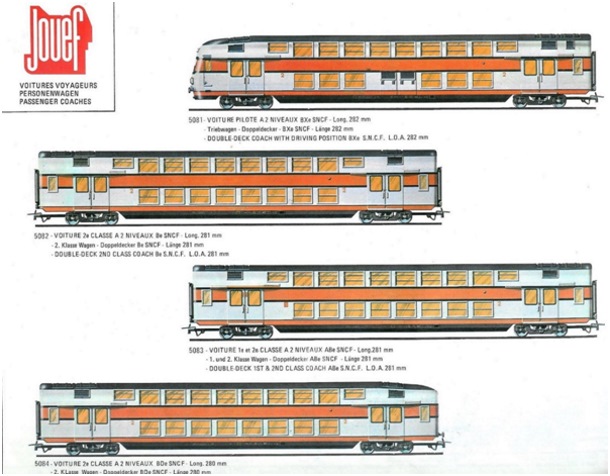 Les voitures VB2N présentées pour la première fois dans le catalogue Jouef de 1976.
Les voitures VB2N présentées pour la première fois dans le catalogue Jouef de 1976.
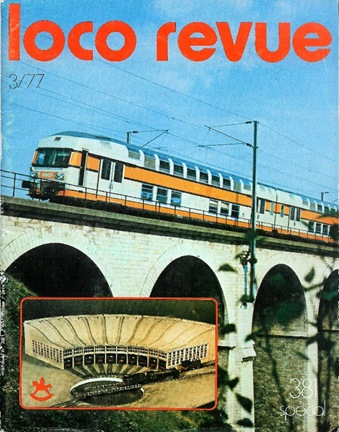
La couverture de Loco Revue de mars 77 illustre la rame VB2N à deux étages de la SNCF et sa voiture pilote. La rame de Jouef est décrite dans ce numéro à la rubrique Shopping de la revue. Comme c’est le numéro des nouveautés de Nuremberg, on voit déjà apparaitre la principale nouveauté 1977, le grand dépôt de Jouef avec sa plaque tournante de type 24m unifiée et la rotonde detype P.
 Les rames VB2N sont réversibles et disposent de voiture pilote reproduite par Jouef.
Les rames VB2N sont réversibles et disposent de voiture pilote reproduite par Jouef.
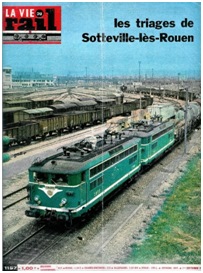 Associé à la BB 17029 apparait aussi la version bi-courant BB 25531. Les deux motrices ne diffèrent extérieurement que par leurs livrées et l’habillage de toiture. Cette particularité est respectée par Jouef, les
deux modèles bénéficiant de toiture détaillée avec comme pièces rapportées : parafoudres, lignes de toiture, avertisseurs, etc. Pour la première fois, les rambardes sont en plastique (assez grossières et il
manque les rambardes frontales qui ne sont pas livrées). Les bogies moteurs sont de conception entièrement nouvelle chez Jouef. Un berceau incliné supporte le moteur 5 pôles. L’arbre moteur est équipé
d’une vis sans fin qui attaque l’essieu moteur intérieur. L’autre essieu est entrainé par un train d’engrenages droits. La transmission conserve l’inconvénient des arrêts brutaux. Mais cette transmission a
l’avantage d’être silencieuse par rapport à toutes celles employées par Jouef jusque-là. C’est vu à l’époque comme un grand progrès.
Associé à la BB 17029 apparait aussi la version bi-courant BB 25531. Les deux motrices ne diffèrent extérieurement que par leurs livrées et l’habillage de toiture. Cette particularité est respectée par Jouef, les
deux modèles bénéficiant de toiture détaillée avec comme pièces rapportées : parafoudres, lignes de toiture, avertisseurs, etc. Pour la première fois, les rambardes sont en plastique (assez grossières et il
manque les rambardes frontales qui ne sont pas livrées). Les bogies moteurs sont de conception entièrement nouvelle chez Jouef. Un berceau incliné supporte le moteur 5 pôles. L’arbre moteur est équipé
d’une vis sans fin qui attaque l’essieu moteur intérieur. L’autre essieu est entrainé par un train d’engrenages droits. La transmission conserve l’inconvénient des arrêts brutaux. Mais cette transmission a
l’avantage d’être silencieuse par rapport à toutes celles employées par Jouef jusque-là. C’est vu à l’époque comme un grand progrès.
Les BB 17000 et 25500 sont omniprésentes à la SNCF sur le trafic marchandise, souvent en double traction.
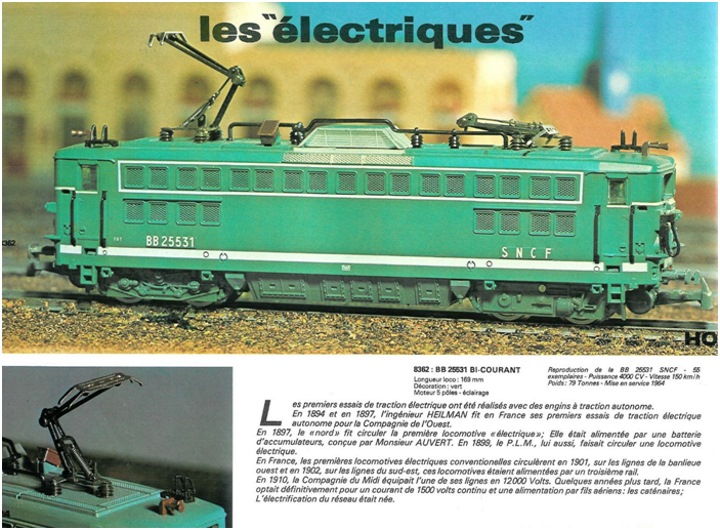 Les BB 25531, un beau modèle de la locomotive bi-courant. Pour la première fois, des palettes 1500V apparaissent chez Jouef pour son pantographe unijambiste qui est maintenant
bruni.
Les BB 25531, un beau modèle de la locomotive bi-courant. Pour la première fois, des palettes 1500V apparaissent chez Jouef pour son pantographe unijambiste qui est maintenant
bruni.
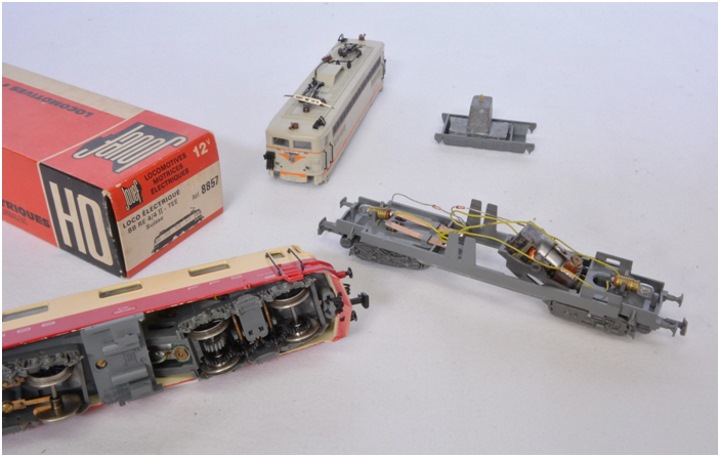 Nouvelle conception pour l’entrainement des essieux chez Jouef à partir de 1976. Le moteur 5 pôles est monté dans un berceau incliné et attaque l’essieu moteur intérieur par une vis
sans fin en nylon.
Nouvelle conception pour l’entrainement des essieux chez Jouef à partir de 1976. Le moteur 5 pôles est monté dans un berceau incliné et attaque l’essieu moteur intérieur par une vis
sans fin en nylon.
Après la 141P, Jouef fait une petite pose sur ses modèles vapeur. C’est une demi-nouveauté qui apparait en 1976. La reprise de la 140C apparue en 1968, dotée d’un tender type 34X. La 140C 180 est l’une des
dernières locomotives à vapeur à avoir circulé en France. Le tender 34X est apparu en 1926 à la Deutsche Reichsbahn attelé aux Pacific BR01. Construit à plusieurs milliers d’exemplaires, on le verra associé à
de nombreux types de locomotives allemandes dont les 150 BR 44 qui deviendront pour 239 d’entre elles, en France à la libération les 150X, dotées de leurs tenders 34X. L’amortissement de ces machines
permet la récupération de ces tenders à grande capacité et leurs affectations au 140C pour augmenter notablement leur autonomie. En miniature, Jouef va aussi reprendre sa locomotive pour doter la 140C de
d’une porte de boite à fumée type Est et d’un réchauffeur ACFI. Un certain nombre de perfectionnement sont apportés, un embiellage revu et bruni, une barre de relevage rapportée ainsi que les réservoirs et
tubulures rapportées du réchauffeur ACFI. Au départ, le moteur reste dans la locomotive, avec le système connu de Jouef
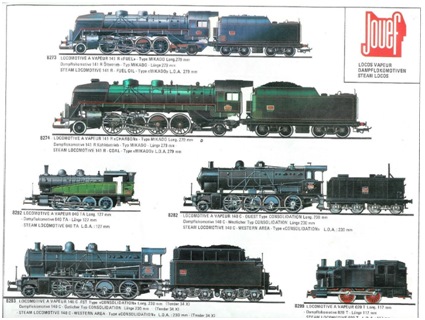 de transmission par courroie et vis sans fin. Mais plus tard, lorsque Jouef commercialise
sa 150X, c’est le tender qui deviendra moteur. Il faut dire qu’en 1976, l’apparition d’un tender 34X ajouté à la présence d’autres modèles allemands, laisse déjà bien supposer la mise en chantier d’une vapeur de la
DB. Déjà, le bogie arrière du tender est constitué pour recevoir un moteur. Ce sera chose faite en 1978.
de transmission par courroie et vis sans fin. Mais plus tard, lorsque Jouef commercialise
sa 150X, c’est le tender qui deviendra moteur. Il faut dire qu’en 1976, l’apparition d’un tender 34X ajouté à la présence d’autres modèles allemands, laisse déjà bien supposer la mise en chantier d’une vapeur de la
DB. Déjà, le bogie arrière du tender est constitué pour recevoir un moteur. Ce sera chose faite en 1978.
Le catalogue 1976 propose une seule semi-nouveauté du côté des machines à vapeur, la 140C à tender 34X à grande capacité. Le modèle de 140C classique est toujours disponible.
 Ce n’est pas un hasard si un tender 34X allemand apparait en 1976, c’est pour préparer la venue de la 150X (au fond) et de la BR 44 de la DB qui apparaitrons en 1978.
Ce n’est pas un hasard si un tender 34X allemand apparait en 1976, c’est pour préparer la venue de la 150X (au fond) et de la BR 44 de la DB qui apparaitrons en 1978.
 Les 140C compte parmi les dernières locomotives à vapeur à circuler en France. Elles ont connu le début de la période de modernisation de la SNCF comme ici en tractant les
nouveaux wagons couverts à bogies type Gas.
Les 140C compte parmi les dernières locomotives à vapeur à circuler en France. Elles ont connu le début de la période de modernisation de la SNCF comme ici en tractant les
nouveaux wagons couverts à bogies type Gas.
 La machine est améliorée avec une nouvelle porte de boite à fumée type Est, un embiellage affiné et bruni et l’ajout des réservoirs et tuyauteries du réchauffeur l’ACFI.
La machine est améliorée avec une nouvelle porte de boite à fumée type Est, un embiellage affiné et bruni et l’ajout des réservoirs et tuyauteries du réchauffeur l’ACFI.
Le Luxembourg est le carrefour ferroviaire entre la France, l’Allemagne et la Belgique. Pour son électrification, le pays est partagé entre le système 3000V continu Belge et le 25Kv alternatif français qui se rencontrent en gare commutable de la ville de Luxembourg. Lors de la signature du traité de canalisation de la Moselle, la France s’est engagée à fournir 20 locomotives au Luxembourg pour le dédommager. Ces machines sont en tous points similaires aux BB 12000, décoration d’origine y compris. Elles sont prélevées sur les chaines de fabrication destinées à la SNCF pour assurer le service sur la première section Luxembourg-Bettembourg mise sous tension en septembre 1956. Au début de leur carrière, ces machines sont entretenues au dépôt de Thionville. Les interpénétrations vers la France sont nombreuses. La livrée de ces machines a évolué au cours du temps. Le bleu bicolore est abandonné pour un gris bleu uniforme. Ensuite ce sera la belle livrée bordeaux et jaune à partir des années 70 et jusqu’en fin de carrière. Jouef, toujours à l’affût des marchés étrangers, a décliné sa BB 13000 en la décorant en 1976 aux couleurs bordeaux à bande jaune. Ce modèle, fabriqué jusqu’en 1979 est peu courant. Märklin a par contre décliné toutes les versions depuis 2003, du bleu deux tons d’origine, au gris uni et bien entendu les versions Bordeaux.
 La BB 9600 de Jouef est ici associée à la version luxembourgeoise de la voiture UIC de seconde classe.
La BB 9600 de Jouef est ici associée à la version luxembourgeoise de la voiture UIC de seconde classe.
Pour accompagner la BB 3609, jouef propose en matériel roulant deux nouveautés luxembourgeoises. Une immatriculation aux CFL de la voiture UIC à 9 compartiments en version 2ième classe et un couvert deux essieux UIC à parois lisse
 La BB CFL bénéficie d’une très belle décoration rouge lie de vin et jaune. On peut juste regretter les pantographes qui, en 1976 commencent à dater et le vide laissé dans la bande
jaune latérale par l’absence des plaques d’immatriculation. Cette échancrure ne figure pas sur l’illustration du catalogue 1976, conforme à la réalité.
La BB CFL bénéficie d’une très belle décoration rouge lie de vin et jaune. On peut juste regretter les pantographes qui, en 1976 commencent à dater et le vide laissé dans la bande
jaune latérale par l’absence des plaques d’immatriculation. Cette échancrure ne figure pas sur l’illustration du catalogue 1976, conforme à la réalité.
 Märklin a aussi reproduit ce modèle de locomotive Luxembourgeoise dans toutes ses évolutions au cours du temps. Livrées en 1956, elle adopte dans un premier temps la livrée bleu
électrique bicolore identique à la SNCF. Elle arbore ensuite une couleur gris uniforme, puis la superbe livrée bordeaux et jaune au cours des années 70.
Märklin a aussi reproduit ce modèle de locomotive Luxembourgeoise dans toutes ses évolutions au cours du temps. Livrées en 1956, elle adopte dans un premier temps la livrée bleu
électrique bicolore identique à la SNCF. Elle arbore ensuite une couleur gris uniforme, puis la superbe livrée bordeaux et jaune au cours des années 70.
 Le trio des fers à repasser de Jouef. Au fond la BB 13001 d’origine de 1965 en décoration verte. A partir de 1976 apparait la version bleue. Elle est détaillée avec une ligne de toiture
rapportée, des rambardes d’extrémité et de cabines rapportées.
Le trio des fers à repasser de Jouef. Au fond la BB 13001 d’origine de 1965 en décoration verte. A partir de 1976 apparait la version bleue. Elle est détaillée avec une ligne de toiture
rapportée, des rambardes d’extrémité et de cabines rapportées.
 La mécanique aussi a changé. Le moteur est toujours dans la soute des transformateurs. En 1976 c’est une transmission par courroie qui remplace les engrenages. Sur la version
1976, l’éclairage est réversible, des deux côtés.
La mécanique aussi a changé. Le moteur est toujours dans la soute des transformateurs. En 1976 c’est une transmission par courroie qui remplace les engrenages. Sur la version
1976, l’éclairage est réversible, des deux côtés.
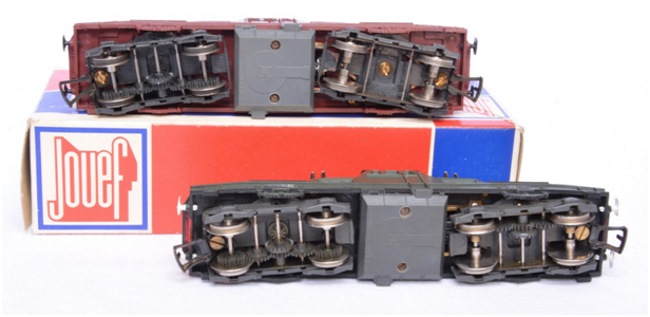 La transmission passe de 4 essieux moteurs sans bandages d’adhérence en 1965, à deux essieux moteurs bandagés en 1976.
La transmission passe de 4 essieux moteurs sans bandages d’adhérence en 1965, à deux essieux moteurs bandagés en 1976.
 La nouveauté marchandise de 1976 est cette version du couvert à parois lisse, ici en décoration grise CFL.
La nouveauté marchandise de 1976 est cette version du couvert à parois lisse, ici en décoration grise CFL.
 Pour accompagner la BB la voiture UIC de seconde classe et le couvert à deux essieux gris immatriculé au CFL. La nouveauté marchandise de 1976 est cette version du couvert à
parois lisses qui complète la version à frise de bois datant de 1962. Hormis les versions SNCF, le premier est décliné en immatriculation DB, SNCB et CFL. Le second en version NS, CFF et CFL.
Pour accompagner la BB la voiture UIC de seconde classe et le couvert à deux essieux gris immatriculé au CFL. La nouveauté marchandise de 1976 est cette version du couvert à
parois lisses qui complète la version à frise de bois datant de 1962. Hormis les versions SNCF, le premier est décliné en immatriculation DB, SNCB et CFL. Le second en version NS, CFF et CFL.
 Nouveauté 1976, le couvert UIC à parois lisse ici en version SNCF décoré aux couleurs de la Sernam (Service National des Messageries). C’était une société de transport de bagages
et de colis (crée en 1970) qui était un service de la SNCF jusqu’en 2002, puis une filiale avant d’être privatisée en 2012 ;
Nouveauté 1976, le couvert UIC à parois lisse ici en version SNCF décoré aux couleurs de la Sernam (Service National des Messageries). C’était une société de transport de bagages
et de colis (crée en 1970) qui était un service de la SNCF jusqu’en 2002, puis une filiale avant d’être privatisée en 2012 ;
Le catalogue 1976 fourmille de nouvelles décorations de locomotives dans de curieuses versions peu connues de réseaux étrangers. On peut citer dans les modèles réellement entrés en production :
- La CC 40100 en version Belge type 1800 de la SNCB
- La BB 13000 en livré des CFL présentée ci-dessus
- La CC 7100 au couleur des chemins de fer espagnole RENFE, type CC 7600
- La CC 7100 aux nouvelles couleurs des chemins de fer Hollandais NS type CC 1300 (la version grise et jaune remplace l’ancienne version bleu commercialisée de 1966 à 1968)
- La BB diesel électrique D6100 des chemins de fer britannique BR (une vielle connaissance, fabriquée à partir de 1962 pour Playcraft qui réapparait en décoration moderne bleu)
- La BB 15000 en version portugaise des CP type BB 038
- La CC 6500 en livrée des chemins de fer Marocain type CC 900 ONCF
- La CC diesel 7200 aux couleurs des chemins de fer Marocain type CC 100 ONCF
- Le locotracteur diesel de manœuvre à 2 essieux Y 51130 aux couleurs des chemins de fer britanniques BR
Mais il y aura aussi de mystérieux modèles, à ma connaissance jamais produits :
- La BB 15000 en version portugaise des CP type BB 038
- La CC 6500 en livrée des chemins de fer Marocain type CC 900 ONCF
- La CC diesel 7200 aux couleurs des chemins de fer Marocain type CC 100 ONCF
 Avec un total de 342 exemplaires vendus, les CC Alsthom dérivées des CC 7100 se retrouvèrent à circuler dans de nombreux pays. Outre les versions pour la Hollande et la France Proposées depuis 1966, Jouef
propose le modèle espagnol en 1976. L’Espagne fût un client important avec pas moins de 136 exemplaires livrés. Notez la jupe spécifique qui a nécessité une modification du moule.
Avec un total de 342 exemplaires vendus, les CC Alsthom dérivées des CC 7100 se retrouvèrent à circuler dans de nombreux pays. Outre les versions pour la Hollande et la France Proposées depuis 1966, Jouef
propose le modèle espagnol en 1976. L’Espagne fût un client important avec pas moins de 136 exemplaires livrés. Notez la jupe spécifique qui a nécessité une modification du moule.
 Pour faire face à l’augmentation du trafic, la SNCB commande 6 locomotives dérivées des CC 40100 en 1973. Les versions Belges série 18 sont décorées de parement bleu et ne
possèdent que 3 pantographes. A part ces points, elles sont en tous points identiques aux 10 exemplaires de la SNCF. Jouef va reproduire ce modèle de 1976 à 1980.
Pour faire face à l’augmentation du trafic, la SNCB commande 6 locomotives dérivées des CC 40100 en 1973. Les versions Belges série 18 sont décorées de parement bleu et ne
possèdent que 3 pantographes. A part ces points, elles sont en tous points identiques aux 10 exemplaires de la SNCF. Jouef va reproduire ce modèle de 1976 à 1980.
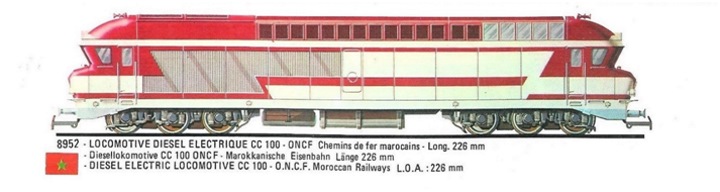


Les trois modèles du catalogue 1976, vraisemblablement jamais commercialisés par Jouef, de haut en bas ; La CC diesel des chemins de fer Marocain type 100 ONCF, La CC électrique des chemins de fer
Marocain type 900 ONCF, la BB portugaise type 038 des CP.
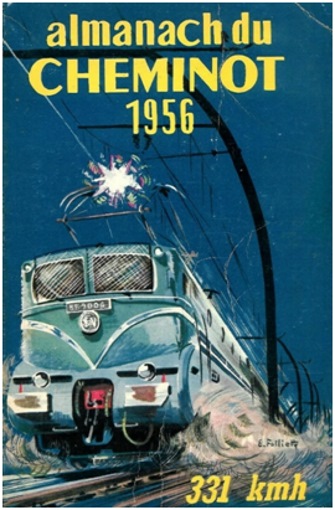
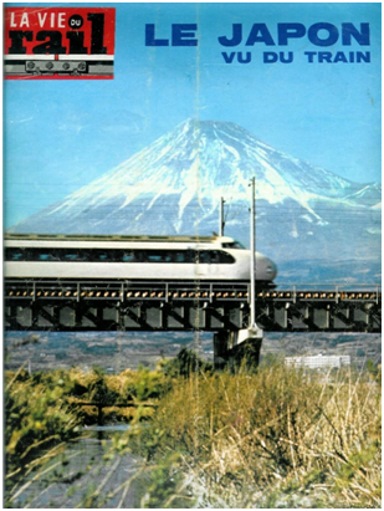 Forte de l’expérience du record avec BB 9004 de 1955, la SNCF est intéressée par les vitesses commerciales de plus de 210 km/h pratiquées au Japon du Shinkansen au tout
début des années 60.
Forte de l’expérience du record avec BB 9004 de 1955, la SNCF est intéressée par les vitesses commerciales de plus de 210 km/h pratiquées au Japon du Shinkansen au tout
début des années 60.
Après la série des records des années 50, la France se cherche sur la question de la vitesse ferroviaire. Il y a bien l’exemple des japonais qui lancent en 1958 leur programme d’infrastructures nouvelles, à grande vitesse le Shinkansen entre Tokyo et Osaka. Les rames de première génération roulent en vitesse commerciale à 210km/h. Mais en France, la vitesse commerciale est limitée par des interdictions. Jusqu’en 1953 c’est 120km, puis 150km/h en 1957. C’est le Capitole qui permettra de la relever à 200km/h en 1967. Quoi faire ensuite ? C’est Edgar Pisani, ministre de l’équipement du gouvernement Pompidou entre 1966 et 1967 qui va donner le feu vert à Mr Ségalat, alors président de la SNCF pour l’étude de rames à grandes vitesse. Pour débuter l’expérience, une rame d’autorail EAD est équipé d’une turbineTurboméca Turmo (d’un modèle proche de celles qui équipent les hélicoptères Super Frelon). Cela deviendra le TGS (Turbine à Gaz Spécial). Les essais du TGS débutent en avril 1967. Son record de vitesse s’établira à 252km/h. Pour poursuivre le développement de son futur train rapide, le TGV 001 est révolutionnaire dans sa définition à la SNCF. Il cumule la conception articulée, une motorisation par turbine, une transmission électrique et une motorisation répartie sur toute la rame. La turbine semble être la bonne solution. Son appétit n’est pas un souci à l’époque du pétrole pas cher. Les économies sur l’infrastructure des lignes nouvelles, en l’absence d’électrification sont substantielles. Le TGV 001 atteint 318km/h en décembre 1972, ce qui reste le record de vitesse pour un engin à traction autonome. La crise pétrolière va couper les ailes à la propulsion par turbine. C’est la traction électrique qui est choisie par la SNCF en 1974 pour ses futurs TGV. Mais la turbine n’est pas abandonnée pour autant. La SNCF commande 41 rames RTG (Rame à Turbine à Gaz). Elles sont livrées entre 1972 et 1976. Les compositions sont homogènes à 5 caisses (exceptionnellement 6). Les deux motrices encadrent une voiture de1iere, une voiture bar-restauration et une voiture de seconde. La livrée est nouvelle, de l’orange (qui sera à la mode avec les premier TGV) associé au gris argent. Les RTG ont réussi l’exploit d’être exportés aux USA ainsi qu’en Iran et en Egypte dans des versions améliorées prévues pour 200km/h. Mais le bruit des turbines, leur consommation et les coûts d’entretien élevés feront que ce matériel est retiré du service par la SNCF en 2004. Ce sera la fin de l’intermède de ce mode de traction hérité de l’aviation.
 La rame de turbotrain de Jouef, vedette des années 70, symbole de vitesse et de modernité.
La rame de turbotrain de Jouef, vedette des années 70, symbole de vitesse et de modernité.
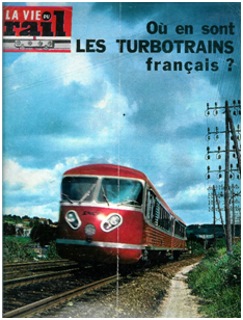
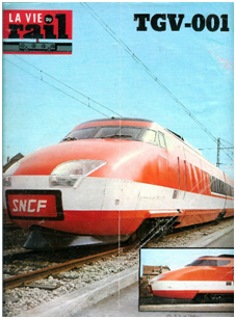
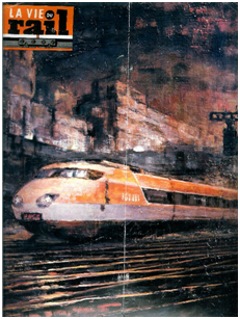 Vedette des couvertures de la vie du rail, de gauche à droite le TGS en 1968, le TGV 001 en 1972 et 1976.
Vedette des couvertures de la vie du rail, de gauche à droite le TGS en 1968, le TGV 001 en 1972 et 1976.
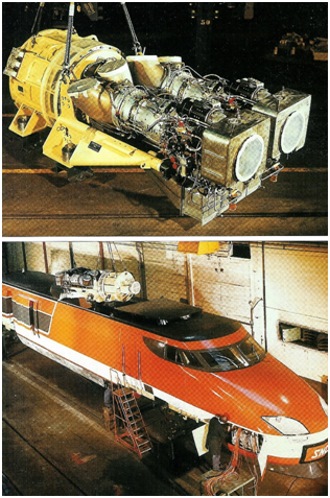
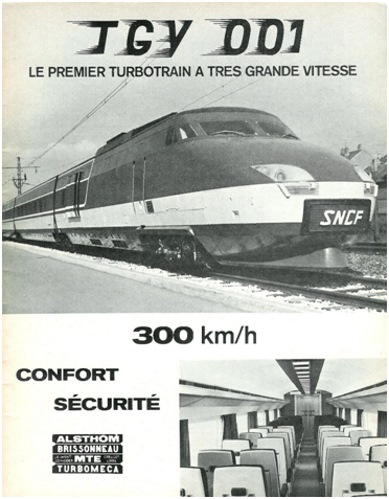 Installation des groupes propulseurs Turmo à l’usine de Belfort et publicité du constructeur Alsthom dans l’IDR de septembre 1972.
Installation des groupes propulseurs Turmo à l’usine de Belfort et publicité du constructeur Alsthom dans l’IDR de septembre 1972.
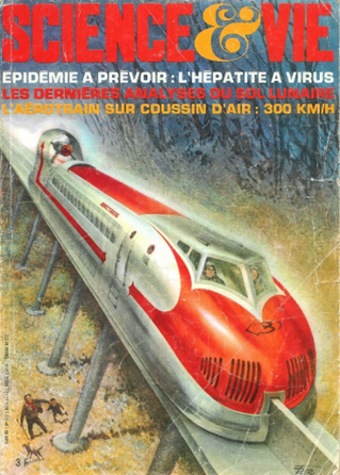
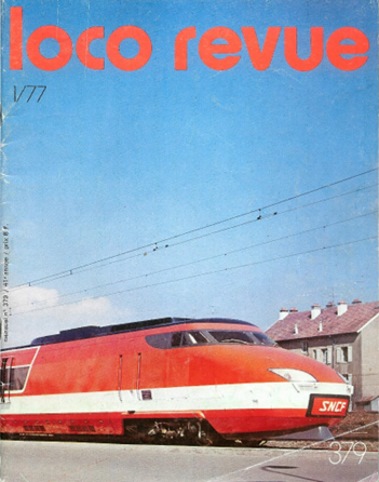
Le projet d’aérotrain de la société Bertin (à gauche) va longtemps faire hésiter le gouvernement français sur la formule à choisir pour la grande vitesse. Un véhicule expérimental atteint
345km/h en 1967. Le guidage se faisait par l’intermédiaire d’un coussin d’air afin de réduire les frottements. Deux types de propulsion sont expérimentés, issus de l’aviation ; la turbine avec hélice ou le réacteur.
Le ministère des transports commandite en 1968 la construction d’un tronçon de 20km, établi en voie béton aérienne en forme de T partant des environs d’Orléans. Il était prévu d’établir une première ligne
Paris-Orléans pour des vitesses de 250km/h. S’il est techniquement séduisant, le système a des gros inconvénients. Il nécessite de nouvelles infrastructures spécifiques, il est bruyant, énergivore et de capacité
limitée. Impossible avec lui d’atteindre le centre des villes françaises. Aussi le gouvernement donnera finalement le feu vert à la SNCF pour sa première ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, sur une
infrastructure nouvelle mais classique, reliée au réseau existant. Point commun avec l’aérotrain, le TGV 001 doit au départ son mode de propulsion à l’aviation avec les turbines. Mais la crise pétrolière va conduire
en 1974 à un retour raisonnable vers l’électricité, d’autant qu’en parallèle la France construit son important programme électronucléaire. Le slogan de l’époque « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées » sera
fatale à la turbine à terme dans le domaine ferroviaire.
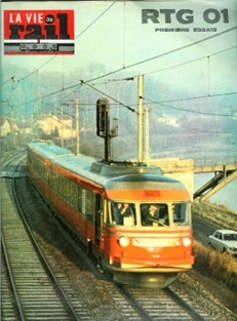
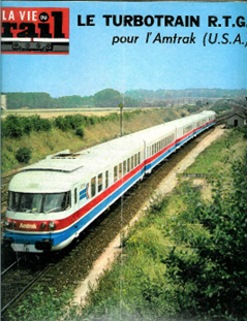
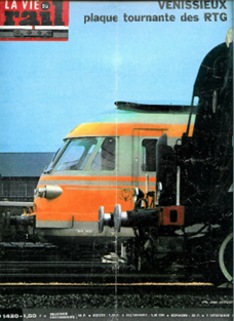 La Vie du rail de février 1973 présente le prototype du RTG composé seulement de trois éléments et doté de tampons carénés. Au centre, le RTG version américaine lors des essais
sur sol français et dont 10 unités seront livrées à l’Amtrak à partir de 1973. A droite, les premiers RTG ont encore cotoyé la fin de la vapeur.
La Vie du rail de février 1973 présente le prototype du RTG composé seulement de trois éléments et doté de tampons carénés. Au centre, le RTG version américaine lors des essais
sur sol français et dont 10 unités seront livrées à l’Amtrak à partir de 1973. A droite, les premiers RTG ont encore cotoyé la fin de la vapeur.
Encore une fois Jouef est au rendez-vous, il reproduit la rame RTG complète, soit 5 éléments différents à partir de 1976. Elle comprend motrice, fausse motrice sans moteur, voiture de 1ière clase, 1ière/2 classe et restaurant. La rame est à l’échelle, finement détaillée et décorée en gris/argent. Les attelages à élongation permettent un accouplement rapproché. Le moteur est situé dans le plancher et la transmission est réalisée pour la première fois par un arbre et des cardans. Il manque seulement un aménagement intérieur. Il y aura aussi une version d’exportation pour la compagnie Amtrak aux couleurs de l’Amérique disponible entre 1976 et 1978. Ce modèle est devenu assez rare.
 L'imposante rame RTG de Jouef nécessite de par sa longueur un grand réseau pour être correctement mis en valeur.
L'imposante rame RTG de Jouef nécessite de par sa longueur un grand réseau pour être correctement mis en valeur.
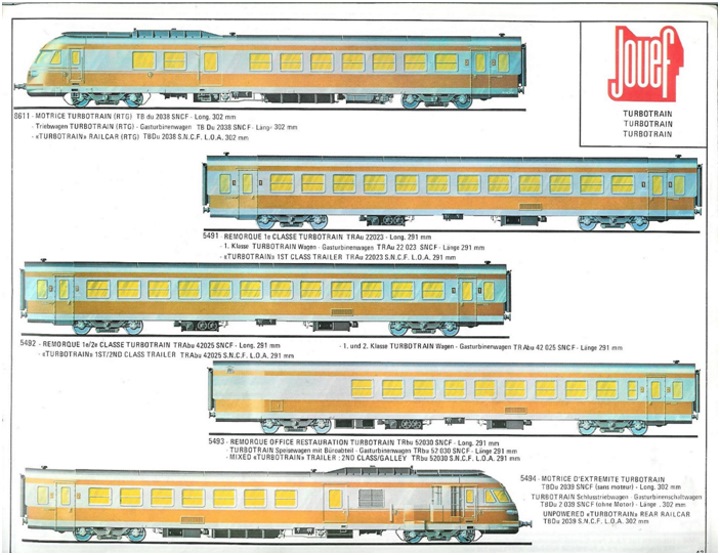 Le catalogue Jouef 1975/76 annonce la couleur avec pas moins de 5 références.
Le catalogue Jouef 1975/76 annonce la couleur avec pas moins de 5 références.
 Les différents éléments composant la rame RTG dont les motrices et fausse motrice. Notez les deux types de boites en Polystyrène expansé (jusque 1977) et à fenêtre et tiroir en
carton, à partir de cette date.
Les différents éléments composant la rame RTG dont les motrices et fausse motrice. Notez les deux types de boites en Polystyrène expansé (jusque 1977) et à fenêtre et tiroir en
carton, à partir de cette date.
 Succès à l’exportation pour la France qui livre à la compagnie américaine Amtrak 10 rames de turbotrain.
Succès à l’exportation pour la France qui livre à la compagnie américaine Amtrak 10 rames de turbotrain.
 Jouef va reproduire en 1976 le turbotrain américain aux couleurs bleu, blanc et rouge sous la référence 8998 pour la motrice et 5893 à 5895 les remorques et la fausse motrice.
Jouef va reproduire en 1976 le turbotrain américain aux couleurs bleu, blanc et rouge sous la référence 8998 pour la motrice et 5893 à 5895 les remorques et la fausse motrice.
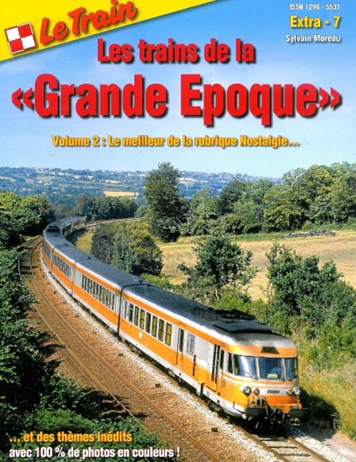
La télécommande Jouefmatic est née en 1968 sous l’ère du transistor. Depuis l’électronique a fait des progrès et de nouveaux composants se démocratisent comme le Thyristor. Jouef va revoir sa télécommande avec une nouvelle version Jouefmatic 76. Cette nouvelle version se caractérise par des récepteurs plus compacts (lorsqu’on les sort de leurs boitiers), une meilleure fiabilité avec moins d’interférences et une plus grande puissance de traction. Le circuit de voie est désormais alimenté en 22V au lieu de 14V. Les émetteurs sont alimentés par un transfo indépendant en 16V et leur signal est superposé au courant de traction. Il y a donc maintenant 2 types de transformateurs T2 et T3 réunis par boitier dit « Coupleur » Les boitiers émetteurs nouvelle formule sont maintenant monocanaux disponibles en 8 références (auparavant il y avait deux types d’émetteurs commutables sur 4 canaux différents). On peut toujours commander 8 locomotives indépendamment. Le nouveau système est compatible avec l’ancien Jouefmatic moyennant un boitier adaptateur. Le nouveau système, de par sa puissance, est maintenant capable d’équiper des moteurs plus puissants des modèles d’autres marques (jusque 1 ampère). Le nouveau décodeur peut être monté dans le tender d'une locomotive à vapeur. Ainsi le jouefmatic 76 devient maintenant un système universel, puissant et fiable.

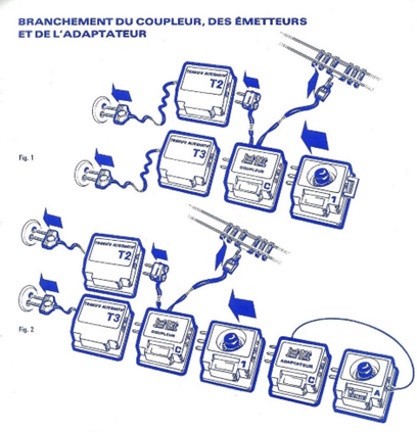 Le nouveau Jouefmatic 76 est composé de 3 nouveaux éléments à raccorder aux émetteurs, les transformateurs T2 et T3 et le coupleur. Les
émetteurs ne sont plus commutables, mais livrés en 8 versions pour les 8 canaux. Si l’on veut utiliser les anciens émetteurs et récepteurs Jouefmatic il faut
interfacer un adaptateur (qui ne fonctionnera uniquement avec les émetteurs de la génération à boitier rouge, les premiers à boitiers gris, ne sont pas
compatibles)
Le nouveau Jouefmatic 76 est composé de 3 nouveaux éléments à raccorder aux émetteurs, les transformateurs T2 et T3 et le coupleur. Les
émetteurs ne sont plus commutables, mais livrés en 8 versions pour les 8 canaux. Si l’on veut utiliser les anciens émetteurs et récepteurs Jouefmatic il faut
interfacer un adaptateur (qui ne fonctionnera uniquement avec les émetteurs de la génération à boitier rouge, les premiers à boitiers gris, ne sont pas
compatibles)
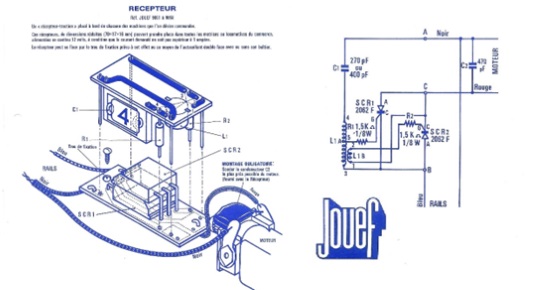
En plus des modèles spécifiques pour le marché allemand et des variantes extrapolées de modèles français pour divers pays européens, Jouef s’attaque aussi au marché Suisse avec une RE 4/4 II spécialement conçue pour ce pays. En réalité, ces machines destinées à la traction en plaine de convois rapides voyageurs et messagerie sont aussi utilisés en double traction sur les lignes de montagne. Développant pas moins de 6320CV pour une masse de 80t elles affichent une vitesse maximum de 140km/h. Construites à 276 exemplaires par SLM BBC Oberlikon à partir de 1964, c’est la plus importante série de locomotives Suisse en 1976. A partir de 1969, 9 exemplaires seront peintes aux couleurs TEE, notamment pour assurer en Suisse la traction du célèbre Rheingold (l’Or du Rhin). Jouef va reproduire en 1976 les deux versions ; verte et rouge et crème TEE. Le mode de construction est identique aux BB 17000 et 25500 sortis la même année. Le moteur est monté sur un berceau incliné en porte à faux et attaque directement le premier essieu moteur. La finition de ces modèles est flatteuse. La gravure des bogies est très belle et met en valeur, pour la première fois sur une électrique de Jouef, de très belles roues à rayons. Un modèle très réussi qui met en évidence le savoir-faire de Jouef au milieu des années 70.
 La REE 4/4 en version TEE réf 8857 est apte à tracter le Rheingold sur son parcours en Suisse (ici des voitures Märklin).
La REE 4/4 en version TEE réf 8857 est apte à tracter le Rheingold sur son parcours en Suisse (ici des voitures Märklin).

 Le catalogue 1976 présente les deux versions de la RE 4/4 II et les voitures Suisses (plus une version en décoration Autrichienne)
Le catalogue 1976 présente les deux versions de la RE 4/4 II et les voitures Suisses (plus une version en décoration Autrichienne)
 Les locomotives Jouef de 1976 sont toutes dotées de lignes de toiture détaillées, de rambardes en plastique et divers accessoires comme les avertisseurs ou des disjoncteurs rapportés.
Les locomotives Jouef de 1976 sont toutes dotées de lignes de toiture détaillées, de rambardes en plastique et divers accessoires comme les avertisseurs ou des disjoncteurs rapportés.
Commandées par les chemins de fer fédéraux Suisses pour rajeunir leur parc au début des années 70, les voitures type X UIC de 26m400 sont destinées au trafic international des express et des rapides. On peut aussi les voir dans les pays limitrophes de la Suisse et notamment en France. Jouef reproduit à partir de 1976 trois types ; 1ière classe Am, mixte 1ière /2ième classe Abm et 2ième classe Bm. Ces voitures sont rigoureusement à l’échelle et mesure 306mm hors tampons. Leurs caisses sont différentes, et respectent strictement la disposition particulière des baies. Les bogies de type Suisse sont bien gravés, mais pour permettre le passage des barres d’attelages rigides, les marchepieds sous les portes sont absents. Jouef utilise pour ce wagon sa technique habituelle ; le châssis est moulé avec le vitrage, le verrouillage est assuré par les cadres en relief des baies, ce qui rend le démontage difficile. Il est toutefois nécessaire si on veut installer un aménagement intérieur (absent) ou un éclairage.
 Les nouvelles voitures Suisses sont parfaitement à l’échelle et superbement décorées.
Les nouvelles voitures Suisses sont parfaitement à l’échelle et superbement décorées.
Jouef comble les modélistes à la fin des années 70. Pour 1977 le dépliant des nouveautés comporte pas moins de 12 pages et à nouveau une cinquantaine de nouveautés dont 7 locomotives et 11 voitures.
Le point majeur est la nouvelle plaque tournante associé à la rotonde modulaire de P.
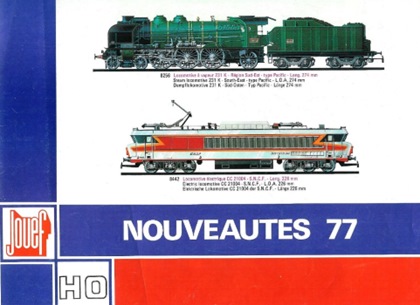 Mais Jouef connait aussi ses première difficultés. Les circuits de voitures et les coffrets de trains ont du mal à se vendre.
Une première vague de licenciement touche 200 personnes. Les ateliers d’injection ne tournent plus en 3X8, mais en horaire normal. Les travailleurs à domicile sont les premiers à être touchés. L’espoir est
toujours là, mais la menace s’installe.
Mais Jouef connait aussi ses première difficultés. Les circuits de voitures et les coffrets de trains ont du mal à se vendre.
Une première vague de licenciement touche 200 personnes. Les ateliers d’injection ne tournent plus en 3X8, mais en horaire normal. Les travailleurs à domicile sont les premiers à être touchés. L’espoir est
toujours là, mais la menace s’installe.
La brochure des nouveautés 1977 ne fait pas moins de 12 pages.
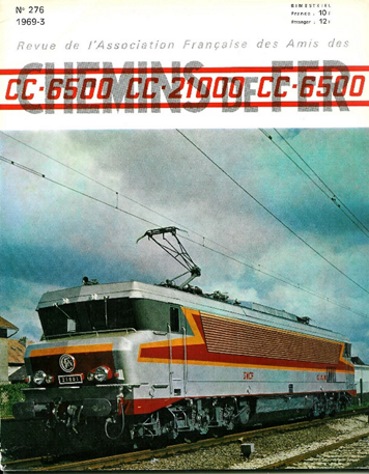
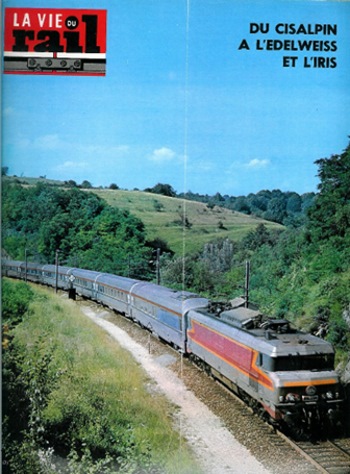 Les revues Chemin de Fer et la vie du rail mettent en avant la CC 21000 qui est une machine au sommet de la technique au début des années 70. Elles sont principalement affectées
aux lignes du jura, qui assurent la traction des trains rapides vers la Suisse comme le Cisalpin.
Les revues Chemin de Fer et la vie du rail mettent en avant la CC 21000 qui est une machine au sommet de la technique au début des années 70. Elles sont principalement affectées
aux lignes du jura, qui assurent la traction des trains rapides vers la Suisse comme le Cisalpin.
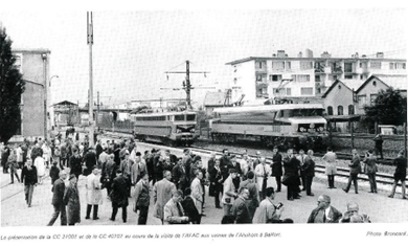
 La CC 21001 de fabrication Alsthom MTE, est présentée aux visiteurs de l’AFAC en 1969, alors que la seconde série de CC 40100 est aussi en cours de fabrication (à gauche).
A droite, le hall de montage du département traction de l’usine Alsthom de Belfort avec les deux premières CC 21000 en cours de montage. On voit à l’arrière des diesels CC 7200 en cours de montage (Photo de
droite).
La CC 21001 de fabrication Alsthom MTE, est présentée aux visiteurs de l’AFAC en 1969, alors que la seconde série de CC 40100 est aussi en cours de fabrication (à gauche).
A droite, le hall de montage du département traction de l’usine Alsthom de Belfort avec les deux premières CC 21000 en cours de montage. On voit à l’arrière des diesels CC 7200 en cours de montage (Photo de
droite).
Avec les CC de la famille des 65000, la SNCF effectue un retour vers les bogies à 3 essieux formule abandonnée, depuis une dizaine d’années pour les motrices électrique classiques. Avec les BB de types 9200 ou16000, la SNCF pouvait se satisfaire de puissance de l’ordre de 5000cv pour des vitesses de 160 km/h. Mais pour tracter des trains plus lourds à des vitesses allant jusque 200km/h, il en faut plus, jusque 8000cv, tout en respectant la charge maximale de 21t par essieu. Dans ce cadre, avec les techniques de la fin des années 60, il faut revenir à la formule CC. De 1969 à 1975, la SNCF intègre 75 exemplaires de la CC 6500. Elles sont destinées au réseau équipé en caténaire 1500V courant continu. La SNCF prévoyait en 1969 une version destinée au courant alternatif monophasé 25000V alternatif, c’était la CC 14500, mais celle-ci ne verra jamais le jour. Entre les deux il y aura une version bicourant, la CC 21000. Mais cette dernière, développant autour de 8000cv, ne sera construite qu’à 4 exemplaires, en deux 'petite-série' entre 1969 et 1974. Extérieurement, les deux séries se distinguent par leurs persiennes extérieures, horizontales sur les CC 21001 à 2 et en inox verticales sur les deux derniers exemplaires. Elles possèdent aussi 3 pantographes, ce qui les distingue des CC 6500.
 La CC 21004 de 1977. Si la gravure des flancs est correcte, l’ensemble déçoit un peu. A cette époque, Jouef sait mieux faire. L’échancrure des bogies, (comme visible à droite) hérités
de la CC 40100 datant de 1965 n’arrange pas les choses.
La CC 21004 de 1977. Si la gravure des flancs est correcte, l’ensemble déçoit un peu. A cette époque, Jouef sait mieux faire. L’échancrure des bogies, (comme visible à droite) hérités
de la CC 40100 datant de 1965 n’arrange pas les choses.
Jouef va reproduire la dernière série avec la CC 21004 à persienne inox. Pour cela, elle reprend la base et le châssis de sa CC 6500 sortie en 1971. Ensemble moteur transmission et bogie reste inchangé. Les persiennes sont gravées et la toiture détaillée. Mais les pantographes extrêmes devraient être bi palettes, hors ce n’est pas le cas. Les échancrures dans les flancs de bogie n’avantagent pas cette locomotive qui ne restera pas dans les annales de la production de Jouef. En 1977, elle est d’un réalisme en retrait par rapport à ce que la firme sait faire. Comme la 6500, la CC 21000 sera totalement reprise en 1992 avec des caractéristiques nouvelles ; châssis zamac et moteur Bühler. Une autre histoire.
La première Pacific française (disposition d’essieux 231) est apparue en 1907 avec la série 4500 de la compagnie Paris-Orléans. Mais immédiatement après, il y aura celle du PLM, également dénommée
« Pacific Sud-Est ». L’histoire débute au PLM en 1909 par la construction de deux prototypes : la 6001 compound à 4 cylindres et la 6101 à simple expansion. Viendra ensuite la descendance de la 6001 avec,
en 1912, la commande de 85 exemplaires de ce qui deviendra la 231C.
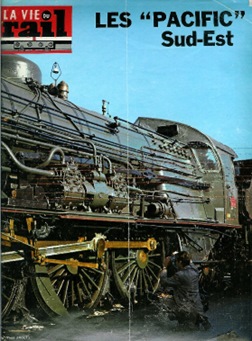 Puis ce seront, en 1921 les 231 D et F qui seront transformées en 231 G et H dans les années 30, suite à des modifications du circuit
vapeur. La lettre K est attribuée lors de la transformation des 231C. Mais le PLM commande également des versions à simple expansion, les 231 A et B. Avec une vitesse maximale de 130 km/h et une puissance
variant entre 2300 et 2600 ch. environ, elles sont toutes aptes à tracter les trains de plus en plus lourds. Avec l’arrivée des voitures métalliques, le poids d’une voiture passe alors d’une vingtaine de tonnes à plus
de 40t. Un train passe ainsi de 200t à 400 voire 500t. Pour ce type de traction, la Pacific Sud-Est est à l’aise. Elle a tracté les trains les plus célèbres et couvert tout le réseau Français au lendemain de la seconde
guerre mondiale. De toutes les Pacific françaises, c’est elle qui détient le record du nombre, avec 462 exemplaires. Ce sera aussi le dernier modèle de 231 à circuler à la SNCF en 1969.
Puis ce seront, en 1921 les 231 D et F qui seront transformées en 231 G et H dans les années 30, suite à des modifications du circuit
vapeur. La lettre K est attribuée lors de la transformation des 231C. Mais le PLM commande également des versions à simple expansion, les 231 A et B. Avec une vitesse maximale de 130 km/h et une puissance
variant entre 2300 et 2600 ch. environ, elles sont toutes aptes à tracter les trains de plus en plus lourds. Avec l’arrivée des voitures métalliques, le poids d’une voiture passe alors d’une vingtaine de tonnes à plus
de 40t. Un train passe ainsi de 200t à 400 voire 500t. Pour ce type de traction, la Pacific Sud-Est est à l’aise. Elle a tracté les trains les plus célèbres et couvert tout le réseau Français au lendemain de la seconde
guerre mondiale. De toutes les Pacific françaises, c’est elle qui détient le record du nombre, avec 462 exemplaires. Ce sera aussi le dernier modèle de 231 à circuler à la SNCF en 1969.
La Vie du Rail du 24 décembre 1972 reprend en détail l’histoire des Pacific Sud-Est.
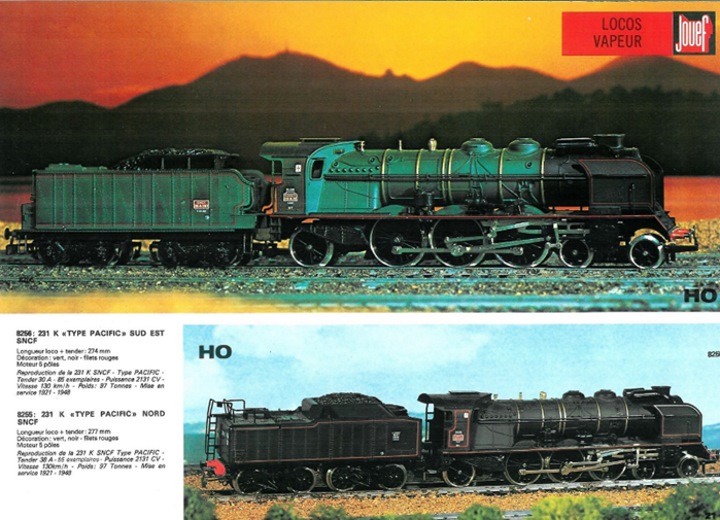 Le catalogue Jouef 1978 illustre la Pacific 231K avec ses deux types de tender Nord en bas et PLM en haut.
Le catalogue Jouef 1978 illustre la Pacific 231K avec ses deux types de tender Nord en bas et PLM en haut.
 Les deux modèles côte à côte. Mon exemplaire doté d’un tender Nord a été patiné et n’est plus entièrement d’origine.
Les deux modèles côte à côte. Mon exemplaire doté d’un tender Nord a été patiné et n’est plus entièrement d’origine.
La 231 K 82 à tender Nord est sortie en 1973. C’était la seconde Pacific de la marque, après la célèbre 231C de 1960. Elle apparaît tout d’abord avec un tender de type Nord, 38A. L’utilisation de ce dernier, commun à la 241P de 1971 permet de lisser les investissements. Ce modèle est dans la lignée des vapeurs de la marque, bien détaillée, décorée de fin filets, dotée d’un embiellage complet. Suivant la technique de Jouef, c’est le tender qui est moteur. Si l’on reprend l’histoire, à la SNCF, c’est au fil des réformes des 231C, que les Pacific Sud-Est sont équipées du tender Nord à la place de celui d’origine PLM. Ainsi la capacité passe de 30m3 et 7t de charbon, à 38m3 et 9t de charbon. Un gain appréciable pour éviter de faire de l’eau en gare ou de changer de machine en cours de trajet. En 1977 Jouef présente sa 231K72 dotée cette fois d’un tender d’origine de type 30A ex PLM. La locomotive K72 est quasiment identique à la version K82 excepté les inscriptions et une nouvelle boite à fumée version Sud-Est à la place de la version Nord. Pour son nouveau tender 30A Jouef a repris intégralement le châssis du tender 30R des 141R. Cette solution économique provoque quelques petites entorses vis-à-vis du respect de l’échelle. Les habillages de bogie et la caisse sont bien sur entendu nouveaux. La gravure est très fine avec des lignes de rivets exactes et complètes.
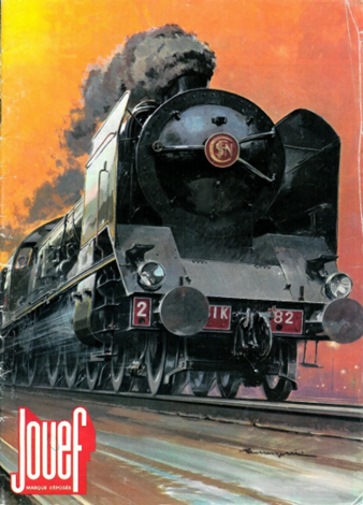
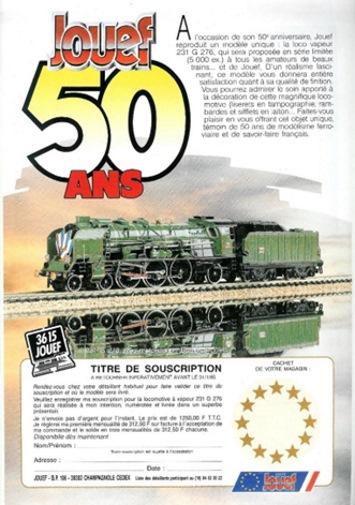 Les Pacific PLM ont marqué l’histoire de Jouef depuis la sortie du modèle que l’on voit en couverture du catalogue 1973 et jusqu’à l’anniversaire de la marque, en 1994.
Les Pacific PLM ont marqué l’histoire de Jouef depuis la sortie du modèle que l’on voit en couverture du catalogue 1973 et jusqu’à l’anniversaire de la marque, en 1994.
Puis un modèle « Série collectionneur » est proposé en 1980. Cette version dépourvue de motorisation, est dorée, façon laiton. Elle est présentée dans une belle vitrine en plexiglas, sur un socle de bois. A poser dans son salon comme élément décoratif ou au travail, sur son bureau. Début des années 90 Jouef lance la série Club avec une version 231G104 accompagnée d’un tender 30A. Il est alors équipé du TIA (Traitement Intégral Armand), système de traitement chimique de l’eau pour éviter l’entartrage des chaudières. Autre différence, la présence d’un éclairage rouge sur le tender. En 1994, pour fêter ses 50 années d’existence, Jouef sortira 5000 exemplaires d’une version spéciale de la 231G 276. On pouvait la commander par le Minitel (en composant le 3615 Jouef) pour 1250 F de l’époque. Elle était dotée de drapeaux tricolores à l’avant, à l’image des machines qui tractaient les trains des princes et des présidents par le passé. En 1997, c’est une version Club qui sortira sous l’immatriculation K8, toujours équipée d’un tender Nord, mais encore plus détaillée.
 La Pacific 231K de Jouef en pleine vitesse en tête d’un rapide.
La Pacific 231K de Jouef en pleine vitesse en tête d’un rapide.
 Le modèle d’exposition couleur or de la « série collectionneur » commercialisé en 1980.
Le modèle d’exposition couleur or de la « série collectionneur » commercialisé en 1980.
 Toute la panoplie des versions de Pacific Sud-Est proposées par Jouef de 1973 à 2001, associées au tender PLM ou Nord. Les versions de série sont à droite, Collectionneur au fond,
Club ou Anniversaire à gauche et au premier plan.
Toute la panoplie des versions de Pacific Sud-Est proposées par Jouef de 1973 à 2001, associées au tender PLM ou Nord. Les versions de série sont à droite, Collectionneur au fond,
Club ou Anniversaire à gauche et au premier plan.
 Pour ses modèles Club Jouef reprend la gravure de certains détails. Ils sont aussi équipés d’un éclairage par LED, dont les modèles de série n’étaient pas dotés. Notez les deux types
de boite à fumée utilisés, le type Nord à gauche et Sud-Est à droite.
Pour ses modèles Club Jouef reprend la gravure de certains détails. Ils sont aussi équipés d’un éclairage par LED, dont les modèles de série n’étaient pas dotés. Notez les deux types
de boite à fumée utilisés, le type Nord à gauche et Sud-Est à droite.
 Les modèles de la 231 G 276 de la série Anniversaire sont présentés sur un socle en hêtre muni d’une étiquette numérotée. Notez les cercles de chaudière en laiton rapportés et,
à l’extrémité de l’abri, la grille (photogravée) de protection vis-à-vis des caténaires. Ce sont des détails qui ne sont pas présents sur les modèles de série.
Les modèles de la 231 G 276 de la série Anniversaire sont présentés sur un socle en hêtre muni d’une étiquette numérotée. Notez les cercles de chaudière en laiton rapportés et,
à l’extrémité de l’abri, la grille (photogravée) de protection vis-à-vis des caténaires. Ce sont des détails qui ne sont pas présents sur les modèles de série.
 Au cours des années 70, le détaillant parisien Clarel s’empare du modèle de Pacific Jouef pour en proposer des versions détaillées et repeintes, comme ici en version PLM au premier plan.
Au cours des années 70, le détaillant parisien Clarel s’empare du modèle de Pacific Jouef pour en proposer des versions détaillées et repeintes, comme ici en version PLM au premier plan.
 On peut noter les tuyauteries rapportées du système de surchauffe.
On peut noter les tuyauteries rapportées du système de surchauffe.
 Une version PLM plus ancienne de Clarel sans Pare-fumée et sans dispositif de surchauffe.
Une version PLM plus ancienne de Clarel sans Pare-fumée et sans dispositif de surchauffe.
L’histoire des productions de Clarel est particulière. C’est d’abord un magasin parisien bien connu des amateurs, situé 25 rue de la Roquette, non loin de la place de la Bastille. Son fondateur, Albert Zuckermann,
oriente son commerce axé sur le matériel de camping vers les trains miniatures à partir de 1957. Le nom de Clarel a pour origine la contraction des noms de ses filles (Claudine et Arlette) et de son épouse
(Elyane). Les ventes débutent modestement avec du matériel VB, SMCF, Disque Rouge etc. : de l’artisanat français, mais à prix élevé. Le véritable essor viendra avec les prix cassés de Jouef, qui vont booster
les ventes.
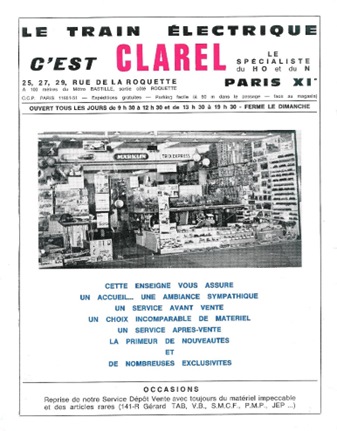 Clarel placera fidèlement des publicités dans les revues de modélisme Loco-Revue et RMF, ce qui lui permettra d’attirer les amateurs de tous horizons et aussi de pratiquer la vente par correspondance.
Monsieur Zuckermann offre rapidement à ses clients les moyens de détailler les modèles du commerce : peintures SNCF, décalcomanies, plaques en relief, pièces de détaillage, etc. Ensuite il fait appel à des
artisans doués pour détailler des modèles de grande série, HOrnby-acHO ou Jouef. Son offre de modèles superdétaillés est impressionnante dans toutes les catégories : vapeur, électriques ou diesel. Sur les
modèles Clarel, les tuyauteries et les rambardes sont rapportées, les peintures refaites. Souvent les électriques sont dotées de pantographes Carmina avec une ligne de toiture entièrement remaniée. Les plaques
des locomotives à vapeur sont en laiton photogravé. En 1981, le commerce est repris par Mr Pierre Venant et prend la raison sociale « Clarel distribution ». Helas ! Clarel connaîtra le sort de beaucoup de grandes
enseignes parisiennes : il disparaîtra lui aussi.
Clarel placera fidèlement des publicités dans les revues de modélisme Loco-Revue et RMF, ce qui lui permettra d’attirer les amateurs de tous horizons et aussi de pratiquer la vente par correspondance.
Monsieur Zuckermann offre rapidement à ses clients les moyens de détailler les modèles du commerce : peintures SNCF, décalcomanies, plaques en relief, pièces de détaillage, etc. Ensuite il fait appel à des
artisans doués pour détailler des modèles de grande série, HOrnby-acHO ou Jouef. Son offre de modèles superdétaillés est impressionnante dans toutes les catégories : vapeur, électriques ou diesel. Sur les
modèles Clarel, les tuyauteries et les rambardes sont rapportées, les peintures refaites. Souvent les électriques sont dotées de pantographes Carmina avec une ligne de toiture entièrement remaniée. Les plaques
des locomotives à vapeur sont en laiton photogravé. En 1981, le commerce est repris par Mr Pierre Venant et prend la raison sociale « Clarel distribution ». Helas ! Clarel connaîtra le sort de beaucoup de grandes
enseignes parisiennes : il disparaîtra lui aussi.
 Seul Clarel était capable de sublimer un modèle Jouef avant tout destiné aux coffrets de départ comme ici, l’Y 51100 dans sa configuration d’origine au fonf, et détaillée par Clarel au
premier plan.
Seul Clarel était capable de sublimer un modèle Jouef avant tout destiné aux coffrets de départ comme ici, l’Y 51100 dans sa configuration d’origine au fonf, et détaillée par Clarel au
premier plan.
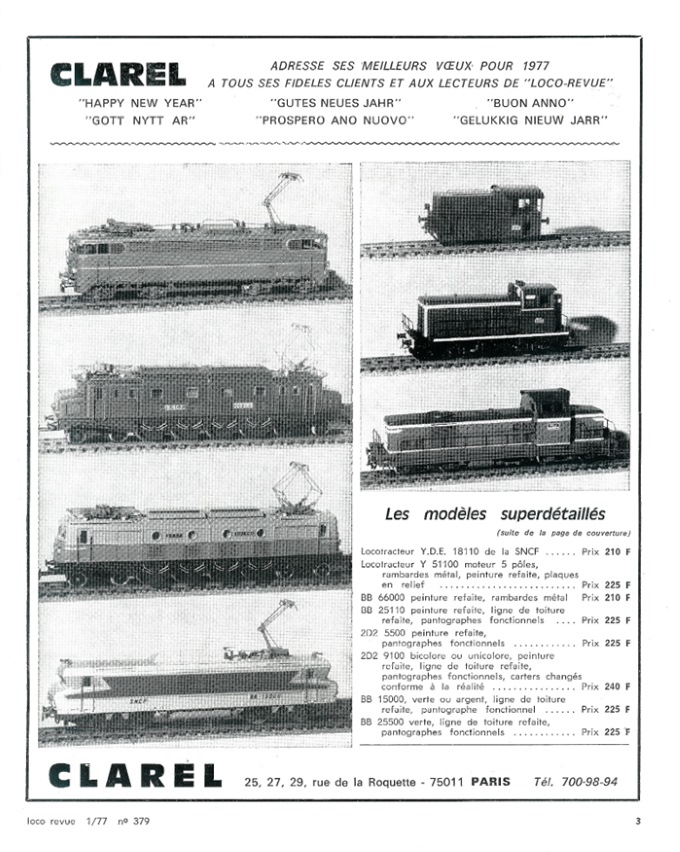
Dans le Loco Revue de janvier 1977, le choix des « exclusivités Clarel » est vaste pour ce qui concerne les électriques et les diesels. Quasiment que des modèles Jouef.
 L’Y 51100 détaillée par Clarel manœuvre un porte plat cadres Bailly.
L’Y 51100 détaillée par Clarel manœuvre un porte plat cadres Bailly.
 Pour bénéficier de modèles de la première série, Clarel va proposer des versions super-détaillées dotées de caisses Jouef montées sur châssis Roco pour de meilleures performances, comme ici la BB 15000
dans sa première version.
Pour bénéficier de modèles de la première série, Clarel va proposer des versions super-détaillées dotées de caisses Jouef montées sur châssis Roco pour de meilleures performances, comme ici la BB 15000
dans sa première version.
 La BB 25000 bicourant version Clarel au premier plan, sur la base du modèle Jouef à l’arrière-plan. Elle est équipée de pantographes Carmina très réalistes en deux versions, adapté au
type de courant ; 25000V à l’avant, 1500V à l’arrière. Sur le modèle Jouef d’origine, aucune différente entre les 2 pantographes.
La BB 25000 bicourant version Clarel au premier plan, sur la base du modèle Jouef à l’arrière-plan. Elle est équipée de pantographes Carmina très réalistes en deux versions, adapté au
type de courant ; 25000V à l’avant, 1500V à l’arrière. Sur le modèle Jouef d’origine, aucune différente entre les 2 pantographes.
 Image du 19ième siècle, la 030 Bourbonnais d’origine Rivarossi reprise en décoration d’origine PLM avec un abri d’origine. Je me suis amusé à reconstituer un PN d’époque.
Image du 19ième siècle, la 030 Bourbonnais d’origine Rivarossi reprise en décoration d’origine PLM avec un abri d’origine. Je me suis amusé à reconstituer un PN d’époque.
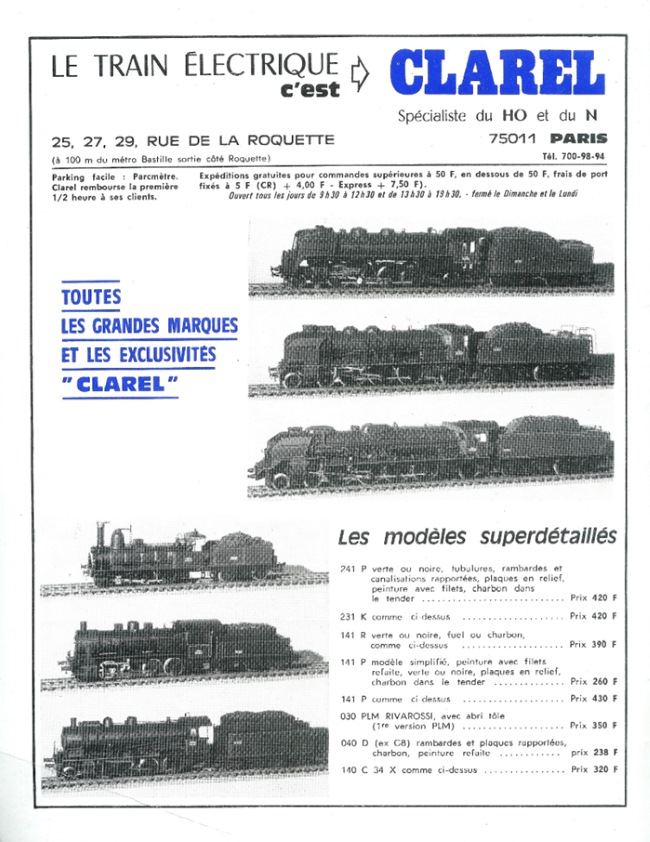 Toujours dans le Loco Revue de janvier 1977, les différentes locomotives à vapeur, la plupart d’origine Jouef avec quelques modèles d’autres origines, Rivarossi ou Piko.
Toujours dans le Loco Revue de janvier 1977, les différentes locomotives à vapeur, la plupart d’origine Jouef avec quelques modèles d’autres origines, Rivarossi ou Piko.
 L’ensemble des tuyauteries ont été rapportées sur la 241P version revisitée par Clarel. A comparer avec la version Jouef d’origine au fond.
L’ensemble des tuyauteries ont été rapportées sur la 241P version revisitée par Clarel. A comparer avec la version Jouef d’origine au fond.
 Différentes versions de 140C jouef. De haut en bas : Jouef d’origine, Clarel à tender 34X et Clarel à tender normal.
Différentes versions de 140C jouef. De haut en bas : Jouef d’origine, Clarel à tender 34X et Clarel à tender normal.
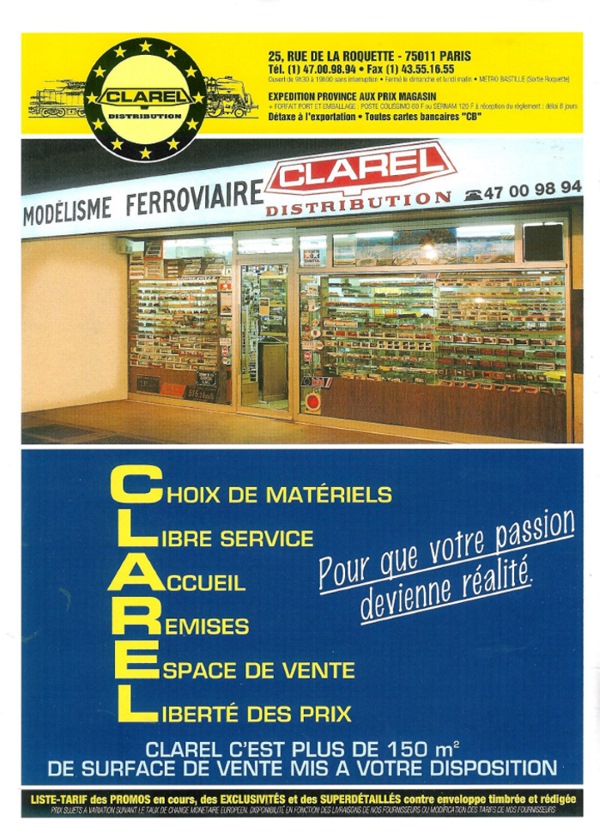 Le magasin Clarel visualisé dans cette publicité de Loco Revue de novembre 1994.
Le magasin Clarel visualisé dans cette publicité de Loco Revue de novembre 1994.
 La 140C version Clarel effectue une livraison de petites Decauville H0e.
La 140C version Clarel effectue une livraison de petites Decauville H0e.
 Gros plan sur le détail d’une 141 fuel avec ses tuyauteries refaites et rapportées.
Gros plan sur le détail d’une 141 fuel avec ses tuyauteries refaites et rapportées.
 Clarel importait les modèles Piko d’Allemagne de l’Est comme cette rame marchandise. Et bien entendu proposait des versions détaillées avec ici la 040 D.
Clarel importait les modèles Piko d’Allemagne de l’Est comme cette rame marchandise. Et bien entendu proposait des versions détaillées avec ici la 040 D.
 Clarel produit aussi quelques exclusivités, comme ce modèle de CC 6500 doté d’une caisse en bronze montée sur un châssis Piko.
Clarel produit aussi quelques exclusivités, comme ce modèle de CC 6500 doté d’une caisse en bronze montée sur un châssis Piko.
 Un des chefs-d’œuvre de Clarel, la 241 C1 du PLM sur base de 241P Jouef (photo Michel Probst).
Un des chefs-d’œuvre de Clarel, la 241 C1 du PLM sur base de 241P Jouef (photo Michel Probst).
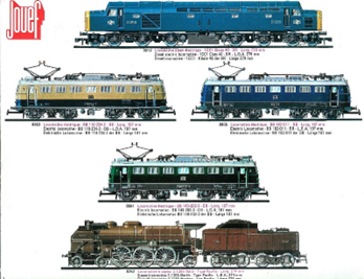
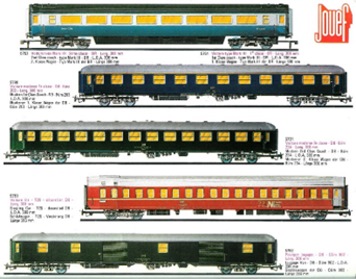 Une grande partie du dépliant des nouveautés est consacrée presque exclusivement à des modèles étrangers. Il y a les BB Allemande types 110, 140 et 180. La diesel Britannique
1CC1 classe 40 associés aux voitures Mark III des British Railwails. Les voitures UIC type X de la DB ainsi qu’une voiture couchette de la même compagnie.
Une grande partie du dépliant des nouveautés est consacrée presque exclusivement à des modèles étrangers. Il y a les BB Allemande types 110, 140 et 180. La diesel Britannique
1CC1 classe 40 associés aux voitures Mark III des British Railwails. Les voitures UIC type X de la DB ainsi qu’une voiture couchette de la même compagnie.
Le dépliants des nouveautés Jouef 1977 est essentiellement tourné vers l’exportation et comprend deux pages complètes de modèles étrangers. On y retrouve d’abord trois types de machines Allemandes basées sur la même caisse et d’apparence extérieure similaire. La BB 110 de la DB (ex E10), machines très répandues en Allemagne, destinées à la traction des rapides et des express. Elle est proposée en livrée bleue. Il y a une BB 140 destinée au service marchandise qui est proposée par Jouef dans une livrée ivoire et turquoise. Il y a aussi un modèle plus particulier car Bicourant, la BB 182 de couleur verte et destinée au trafic frontalier dans l’est de la France vers Forbach et Metz. Seul la décoration et le marquage distinguent les trois versions. La technique utilisée est celle de l’époque, un moteur monté sur le berceau incliné d’un des bogies qui attaque directement un des essieux par une vis sans fin. Destinés à l’Allemagne, un pays exigeant sur l’équipement, un éclairage avec inversion suivant le sens de marche équipe les motrices des deux côtés. Les pantographes bi-palette sont des modèles classiques de Jouef. La ligne de toiture est reproduite de manière complète. Un beau modèle mais qui se heurte en 1977 au modèle iconique de Märklin, tout en métal injecté.
 Il est maintenant possible de constituer de belles rames Allemandes authentiques et 100% en matériel Jouef. Ici une BB 110 avec des voitures UIC type X de la DB en version 1ière
classe bleu et 2ième classe verte.
Il est maintenant possible de constituer de belles rames Allemandes authentiques et 100% en matériel Jouef. Ici une BB 110 avec des voitures UIC type X de la DB en version 1ière
classe bleu et 2ième classe verte.
 Une belle brochette de BB électriques Allemandes de Jouef. De gauche à droite, la BB 182 bicourant, la BB 110 pour trafic voyageur, la BB 140 pour trafic marchandise. Devant la BB
quadricourant 184 sortie en 1973.
Une belle brochette de BB électriques Allemandes de Jouef. De gauche à droite, la BB 182 bicourant, la BB 110 pour trafic voyageur, la BB 140 pour trafic marchandise. Devant la BB
quadricourant 184 sortie en 1973.
 Jouef a scrupuleusement reproduit la différence des toitures entre la BB 110 et sa version bicourant BB 182.
Jouef a scrupuleusement reproduit la différence des toitures entre la BB 110 et sa version bicourant BB 182.
 Photographiés ici sur une page du catalogue Jouef 1978, les trois nouvelles BB allemandes. De haut en bas les types 110 destinés au trafic voyageur, 180 bicourant pour les échanges
avec l’Est de la France et 140 pour le service marchandise.
Photographiés ici sur une page du catalogue Jouef 1978, les trois nouvelles BB allemandes. De haut en bas les types 110 destinés au trafic voyageur, 180 bicourant pour les échanges
avec l’Est de la France et 140 pour le service marchandise.
Du côté des voitures c’est aussi foison de nouveautés à destination de l’exportation. Pour l’Allemagne, Jouef remplace ses voitures françaises UIC redorées façon Deutsch Bundesbahn qui étaient apparues en 1973 par de véritables reproductions des voitures type X de la DB. Ces voitures, conçues pour le trafic international, sont omniprésentes au-delà du Rhin, mais on les voit aussi en France et sur les liaisons internationales. Jouef reproduit 3 types principaux, 1ière classe bleu, 2ième classe verte et fourgon. Cette voiture est reproduite par de nombreux fabricants, mais Jouef les propose avec une longueur de 305mm, c’est-à-dire qu’elles sont à l’échelle. Seul Rivarossi propose un modèle de 300mm, alors que Roco est à 266mm, Fleischmann à 264mm et Märklin à 270mm. Avec une telle longueur Jouef arrive tout de même à faire en sorte que ses voitures s’inscrivent en courbe de 385mm. Les caisses et donc les moules sont différents pour chaque voiture. Avec cette voiture, Jouef est armé pour attaquer la clientèle des modélistes germaniques à un prix accessible à tous, dans un créneau différent de celui des productions allemandes.
 Jouef remplace ses voitures françaises UIC redorées apparues en 1973 par de véritables reproductions de la DB.
Jouef remplace ses voitures françaises UIC redorées apparues en 1973 par de véritables reproductions de la DB.
 La mécanique de la nouvelle BB 110 à gauche est bien plus sophistiquée que l’ancienne BB 184. Cela se traduit par notamment un lest important. En Allemagne on apprécie les
lourdes machines.
La mécanique de la nouvelle BB 110 à gauche est bien plus sophistiquée que l’ancienne BB 184. Cela se traduit par notamment un lest important. En Allemagne on apprécie les
lourdes machines.
L’année 1977 marque aussi le retour de Jouef vers le marché Anglais, après l’aventure de Playcraft qui s’est terminée au début des années 70. Le Jouet Français achète une usine en Irlande dans la périphérie de Limerick. Ce sera HDI (Hobby Developments Ireland) dont le but est de permettre d’exporter à moindre coût. Une subvention du gouvernement Irlandais est accordée. Cette usine renoue avec le royaume uni avec une diesel de la classe 40 des British Railwails. Le modèle de type 1CC1 a un côté monstrueux avec 279mm de longueur. Elle est à l’échelle 00 de 1/76ième suivant les habitudes anglaises. Deux versions vont exister bleu et jaune récente avec marquage D 285 et verte d’origine (1958) avec marquage D210. Son existence sera brève, puisqu’elle disparait du catalogue Français dès 1980 (tout comme l’usine HDI qui sera victime du Jouet Français en 1981). Pour accompagner cette machine Jouef propose trois versions des voitures MKIII ; 1ière classe, 2ième classe et « Buffet Car ». Les bogies sont spécifiques et les modèles bien détaillés. Mais l’intérêt pour les français de ces modèles est réduit et ils n’auront guère de succès dans l’hexagone.
 La page du catalogue Jouef 1978 présente les deux versions de la locomotive diesel class 40.
La page du catalogue Jouef 1978 présente les deux versions de la locomotive diesel class 40.
 A destination de l’Angleterre, la voiture MKIII n’a pas eu un grand succès en France. Le tunnel sous la manche n’existait pas encore. Notez les attelages à ajouter. En Grande Bretagne,
elles sont livrées avec l’attelage à croc, compatible avec les modèles Tri-ang.
A destination de l’Angleterre, la voiture MKIII n’a pas eu un grand succès en France. Le tunnel sous la manche n’existait pas encore. Notez les attelages à ajouter. En Grande Bretagne,
elles sont livrées avec l’attelage à croc, compatible avec les modèles Tri-ang.
De type Compound à quatre cylindres et à surchauffe, les 231C furent construites dans les années 30 sous le numéro 3. 1200 pour la compagnie du Nord avant d’être ré-immatriculée 231C à la création de la SNCF en 1938. Leur esthétique due aux talents de l’ingénieur Marc de Caso était rehaussée par l’application de pare-fumée caractéristique dont les premières séries se trouvaient démunies. Ces locomotives poursuivront leurs carrières, jusqu’en 1963, condamnées par l’électrification de l’axe Paris Lille. Elle était connue sous l’appellation « Super Pacific » ce qui marquait fortement les esprits des enfants de l’époque. JEP l’avait déjà choisie avant-guerre pour sa véritable Pacific à l’échelle O qui tractait la célèbre Flèche d’Or.
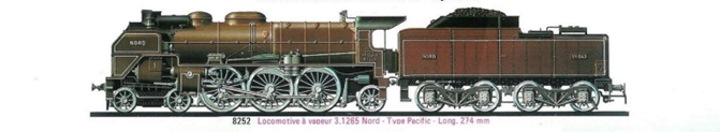 La gravure du dépliant des nouveautés 1977 laissait pourtant augurer d’un modèle très détaillé, ce ne sera pas le cas. Les amateurs sont déçus.
La gravure du dépliant des nouveautés 1977 laissait pourtant augurer d’un modèle très détaillé, ce ne sera pas le cas. Les amateurs sont déçus.
 La Super Pacific 231 C figure dans l’histoire de Jouef depuis 1960. Au fond, la version noire d’origine. Elle est améliorée et décorée en vert à filets rouge fin des années 60. En 1977
elle est remplacée par une version totalement nouvelle au premier plan. Malheureusement c’est un modèle simpliste, peu détaillé, que les amateurs s’ingénieront à améliorer comme la version au fond à gauche,
dans sa belle décoration d’origine Nord.
La Super Pacific 231 C figure dans l’histoire de Jouef depuis 1960. Au fond, la version noire d’origine. Elle est améliorée et décorée en vert à filets rouge fin des années 60. En 1977
elle est remplacée par une version totalement nouvelle au premier plan. Malheureusement c’est un modèle simpliste, peu détaillé, que les amateurs s’ingénieront à améliorer comme la version au fond à gauche,
dans sa belle décoration d’origine Nord.
Jouef avait choisi ce modèle en 1960 pour sa première reproduction sérieuse d’une machine elle avait été la première vapeur Pacific démocratique possédant 12 roues, offerte sur le marché du train miniature français. De nombreux amateurs de l’époque s’ingénieront à améliorer la Pacific Jouef qui constitue une bonne base de départ pour un super-détaillage en complétant son embiellage et en ajoutant des tuyauteries rapportées. Ainsi elle a pu se retrouver sur des réseaux d’amateurs, digne de tracter une belle rame de voiture CIWL Rivarossi ou des voitures express Nord du RMA. Entre 1960 et 1976, notre Pacific va perdre de son prestige. A la fin des années 60, une version verte et noire ornée de filets rouge très fins verra le jour, permettant de hisser sa décoration aux meilleurs niveaux des modèles Jouef contemporains. Elle va perdre aussi son excellent moteur saucisson pour adopter, comme tout le reste de la gamme, le moteur standard M 20 bien moins performant. En 1977 apparait une version entièrement nouvelle de la 231C. Contrairement à ce qui a été annoncé, elle n’a pas été traitée comme un véritable modèle. Le tender est devenu moteur, et si le train de roue a été amélioré, l’embiellage est rudimentaire. Notre nouvelle Pacific est proposée en livrée Nord chocolat immatriculée 3.1265 du dépôt de Fives. Cette nouveauté 1977 ne marquera pas l’histoire, mais encore une fois, elle apparait comme base pour les modélistes pour super-détailler leur modèle. L’artisan Carmina proposera d’ailleurs pour cela un embiellage complet fait pour être monté en lieu et place de celui d’origine et qui était d’une grande finesse.
 Le « chocolat » est de rigueur à l’époque de la compagnie du Nord. Gros plan sur cette belle version super détaillée qui fait face à son ancêtre Jep des années 30.
Le « chocolat » est de rigueur à l’époque de la compagnie du Nord. Gros plan sur cette belle version super détaillée qui fait face à son ancêtre Jep des années 30.
 En ligne en tête de voitures métalliques Nord dans leurs décorations d’avant la création de la SNCF en 1938. Elle représente tout le style de l’ingénieur Marc Caso.
En ligne en tête de voitures métalliques Nord dans leurs décorations d’avant la création de la SNCF en 1938. Elle représente tout le style de l’ingénieur Marc Caso.
 Si il y a bien une rame mythique que la Super Pacific se doit de tracter sur les réseaux, c’est bien la Flèche d’Or, que ce soit en mode Jouet, comme la version 0 de JEP ou en mode
modélisme comme la belle version du RMA.
Si il y a bien une rame mythique que la Super Pacific se doit de tracter sur les réseaux, c’est bien la Flèche d’Or, que ce soit en mode Jouet, comme la version 0 de JEP ou en mode
modélisme comme la belle version du RMA.
A l’heure de la traction électrique, il est difficile d’imaginer tous les soins nécessaires pour faire fonctionner au quotidien les machines à vapeur de la SNCF. Le dépôt était le siège de toute une vie autour d’elles. Bien
entendu il fallait des tonnes de charbon, à acheter, réceptionner, stocker et à déverser rapidement dans les tenders. L’eau est le deuxième ingrédient de base. Pour cela les châteaux d’eau fleurissent à proximité
des installations.
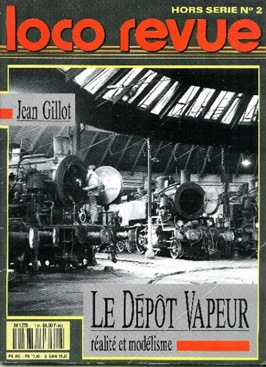 Mais pour éviter qu’elle entartre les chaudières, il faut la traiter chimiquement grâce au TIA (Traitement Intégral Armand). Il faut virer et retourner les machines sur les ponts tournants et les abriter
dans des remises ou des rotondes. La lampisterie est là pour l’éclairage frontal ou arrière. Il faut aussi du sable pour assurer le démarrage des trains lourds, c’est le rôle de la sablerie. Les fosses permettent de vider
les cendriers des foyers de leurs scories. Il est nécessaire aussi, à moyen terme, de réparer et d’entretenir les engins. Les ateliers s’en chargent avec leurs réserves de graisse et de lubrifiant et les stocks de
pièces de rechange. Et toute cette organisation fonctionne jour et nuit (il faut donc des pylônes d’éclairage) avec des hommes appartenant au dépôt, ou de passage dans le foyer des roulants. Toute cette réalité
sera progressivement transposée en miniature avec plus ou moins de fidélité, mais avec des progrès considérables dans le réalisme en 50 années d’évolution.
Mais pour éviter qu’elle entartre les chaudières, il faut la traiter chimiquement grâce au TIA (Traitement Intégral Armand). Il faut virer et retourner les machines sur les ponts tournants et les abriter
dans des remises ou des rotondes. La lampisterie est là pour l’éclairage frontal ou arrière. Il faut aussi du sable pour assurer le démarrage des trains lourds, c’est le rôle de la sablerie. Les fosses permettent de vider
les cendriers des foyers de leurs scories. Il est nécessaire aussi, à moyen terme, de réparer et d’entretenir les engins. Les ateliers s’en chargent avec leurs réserves de graisse et de lubrifiant et les stocks de
pièces de rechange. Et toute cette organisation fonctionne jour et nuit (il faut donc des pylônes d’éclairage) avec des hommes appartenant au dépôt, ou de passage dans le foyer des roulants. Toute cette réalité
sera progressivement transposée en miniature avec plus ou moins de fidélité, mais avec des progrès considérables dans le réalisme en 50 années d’évolution.
 Jouef avait abordé le monde du dépôt en 1963 avec son « dépôt des machines » en version 2 ou 4 voies.
Jouef avait abordé le monde du dépôt en 1963 avec son « dépôt des machines » en version 2 ou 4 voies.
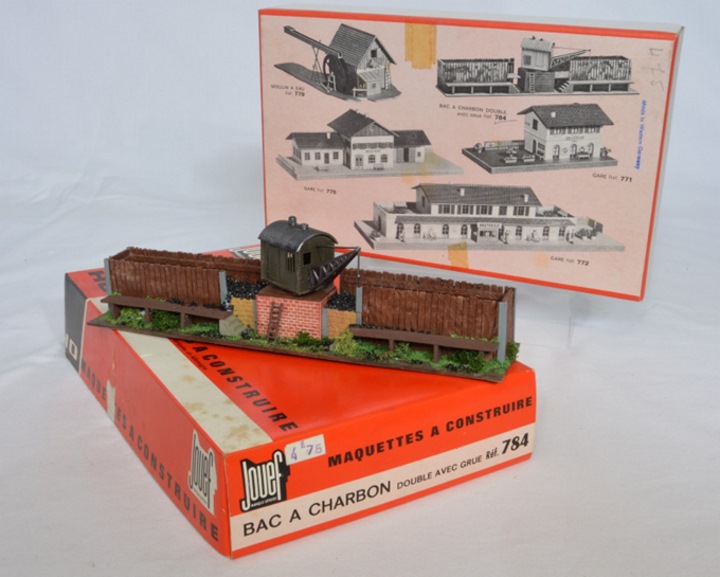 Jouef propose de 1965 à 1966 ce parc à charbon avec estacade et grue d’origine Pola. Un modèle simpliste mais sympathique.
Jouef propose de 1965 à 1966 ce parc à charbon avec estacade et grue d’origine Pola. Un modèle simpliste mais sympathique.
Pour les amateurs de deux rails apparaît en 1958 le pont tournant qui sera la référence pour longtemps, celui de Fleischmann. Il faut l’encastrer dans le plateau pour que les voies affleurent la surface. A part sa cabine trop volumineuse et des angles entre les voies importants de 15°, il donne satisfaction. Concernant les bâtiments de dépôt, les amateurs disposent durant les années 50 des remises et rotondes en tôle de Märklin, très simplifiées, et des modèles de Cropsy correspondant mieux au style français. Un tournant sera la naissance de la rotonde Vollmer en 1963. Disposant de 3 ou 6 stalles, elle est d’un niveau de détail inégalé jusqu’alors. Tout y est reproduit : ferrures en fer forgé, cheminées, vasistas…, et le tout agrémenté de pièces de toiture finement patinées à l’aérographe par le fabricant, ce qui facilite beaucoup la tâche au montage pour obtenir un bon niveau de réalisme. Gadget très prisé, elle dispose de portes ouvrantes automatiques, directement commandées par les locomotives grâce à un système de poussoir au fond de la remise et de ressorts.

 Les deux éléments permettant durant les années 60 aux amateurs de composer un dépôt. La plaque tournante de Fleischmann apparue en 1958 et la rotonde de Vollmer nouveauté 1963.
Les deux éléments permettant durant les années 60 aux amateurs de composer un dépôt. La plaque tournante de Fleischmann apparue en 1958 et la rotonde de Vollmer nouveauté 1963.
 Un rêve de petits garçons en couverture arrière du catalogue Fleischmann 1966. La plaque tournante de la marque associée à la rotonde 6 stalles de Vollmer. Le choix des remises et rotondes Vollmer,
omniprésentes sur les réseaux, tient à leur charme restituant bien l’ambiance vapeur.
Un rêve de petits garçons en couverture arrière du catalogue Fleischmann 1966. La plaque tournante de la marque associée à la rotonde 6 stalles de Vollmer. Le choix des remises et rotondes Vollmer,
omniprésentes sur les réseaux, tient à leur charme restituant bien l’ambiance vapeur.
 Un beau dépôt de type français dans les années 60 sur la base de la plaque Fleischmann. Ici la rotonde est construite par moi.
Un beau dépôt de type français dans les années 60 sur la base de la plaque Fleischmann. Ici la rotonde est construite par moi.
Une petite révolution viendra du N en 1968 lorsque la firme pionnière de cette échelle, Arnold Rapido propose un pont tournant d’un réalisme qui va ridiculiser les modèles H0. Les secteurs de voies ont un angle réduit, comme en réalité, la cabine est à l’échelle (le moteur est sous le pont) et surtout, il est modulable, l’on peut ajouter autant de tronçons de voie que l’on désire, suivant la configuration de son dépôt. Les segments d’accès assurent à la fois la continuité électrique et l’arrêt automatique du pont face à la voie.
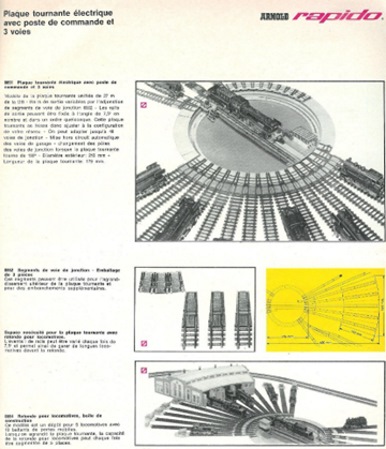
 L’inspiration viendra de l’échelle N avec la superbe plaque tournante d’Arnold Rapido apparue en 1968 et de conception entièrement modulaire.
L’inspiration viendra de l’échelle N avec la superbe plaque tournante d’Arnold Rapido apparue en 1968 et de conception entièrement modulaire.
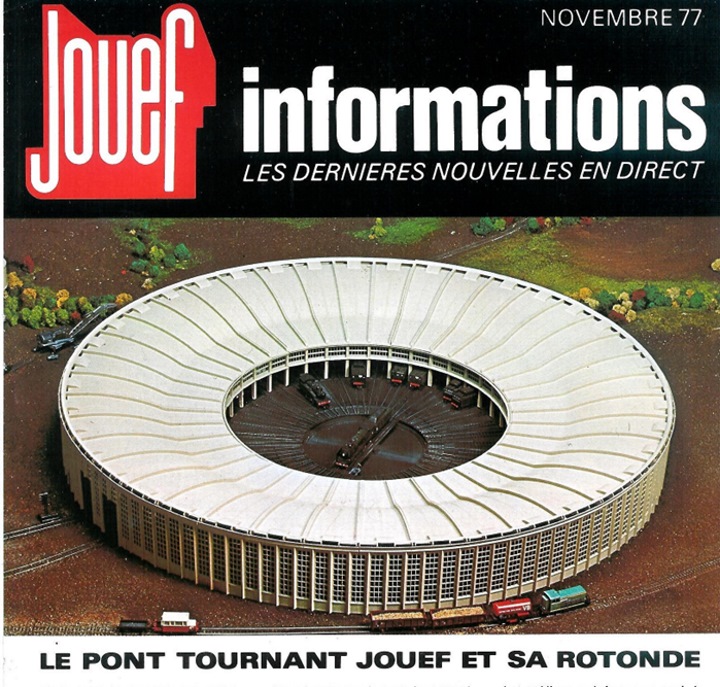 En supplément du Loco Revue n° 388 de novembre 1977, le supplément Jouef information est en couleur et présente la rotonde type P totalement fermée avec un ensemble de 40 voies couvertes desservies par
le pont tournant.
En supplément du Loco Revue n° 388 de novembre 1977, le supplément Jouef information est en couleur et présente la rotonde type P totalement fermée avec un ensemble de 40 voies couvertes desservies par
le pont tournant.
Jouef avait abordé le monde du dépôt en 1963 avec son « dépôt des machines » en version 2 ou 4 voies. Il est assemblé sans colle, avec des vis, suivant les premières techniques de la marque. Cette année 1977 fera date dans l’histoire des dépôts avec la présentation par Jouef de son ensemble pont tournant + rotonde. Il adopte lui aussi le principe des segments de voie additionnels conformément au principe innové par Arnold Rapido pour l’échelle N. L’angle chez Jouef est de 9°, ce qui permet un total, sur toute la circonférence, de 40 voies. C’est le dépôt de Noisy-le-Sec qui a inspiré les techniciens du constructeur. Le pont tournant reproduit le modèle de 26m de la SNCF. La particularité est que ce pont est conçu pour être simplement posé sur la table du réseau. La fosse est surélevée de 20mm, ainsi que les secteurs de voies de garage. Une rampe d’accès permet l’entrée des locomotives, mais en fait, cette disposition complique plus qu’elle ne simplifie le travail de l’amateur. Le pont tournant Jouef est électrifié, mais il n’y a pas de dispositif d’arrêt en face des voies. Il faut donc ajuster sa position à l’œil, ce qui n’est pas toujours aisé. L’alimentation des voies de garage se fait en fonction de la position du pont. Un pupitre de commande permet curieusement à la fois la rotation du pont et le mouvement des locomotives. Pour cela, il faut appuyer simultanément sur 2 touches à la fois, et pas les mêmes suivant le sens de marche de la locomotive. Autant dire qu’il ne faut pas faillir sur les manœuvres, et une notice est indispensable. Le mouvement de rotation est réaliste est peu bruyant. Nombreux sont les amateurs qui amélioreront le pont Jouef. Autrement, la fiabilité restera aléatoire et souvent, le nouveau modèle de Fleischmann sorti également en 1977 remportera les suffrages des amateurs.
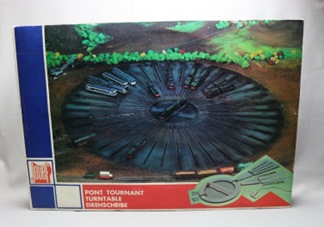
 L’imposant coffret du pont tournant qui comporte 2 voies avec rampe d’accès (il est fait pour être posé sur la table du réseau), deux voies de garage (avec fosse) et le pupitre de commande.
L’imposant coffret du pont tournant qui comporte 2 voies avec rampe d’accès (il est fait pour être posé sur la table du réseau), deux voies de garage (avec fosse) et le pupitre de commande.
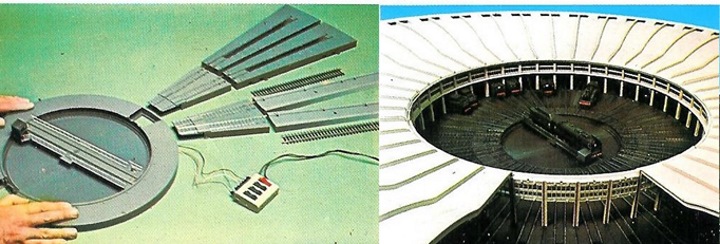 L’installation et le câblage du pont nécessite de bien suivre la notice. Avec la possibilité de desservir 40 voies, on peut imaginer une rotonde couvrant les 360° avec l’ouverture de portes à l’arrière du bâtiment.
L’installation et le câblage du pont nécessite de bien suivre la notice. Avec la possibilité de desservir 40 voies, on peut imaginer une rotonde couvrant les 360° avec l’ouverture de portes à l’arrière du bâtiment.
 Les éléments modulaires du pont et de la remise type P permettent d’envisager toutes les possibilités.
Les éléments modulaires du pont et de la remise type P permettent d’envisager toutes les possibilités.
La rotonde de type P est composée d’une boite de base pour 2 voies disposant d’éléments modulaires, toitures, faces latérales, avant et arrière. La boite complémentaire permet de l’élargir de 2 voies supplémentaires. Entièrement en plastique, son montage est simple et rapide. Il est conseillé de ne pas fixer les toits pour pouvoir intervenir sans problème à l’intérieur. Les amateurs français s’en donneront à cœur joie, pour décorer et salir cette spectaculaire rotonde.
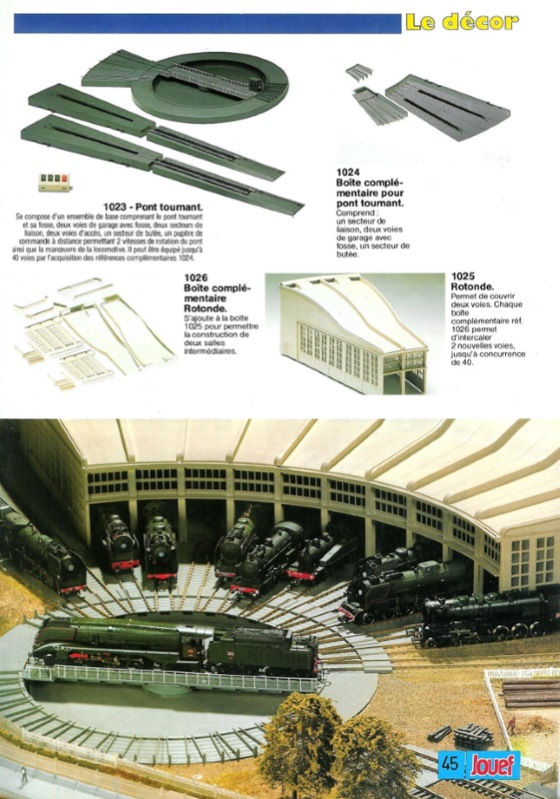 Le catalogue 1987 met en valeur le dépôt Jouef et ses différentes références pour une construction modulaire.
Le catalogue 1987 met en valeur le dépôt Jouef et ses différentes références pour une construction modulaire.
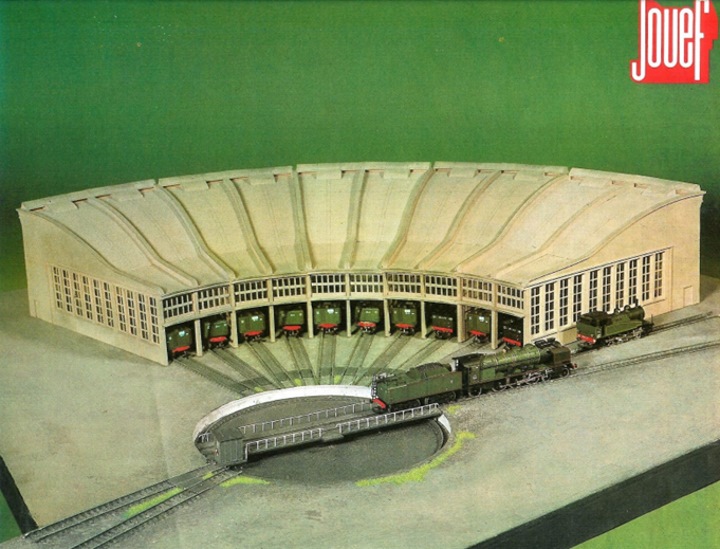 L’illustration de la brochure des nouveautés Jouef 1977 est de bon augure pour le réalisme du dépôt. Il est cependant difficile à intégrer tel quel, car surélevé de 20 mm.
L’illustration de la brochure des nouveautés Jouef 1977 est de bon augure pour le réalisme du dépôt. Il est cependant difficile à intégrer tel quel, car surélevé de 20 mm.
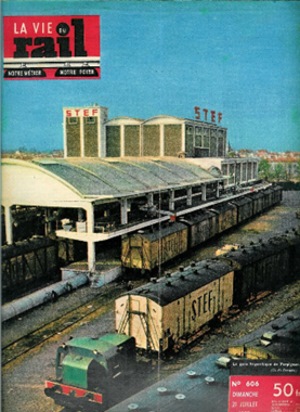 Très tôt, les chemins de fer ont permis de transporter dans des délais compatibles avec leur état de fraîcheur des denrées périssables, comme le poisson frais. Les années 30 voient le développement des wagons
réfrigérés en utilisant des pains de glace. Pour cela les compagnies, puis la SNCF font appel à des filiales. La STEF (Société de Transport et Entrepôts Frigorifiques) est créée en 1920 pour le transport des
denrées nécessitant une température contrôlée. En 1949, c’est la société Interfrigo (Société Ferroviaire Internationale de Transport Frigorifique) qui est constituée par 23 compagnies Européennes. Ainsi les
produits frais peuvent traverser les frontières avec des délais réduits.
Très tôt, les chemins de fer ont permis de transporter dans des délais compatibles avec leur état de fraîcheur des denrées périssables, comme le poisson frais. Les années 30 voient le développement des wagons
réfrigérés en utilisant des pains de glace. Pour cela les compagnies, puis la SNCF font appel à des filiales. La STEF (Société de Transport et Entrepôts Frigorifiques) est créée en 1920 pour le transport des
denrées nécessitant une température contrôlée. En 1949, c’est la société Interfrigo (Société Ferroviaire Internationale de Transport Frigorifique) qui est constituée par 23 compagnies Européennes. Ainsi les
produits frais peuvent traverser les frontières avec des délais réduits.
Bien entendu, les fabricants ont cherché à reproduire des wagons isothermes ou réfrigérants, ne serait-ce que pour leur blancheur éclatante qui apporte de la variété aux rames. Pour les modèles à deux essieux, à l’époque du Presspahn roi, on trouve des modèles tout montés de VB et du détaillant parisien « Au Pélican ». L’artisan Jean Laffont produit un kit de wagon STEF type C et D ainsi que des modèles Interfrigo et Transfesa (pour le transport vers l’Espagne). Ces reproductions sont très réalistes pour l’époque, avec des inscriptions imprimées très fines pour les versions dites « préfabriquées ». De manière plus industrielle, SMCF reproduit en zamac un modèle STEF et Interfrigo à partir de 1953. La série évolue vers une carrosserie plastique en 1958. Dans la même lignée HOrnby-acHO décline sa propre version STEF à partir de 1960, qui sera ensuite déclinée en version Findus à partir de 1970. Depuis la disparition de HOrnby-acHO les amateurs éprouvent un manque en l’absence de ce modèle si courant sur les voies de la SNCF. Le modèle Jouef type D produit à partir de 1977 sera donc très bien venu. Il est livré avec son set de superdétaillage. Il servira longtemps de base aux amateurs, dans l’attente de la reproduction L.S.Models.
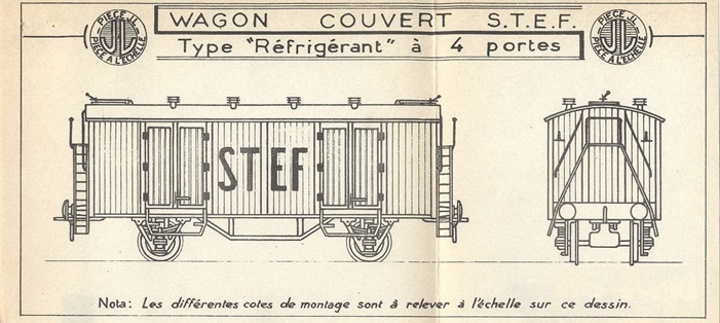 Le plan du couvert réfrigérant type C et D joint à la boîte de construction JL dans les années 50.
Le plan du couvert réfrigérant type C et D joint à la boîte de construction JL dans les années 50.
 Variation de productions Jouef autour des STEF à bogies et à 2 essieux, avec différents niveaux de patine au premier plan. Un intrus, cependant, le modèle JEP au fond à gauche.
Variation de productions Jouef autour des STEF à bogies et à 2 essieux, avec différents niveaux de patine au premier plan. Un intrus, cependant, le modèle JEP au fond à gauche.
 Les différentes reproductions de Standards D au fil des années, aux couleurs de STEF ou de Marcel Millet. A droite, du fond vers l’avant : les modèles JL de 1950, SMCF de 1954, Hornby-acHO de 1960,
et L.S.Models des années 2010. Au milieu, des modèles Jouef, d’origine ou patinés. A gauche, les version Marcel Millet de LS et Jouef, édition spéciale pour la revue « Le Train »
Les différentes reproductions de Standards D au fil des années, aux couleurs de STEF ou de Marcel Millet. A droite, du fond vers l’avant : les modèles JL de 1950, SMCF de 1954, Hornby-acHO de 1960,
et L.S.Models des années 2010. Au milieu, des modèles Jouef, d’origine ou patinés. A gauche, les version Marcel Millet de LS et Jouef, édition spéciale pour la revue « Le Train »
 Les produits de la mer, en route vers la capitale en Régime Accéléré marchandise tracté par un rapide 141P.
Les produits de la mer, en route vers la capitale en Régime Accéléré marchandise tracté par un rapide 141P.

La série des voitures Corail prend sa source en 1975. Elles seront produites en très grand nombre : 3886 voitures (en 90 variantes !) livrées jusqu’en 1988. Leur production massive va entraîner la réforme des
séries anciennes de la SNCF. Fini la couleur verte. Elles ont un point commun (au départ du moins), leur livrée caractéristique en gris et blanc cassé. Le nom « Corail » a plusieurs origines. C’est au départ la
couleur des portes de ces nouvelles voitures, un orange vif évoquant le corail. Cette couleur, on la retrouve aussi, au début, sur le revêtement des sièges. Mais les voitures sont aussi une expression avancée
du Confort sur RAIL (d’où CO RAIL). En effet elles sont toutes climatisées et astucieusement aménagées, soit avec des compartiments, soit en salle coach à couloir central. Il y en aura trois types principaux :
les VSE (Voitures Standards Européennes dites aussi EUROFIMA) qui sont livrées dans plusieurs pays et dont 100 exemplaires seront pour la France ; les VTU, voitures à couloir central, qui constituent la
première série apparue, et aussi la plus nombreuse. Montées sur des bogies Y 32 qui contribuent à leur confort,
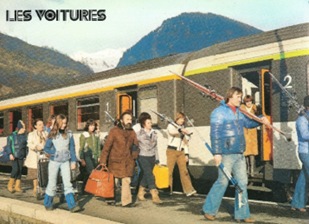 elles sont pour la plupart, aptes à une vitesse de 200km/h. Enfin les VU à compartiments qui
auront, elles, le plus grand nombre de variantes et notamment des voitures-couchettes, mixtes-fourgons ou voitures-pilotes pour rames réversibles. Les heures de gloire de la série prendront fin lorsque le TGV va
connaître son développement spectaculaire. Elles vont ensuite subir de nombreuses transformations, assorties à des variantes de livrée : Corail Plus ou TER régionaux.
elles sont pour la plupart, aptes à une vitesse de 200km/h. Enfin les VU à compartiments qui
auront, elles, le plus grand nombre de variantes et notamment des voitures-couchettes, mixtes-fourgons ou voitures-pilotes pour rames réversibles. Les heures de gloire de la série prendront fin lorsque le TGV va
connaître son développement spectaculaire. Elles vont ensuite subir de nombreuses transformations, assorties à des variantes de livrée : Corail Plus ou TER régionaux.
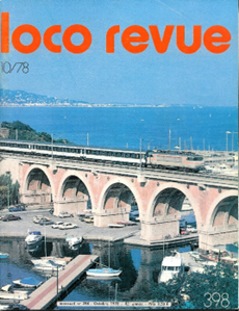
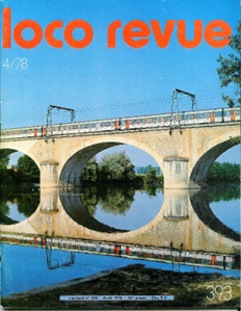
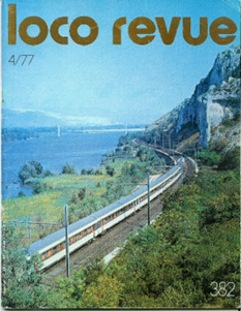 C’est très souvent que les voitures Corail font la couverture de Loco Revue dans les années 70.
C’est très souvent que les voitures Corail font la couverture de Loco Revue dans les années 70.
> 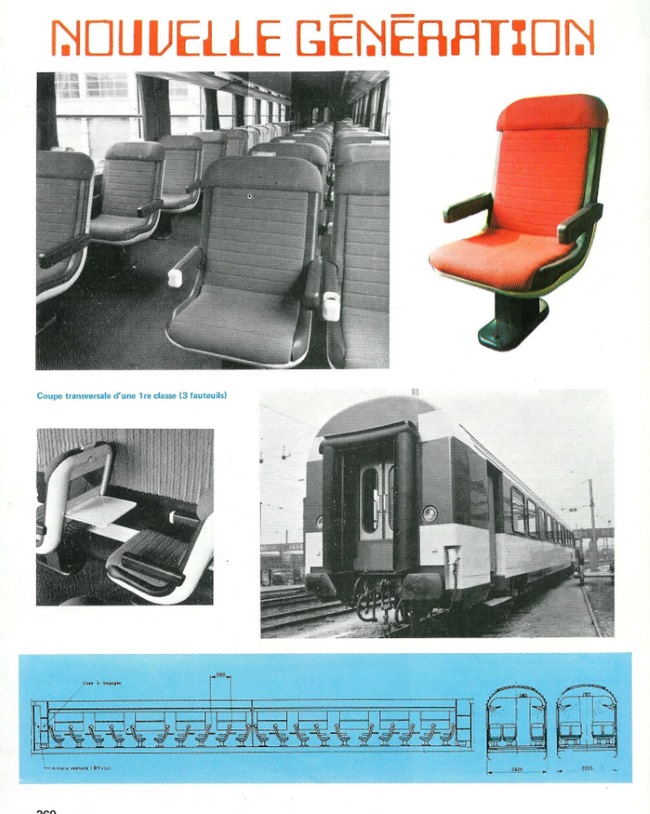 La description des nouveaux aménagements des voitures Corail. La plupart sont à couloir central. Le design des fauteuils est dans le style des années 70.
La description des nouveaux aménagements des voitures Corail. La plupart sont à couloir central. Le design des fauteuils est dans le style des années 70.
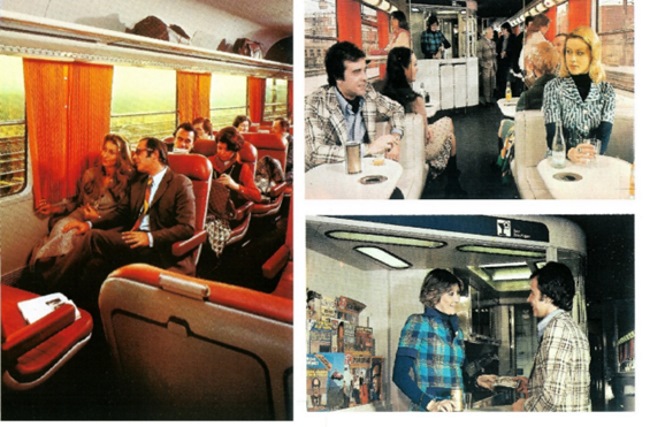 Les voitures Corail illustrées dans une brochure publicitaire de la SNCF. On y retrouve les fauteuils caractéristiques, le bar et la boutique.
Les voitures Corail illustrées dans une brochure publicitaire de la SNCF. On y retrouve les fauteuils caractéristiques, le bar et la boutique.
Les premières firmes à commercialiser des voitures Corail en H0 seront Roco, avec une VTU très raccourcie (en 1979), l’artisan français CEMP avec une VTU et une VU (modèles vendus en kits et repris ensuite par Mougel) (en 1980). En 1977 Jouef propose deux premières voitures Corail type VU 75 avec une 1/2ième classe et une 2ième classe fourgon. Elles sont construites selon la technique habituelle de la marque, la caisse formant boitier englobant les fenêtres moulées avec le châssis. Il n’y a pas d’aménagement intérieur. Les voitures sont à l’échelle et mesurent plus de 30cm. Le bogie de type Y 32 est nouveau et parfaitement reproduit. Les teintes reproduisent bien celle des voitures Corail. Un très beau modèle pour les amateurs de l’époque qui veulent en 1977 reproduire des rames modernes.
 Les 2 premiers modèles de voiture Corail sortis par Jouef en 1977. La BB 9200 aux couleurs Corail suivra, mais en 1980.
Les 2 premiers modèles de voiture Corail sortis par Jouef en 1977. La BB 9200 aux couleurs Corail suivra, mais en 1980.
 La France poursuit sa modernisation et sa quête du confort, les voitures Corail y contribuent. La BB 9200 en décoration Corail sortira plus tard chez Jouef en 1980.
La France poursuit sa modernisation et sa quête du confort, les voitures Corail y contribuent. La BB 9200 en décoration Corail sortira plus tard chez Jouef en 1980.
A côté du réfrigérant type standard D, il y a d’autres nouveautés en 1977. La plus originale est sans doute le couvert dit « canadien » des chemins de fer Belge SNCB. Il utilise le même châssis de 66mm que le
réfrigérant. La toiture nervurée de type « Murphy ». La gravure et les inscriptions sont exactes. Il y a un wagon à bogie céréalier à deux décorations ; Unicopa et Herforder Pils. Le premier est immatriculé à la
SNCF, le second à la DB.
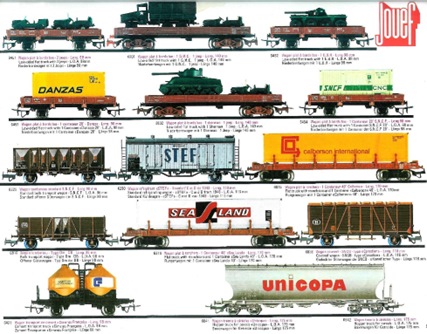 Il aura une longue descendance dans diverses décorations, comme celle des biscuits l’Alsacienne illustrés ci-dessous apparue en 1980. A côté de ces modèles spectaculaire, il y a
deux tombereaux plus modestes. Un standard D de la SNCF vient succéder aux modèles qu’avait produit HOrnby-acHO disparu du marché avec la marque en 1973 et pour l’exportation, un tombereau de la DB
de type Königsberg avec une caisse en bois renforcée de fers plats. A côté de ces nouveaux modèles, Jouef propose une série de wagons chargés de véhicules militaires d’origine Eko. Il y a aussi quatre références
chargées d’un conteneur.
Il aura une longue descendance dans diverses décorations, comme celle des biscuits l’Alsacienne illustrés ci-dessous apparue en 1980. A côté de ces modèles spectaculaire, il y a
deux tombereaux plus modestes. Un standard D de la SNCF vient succéder aux modèles qu’avait produit HOrnby-acHO disparu du marché avec la marque en 1973 et pour l’exportation, un tombereau de la DB
de type Königsberg avec une caisse en bois renforcée de fers plats. A côté de ces nouveaux modèles, Jouef propose une série de wagons chargés de véhicules militaires d’origine Eko. Il y a aussi quatre références
chargées d’un conteneur.
 Pour compléter son modèle Belge de locotracteur type C jouef propose l’original couvert dit « canadien » des chemins de fer de la SNCB.
Pour compléter son modèle Belge de locotracteur type C jouef propose l’original couvert dit « canadien » des chemins de fer de la SNCB.
 Le nouveau céréalier à bogie sera proposé dans de nombreuses décorations comme ici celle des biscuits l’Alsacienne.
Le nouveau céréalier à bogie sera proposé dans de nombreuses décorations comme ici celle des biscuits l’Alsacienne.
 Après la première gare de marchandises sortie en 1958 (à droite) Jouef propose un tout nouveau modèle de Halle de type Etat presque 20 ans plus tard (à gauche). Ici elle est posée sur un quai reconstruit et doté
de la grue qui sortira en 1978 pour la compléter.
Après la première gare de marchandises sortie en 1958 (à droite) Jouef propose un tout nouveau modèle de Halle de type Etat presque 20 ans plus tard (à gauche). Ici elle est posée sur un quai reconstruit et doté
de la grue qui sortira en 1978 pour la compléter.
En dehors des accessoires majeurs que constituent la plaque tournante et la rotonde, Jouef propose trois nouveaux accessoires. Le plus important est sans doute la halle à marchandise. Hormis le petit modèle d’origine allemande Vaupe, le seul modèle de ce type de bâtiment de Jouef datait de 1958. C’est un modèle de bâtiment de type Etat qui fut à l’origine implanté dans la région Ouest. Il a ensuite été largement présent dans toute la France. Le kit est très succinct et comporte peu de pièces. Il est cependant traité à l’échelle et plusieurs modèles peuvent être accolés pour former une longue Halle. Moyennant peinture et patine, ce sera un beau modèle très bien accueilli par les amateurs.
 Intégrée dans le décor et correctement patinée, la nouvelle Halle à marchandises est maintenant à la hauteur de la qualité des wagons Jouef de nouvelle génération.
Intégrée dans le décor et correctement patinée, la nouvelle Halle à marchandises est maintenant à la hauteur de la qualité des wagons Jouef de nouvelle génération.
Autre nouveauté, la passerelle à piétons. Le segment de quai et la largeur de la passerelle correspond aux côtes de la verrière de la gare de Castelnaudary. Il est aussi possible de juxtaposer plusieurs unités pour traverser 4 ou 6 voies. Le château d’eau est aussi un accessoire qui manquait depuis la disparition des modèles Cropsy en 1960. C’est la reproduction d’un modèle standard en béton qui se généralisa à partir de 1945 dans de nombreux dépôts. Très peu de pièces (5) constituent ce modèle.
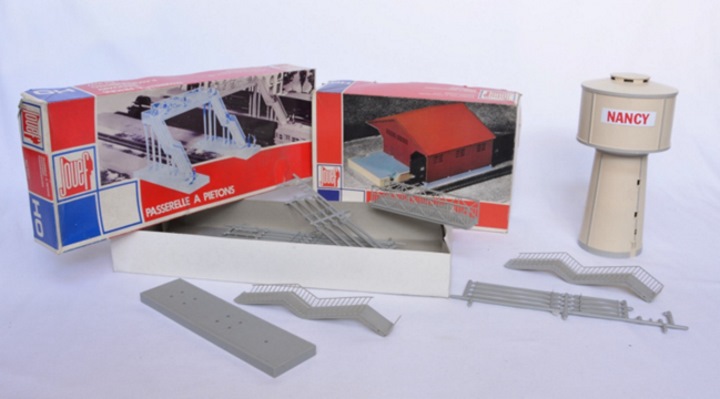 En plus de la Halle à marchandises, Jouef propose au rayon des accessoires en 1977 une passerelle à piétons et un château d’eau.
En plus de la Halle à marchandises, Jouef propose au rayon des accessoires en 1977 une passerelle à piétons et un château d’eau.