
Maquettes Ferroviaires
et Collections
 la marque doyenne qui inventa le HO
la marque doyenne qui inventa le HO

En 1972, Märklin est à l’apogée de son assortiment d’échelles. Son catalogue va du Z (1/220ième) au I (1/32ième) en passant par le H0 et le 0e. C’est ce dernier
qui sera la victime de la rationalisation dès 1973.
Les années 1969-1972 sont d’une grande richesse pour la firme Märklin. Comme toute l’industrie du jouet, elle subit de profondes mutations dans une période faste où il faut fournir des jouets
en quantité aux baby-boomers. Les jeux vidéo n’ont pas encore fait leur apparition, les jouets restent traditionnels. C’est l’arrivée du plastique, qui pour une firme spécialisée dans le « jouet en
métal fin » est un virage difficile et tardif.  Après les
wagons de marchandises, ce sera la nouvelle voie K (Kunstoff = plastique) qui marque un tournant vers le modélisme. Mais il y a aussi les ponts en plastique et les toutes premières voitures
entièrement dans cette matière (cependant Märklin poursuivra la fabrication de celle-ci façon « tin plate et de la voie M jusque dans les années 2000). Mais le plus marquant reste la
diversification. Après les circuits de voitures électriques apparus en 1967 et qui se développent, c’est la période de la diversification des échelles de trains miniature qui suit la mode des
extrêmes. On y verra successivement apparaitre le retour du I (1/32ième écartement de 45mm) la surprenante et rapide apparition du 0e (1/43ième écartement de 16,5mm) et l’avènement
du Z (1/220ième écartement de 6,5mm) revendiquant le titre de plus petit train miniature au monde. C’est cette histoire que je vous détaille dans ce sixième chapitre de la longue saga de
Märklin .
Après les
wagons de marchandises, ce sera la nouvelle voie K (Kunstoff = plastique) qui marque un tournant vers le modélisme. Mais il y a aussi les ponts en plastique et les toutes premières voitures
entièrement dans cette matière (cependant Märklin poursuivra la fabrication de celle-ci façon « tin plate et de la voie M jusque dans les années 2000). Mais le plus marquant reste la
diversification. Après les circuits de voitures électriques apparus en 1967 et qui se développent, c’est la période de la diversification des échelles de trains miniature qui suit la mode des
extrêmes. On y verra successivement apparaitre le retour du I (1/32ième écartement de 45mm) la surprenante et rapide apparition du 0e (1/43ième écartement de 16,5mm) et l’avènement
du Z (1/220ième écartement de 6,5mm) revendiquant le titre de plus petit train miniature au monde. C’est cette histoire que je vous détaille dans ce sixième chapitre de la longue saga de
Märklin .
La couverture du catalogue 1978 illustre bien la diversification des échelles de Märklin entamé entre 1969 et 1972.
 Les nouveautés à l’échelle H0 de la période 1969-1972 sont certes peu nombreuses ; Motrice 103, rame automotrice 515, vapeur BR 86 et Pacific 03 carénée et
Bavaroise BR 18, mais l’effort de Märklin sur cette période a porté sur les autres écartements ; I, H0e, Z ainsi que sur la modernisation des accessoires autour du matériel roulant ; voie K,
nouveaux poteaux de caténaire, système de pont, nouvelle gamme de signaux. C’est aussi pour Märklin une seconde période de reconversion vers l’utilisation de la matière plastque en
remplacement de son matériau traditionnel ; la tôle emboutie.
Les nouveautés à l’échelle H0 de la période 1969-1972 sont certes peu nombreuses ; Motrice 103, rame automotrice 515, vapeur BR 86 et Pacific 03 carénée et
Bavaroise BR 18, mais l’effort de Märklin sur cette période a porté sur les autres écartements ; I, H0e, Z ainsi que sur la modernisation des accessoires autour du matériel roulant ; voie K,
nouveaux poteaux de caténaire, système de pont, nouvelle gamme de signaux. C’est aussi pour Märklin une seconde période de reconversion vers l’utilisation de la matière plastque en
remplacement de son matériau traditionnel ; la tôle emboutie.
 L’Allemagne est en pleine reconstruction, c’est un pays de modernité. Märklin reflète ce boum économique
L’Allemagne est en pleine reconstruction, c’est un pays de modernité. Märklin reflète ce boum économique

 Les couvertures avant et arrière du catalogue 1969 opposent réalités et fictions miniature. Il y a bien sûr toujours les trains H0 qui se modernisent et évoluent vers plus de réalisme avec la voie K à
travers plastique. Le Märklin Métal continu à concurrencer le Meccano. Le Märklin Sprint poursuit son incursion dans le monde du slot car. La nouveauté reste l’apparition des gros trains,
trains à l’échelle I pour jouer à même le sol ou dans le jardin.
Les couvertures avant et arrière du catalogue 1969 opposent réalités et fictions miniature. Il y a bien sûr toujours les trains H0 qui se modernisent et évoluent vers plus de réalisme avec la voie K à
travers plastique. Le Märklin Métal continu à concurrencer le Meccano. Le Märklin Sprint poursuit son incursion dans le monde du slot car. La nouveauté reste l’apparition des gros trains,
trains à l’échelle I pour jouer à même le sol ou dans le jardin.
Avec le LGB et son gros train, capable d’envahir les salons comme de s’aventurer dans les jardins, Märklin constructeur historique se trouve piqué au vif et cherche à réagir. Son choix
, dans un premier temps, sera de reprendre l’écartement I de 45 mm mais pour reproduire les chemins de fer à voie normale au 1/32ième. En 1969, la nouvelle gamme I est directement une
réponse à LGB, basée sur le même concept : un train de grande taille, qui fonctionne à la perfection, fait pour jouer et pouvant être installé en extérieur. La gamme de départ comprend une
030 série 80 de la DB et un locotracteur Henschel. Les carrosseries sont en plastique sur châssis métal, comme Märklin sait le faire. On retrouve les cabines aménagées et les portes
ouvrantes. La voie est à deux files de rails, mais elle reste alimentée en courant alternatif avec le traditionnel système d’inversion de marche par surtension, comme pour l’échelle H0.
Ce choix est fait par Märklin pour éviter d’investir dans de nouvelles alimentations. Le rayon de courbure est serré pour du I à l’échelle nominale. Le parc des wagons comprend un tombereau
et un wagon à double benne basculante (priorité au jeu). Plus tard, en 1970, viendront une voiture des chemins de fer royaux Wurtembergeois à deux essieux et à plateforme ouverte, et un
wagon marchandises couvert décliné dans de nombreuses décorations. Les attelages automatiques sont de type « à mâchoire » sur un principe qui rappelle l’attelage Arnold Rapido en
N. Ainsi renaît en 1969 la gamme à l’échelle 1 de Märklin, qui sera durablement développée jusqu’à nos jours.
 Elle restera cependant longtemps en sommeil, cantonnée aux premiers
modèles pour enfants, avant de prendre en 1978 un nouvel essor, avec la sortie de la vapeur 230 P8 de la DB. A partir de cette époque, ce ne sont plus les enfants qui sont la cible, mais bien
les modélistes. Progressivement, Märklin passera aussi du 2 rails alternatif au système 2 rails mais en courant continu. Fini l’inverseur à surtension pour l’échelle 1. On lui doit même un
modèle français célèbre, qui est la vapeur 241 A de la SNCF, un monstre à cette échelle.
Elle restera cependant longtemps en sommeil, cantonnée aux premiers
modèles pour enfants, avant de prendre en 1978 un nouvel essor, avec la sortie de la vapeur 230 P8 de la DB. A partir de cette époque, ce ne sont plus les enfants qui sont la cible, mais bien
les modélistes. Progressivement, Märklin passera aussi du 2 rails alternatif au système 2 rails mais en courant continu. Fini l’inverseur à surtension pour l’échelle 1. On lui doit même un
modèle français célèbre, qui est la vapeur 241 A de la SNCF, un monstre à cette échelle.
Trois échelles chez Märklin pour une 030T à vapeur, le I, le H0 et le Z

 Le Märklin I avec son côté ludique fait son apparition dans Loco Revue de décembre 1969 (À droite). Le jeu avec des gros trains à destination des enfants est
l’évocation du Märklin Magazin de janvier 1969.
Le Märklin I avec son côté ludique fait son apparition dans Loco Revue de décembre 1969 (À droite). Le jeu avec des gros trains à destination des enfants est
l’évocation du Märklin Magazin de janvier 1969.
 La filiation entre le LGB et le Märklin I des débuts est assez évidente sur le plan des colories. Pour capter la clientèle joueuse avec les « Gros » trains, Märklin
propose une version verte et noire de sa 030T BR80 à partir de 1971 avec les wagons Würtemburgeois en décoration rouge et crème. Même philosophie, mais du LGB à voie étroite, on en
vient aux gros trains à voie normale avec un objectif commun, jouer dans le salon ou dans le jardin.
La filiation entre le LGB et le Märklin I des débuts est assez évidente sur le plan des colories. Pour capter la clientèle joueuse avec les « Gros » trains, Märklin
propose une version verte et noire de sa 030T BR80 à partir de 1971 avec les wagons Würtemburgeois en décoration rouge et crème. Même philosophie, mais du LGB à voie étroite, on en
vient aux gros trains à voie normale avec un objectif commun, jouer dans le salon ou dans le jardin.
 En 1967 à la DB, la P8 assure encore de nombreux trains de banlieue comme ici avec les voitures réf 4042-4043.
En 1967 à la DB, la P8 assure encore de nombreux trains de banlieue comme ici avec les voitures réf 4042-4043.
 Dans le catalogue 1970, Märklin fait référence à son glorieux passé à l’échelle 0 ou I
Dans le catalogue 1970, Märklin fait référence à son glorieux passé à l’échelle 0 ou I
 Le catalogue 1933 présente les mêmes modèles aux deux écartements. La Crocodile passe de 975 marks à 2600 pour l’échelle I. De quoi faire réfléchir, on comprend que le I n’était pas très
courant.
Le catalogue 1933 présente les mêmes modèles aux deux écartements. La Crocodile passe de 975 marks à 2600 pour l’échelle I. De quoi faire réfléchir, on comprend que le I n’était pas très
courant.
 La locomotive tender 030 de la série 80 est le modèle phare des trains Märklin à l’échelle 1. Elle est très détaillée, dotée d’un embiellage métallique Heusigner complet, de porte ouvrante et
d’une cabine aménagée.
La locomotive tender 030 de la série 80 est le modèle phare des trains Märklin à l’échelle 1. Elle est très détaillée, dotée d’un embiellage métallique Heusigner complet, de porte ouvrante et
d’une cabine aménagée.

 Le catalogue Märklin 1970 présente les trains à l’échelle I pour jouer en intérieur aussi bien qu’en extérieur. Un concept qui s’approche du LGB, mais pour de la voie normale.
Le catalogue Märklin 1970 présente les trains à l’échelle I pour jouer en intérieur aussi bien qu’en extérieur. Un concept qui s’approche du LGB, mais pour de la voie normale.
 Le second engin moteur, plus simple de conception est le locotracteur diesel Henschel DHG 500C qui existe à l’échelle H0 depuis 1967, décliné en version électrique EA 800 en 1969.
Le second engin moteur, plus simple de conception est le locotracteur diesel Henschel DHG 500C qui existe à l’échelle H0 depuis 1967, décliné en version électrique EA 800 en 1969.

 Les caractéristiques communes aux modèles de machine à l’échelle I sont:les cabines aménagées dotées de portes ouvrantes et les tampons à ressort. Notez l’attelage qui s’inspire de
l’attelage normalisé en N.
Les caractéristiques communes aux modèles de machine à l’échelle I sont:les cabines aménagées dotées de portes ouvrantes et les tampons à ressort. Notez l’attelage qui s’inspire de
l’attelage normalisé en N.
 La mécanique est dans la tradition Märklin, un moteur à courant alternatif et un inverseur à surtension (ici équipé d’un dispositif électronique pour éviter les à-coups de
surtension). La démultiplication par engrenage droit est généreuse ce qui garantit un fonctionnement lent et souple. L’éclairage de chaque côté s’inverse (via l’inverseur à surtension) et les
ampoules sont dotées de conduit de lumière. Le châssis est en zamac, ce qui compte tenu de la taille, confère du poids au modèle.
La mécanique est dans la tradition Märklin, un moteur à courant alternatif et un inverseur à surtension (ici équipé d’un dispositif électronique pour éviter les à-coups de
surtension). La démultiplication par engrenage droit est généreuse ce qui garantit un fonctionnement lent et souple. L’éclairage de chaque côté s’inverse (via l’inverseur à surtension) et les
ampoules sont dotées de conduit de lumière. Le châssis est en zamac, ce qui compte tenu de la taille, confère du poids au modèle.
 Même configuration pour le locotracteur DHG 500, d’une architecture très proche du modèle H0. Les caisses des machines sont en plastique moulé.
Même configuration pour le locotracteur DHG 500, d’une architecture très proche du modèle H0. Les caisses des machines sont en plastique moulé.

 Les modèles Märklin I font parler d’eux. A gauche, présentation à Alfons Goppel premier ministre allemand de l’époque et Hans Schiller (ministre des finances) lors
de l’inauguration du salon de Nuremberg 1969. La nouveauté pèse son poids. A droite, un restaurant Porto Ricain baptisé « Choo-Choo-trains » est équipé de Märklin I pour servir les plats. Une
idée originale, mais pas idéale pour un diner en amoureux.
Les modèles Märklin I font parler d’eux. A gauche, présentation à Alfons Goppel premier ministre allemand de l’époque et Hans Schiller (ministre des finances) lors
de l’inauguration du salon de Nuremberg 1969. La nouveauté pèse son poids. A droite, un restaurant Porto Ricain baptisé « Choo-Choo-trains » est équipé de Märklin I pour servir les plats. Une
idée originale, mais pas idéale pour un diner en amoureux.

 Les nouveautés du catalogue 1970, seconde année de production de l’échelle I ; voitures voyageurs à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux
Wurtembourgeois, wagons tombereaux simplifiés sans inscription en wagon à rancher.
Les nouveautés du catalogue 1970, seconde année de production de l’échelle I ; voitures voyageurs à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux
Wurtembourgeois, wagons tombereaux simplifiés sans inscription en wagon à rancher.


Les deux versions du tombereau livrable à partir de 1970 sans inscription en version simplifiée. La version verte avec inscription reproduit un modèle belge
immatriculé à la SNCB.
 La très jolie version en décoration rouge et beige de la voiture à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux du Wurtemberg. Doté d’un aménagement
intérieur, de portes ouvrantes et d’un toit amovible, elle est faite pour le jeu.
La très jolie version en décoration rouge et beige de la voiture à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux du Wurtemberg. Doté d’un aménagement
intérieur, de portes ouvrantes et d’un toit amovible, elle est faite pour le jeu.
 Comme nouveauté 1972, il y a un beau wagon couvert type Gls, ici dans sa décoration brune pour le transport de bananes. Il est aussi livrable en blanc pour le transport de bière Union et
en vert destiné à accueillir de la bière Staufenbräu. Le toit est patiné à l’aérographe.
Comme nouveauté 1972, il y a un beau wagon couvert type Gls, ici dans sa décoration brune pour le transport de bananes. Il est aussi livrable en blanc pour le transport de bière Union et
en vert destiné à accueillir de la bière Staufenbräu. Le toit est patiné à l’aérographe.

 La gamme Märklin à l’échelle I restera figée jusqu’à l’apparition de la locomotive P8 en 1978 et des voitures à portières latérales. A partir de là, ce train s’adressera aux modélistes et ne sera plus
un beau jouet destiné en priorité aux enfants.
La gamme Märklin à l’échelle I restera figée jusqu’à l’apparition de la locomotive P8 en 1978 et des voitures à portières latérales. A partir de là, ce train s’adressera aux modélistes et ne sera plus
un beau jouet destiné en priorité aux enfants.
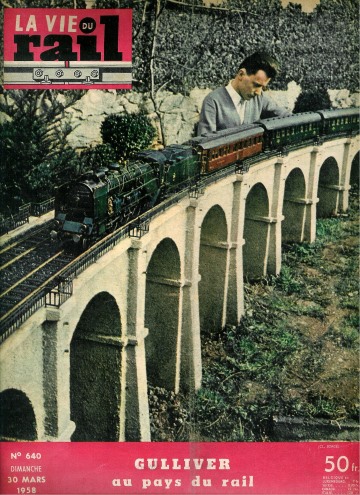 Les trains de jardin ont tout d’abord été une affaire de spécialistes de haute technicité. Avec les trains LGB et Märklin I, tout change, le grand public à possibilité de créer son train de jardin à
partir des années 70. Mais si l’on remonte le temps, un des premiers à se lancer dans l’aventure de la construction d’un réseau complet et réaliste en France est Monsieur G. Munier habitant
Oullins, non loin de Lyon. Après avoir réalisé dès 1926 une rame de six voitures de la CIWL façon teck à l’échelle du 1/27ième, en 1930, il entame l’étude d’une locomotive à vapeur vive de
type Pacific 231 G du PLM. Celle-ci est terminée en 1948 et fonctionne à merveille, chauffée grâce à un brûleur au fuel. C’est alors que la construction d’un grand réseau (31m x 16m) est
entamée à l’écartement de voie de 53 mm soit l’échelle nominale du II. De nombreux ouvrages d’art et viaducs sont construits en béton armé. Le réseau s’insère dans un décor naturel fait
d’arbustes, de thym et de buis, ce qui est une grande nouveauté. Par la suite Monsieur Munier entame la fabrication d’une BB 63000 électrique fonctionnant sur accus, puis d’un véritable
engin à traction diesel électrique, une CC 64000. Elle est dotée d’un petit moteur à essence de 5cm3 couplé à une génératrice 12V, 72W. L’ensemble, décrit dans Loco Revue de décembre
1965, sera ensuite radiocommandé à 7 canaux. Un modèle de complexité.
Les trains de jardin ont tout d’abord été une affaire de spécialistes de haute technicité. Avec les trains LGB et Märklin I, tout change, le grand public à possibilité de créer son train de jardin à
partir des années 70. Mais si l’on remonte le temps, un des premiers à se lancer dans l’aventure de la construction d’un réseau complet et réaliste en France est Monsieur G. Munier habitant
Oullins, non loin de Lyon. Après avoir réalisé dès 1926 une rame de six voitures de la CIWL façon teck à l’échelle du 1/27ième, en 1930, il entame l’étude d’une locomotive à vapeur vive de
type Pacific 231 G du PLM. Celle-ci est terminée en 1948 et fonctionne à merveille, chauffée grâce à un brûleur au fuel. C’est alors que la construction d’un grand réseau (31m x 16m) est
entamée à l’écartement de voie de 53 mm soit l’échelle nominale du II. De nombreux ouvrages d’art et viaducs sont construits en béton armé. Le réseau s’insère dans un décor naturel fait
d’arbustes, de thym et de buis, ce qui est une grande nouveauté. Par la suite Monsieur Munier entame la fabrication d’une BB 63000 électrique fonctionnant sur accus, puis d’un véritable
engin à traction diesel électrique, une CC 64000. Elle est dotée d’un petit moteur à essence de 5cm3 couplé à une génératrice 12V, 72W. L’ensemble, décrit dans Loco Revue de décembre
1965, sera ensuite radiocommandé à 7 canaux. Un modèle de complexité.
Le magnifique réseau de jardin présenté dans la Vie du Rail, dont celui de Mr Munier en mars 1958.
Une autre réalisation remarquable dans le domaine des trains de jardin à vapeur vive sera celle de Louis Garde dans le jardin de sa maison d’Albi. Passionné de mécanique, il entreprend la
construction au 1/20ième d’une locomotive de type 241B. Cette locomotive n’a jamais existé en réalité à la SNCF. C’était un projet sans suite de modernisation des 241A prévu par André
Chapelon. La construction du modèle réduit débute en 1946, elle est se termine en 1955. Les essais sur banc sont concluants ; cette fois, la machine est chauffée à l’anthracite. Elle se
caractérise par sa livrée « façon métal » qui restera vierge de toute peinture, ce qui accentue son aspect moderne. Après la locomotive reste à construire le réseau. Une ceinture de voie unique
est établie autour du pavillon. Surélevé de 60cm pour une meilleure accessibilité, le trajet est ponctué de multiples ponts et tunnel. Sur la base de son réseau, Louis Gardes va lancer avec
Loco Revue un véritable mouvement pour la vapeur vive et l’échelle du 1/20ième. A partir de février 1969, il publie dans Loco Revue une étude en six épisodes pour décrire la construction
d’une 141R à vapeur vive. L’objectif est de faciliter la tâche aux amateurs pour construire un modèle qui jusque-là
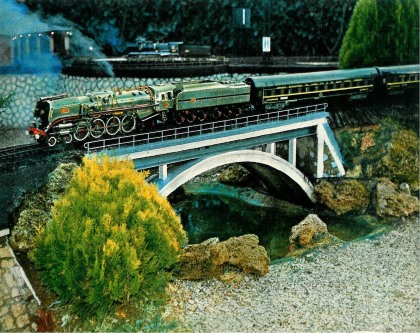 restait l’apanage de quelques rares initiés. Et Monsieur Gardes n’était pas avare de conseils : il invite chez lui les deux premiers amateurs. Et c’est ainsi que le dépôt de Mr Gardes est
photographié garni de 4 magnifiques machines fonctionnelles en couverture du N° 331 de Loco Revue (septembre 1972). L’aventure ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Nul doute, le
mouvement des vaporistes Français à l’échelle du 1/20ième est bien parti d’Albi.
restait l’apanage de quelques rares initiés. Et Monsieur Gardes n’était pas avare de conseils : il invite chez lui les deux premiers amateurs. Et c’est ainsi que le dépôt de Mr Gardes est
photographié garni de 4 magnifiques machines fonctionnelles en couverture du N° 331 de Loco Revue (septembre 1972). L’aventure ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Nul doute, le
mouvement des vaporistes Français à l’échelle du 1/20ième est bien parti d’Albi.
La photo qui m’a fait rêver à l’âge de 7 ans : le merveilleux réseau de Louis Garde illustré dans la Vie du Rail de juillet 1966.

 Le réseau de Louis Garde fait la une des revues de trains miniatures. A partir de février 1969, il décrit dans Loco Revue la construction d’une 141R à vapeur vive
au 1/20ième. Les amateurs suivent et il y aura de quoi remplir le dépôt d’Albi pour la photo historique de droite en 1972.
Le réseau de Louis Garde fait la une des revues de trains miniatures. A partir de février 1969, il décrit dans Loco Revue la construction d’une 141R à vapeur vive
au 1/20ième. Les amateurs suivent et il y aura de quoi remplir le dépôt d’Albi pour la photo historique de droite en 1972.
 Petite révolution en 1969 avec l’apparition de la voie K (Kunstoff ou plastique). Fini le ballast en tôle difficile à intégrer dans le décor pour les Märklinistes. On a ici affaire à une voie à traverse
plastique tout à fait classique à mettre en œuvre, à l’image des produits actuels, mais avec un profilé capable d’accueillir vos matériels anciens. Les deux rails sont isolés et les plots larges,
ce qui limite l’usure des frotteurs (mais les rend très visibles). La version d’origine comporte un rail en acier creux. A partir de 1981, le profilé en maillechort plein est adopté, il est préférable
d’opter pour ce dernier. Gros avantage, la gamme est toujours au catalogue actuel et a fait l’objet d’importants développements. En 1979 apparait un rail flexible de 90 cm, en 1981 des
aiguillages à grand rayon très élégants (angle de déviation de 14°) et une TJD. Cette voie est donc un très bon compromis entre collection et réalisme. Après avoir utilisé la voie modèle
Märklin pour mon réseau en 1992, je l’ai entièrement reconverti en voie K en 2008 sur ballast Merkur, et je ne le regrette pas.
Petite révolution en 1969 avec l’apparition de la voie K (Kunstoff ou plastique). Fini le ballast en tôle difficile à intégrer dans le décor pour les Märklinistes. On a ici affaire à une voie à traverse
plastique tout à fait classique à mettre en œuvre, à l’image des produits actuels, mais avec un profilé capable d’accueillir vos matériels anciens. Les deux rails sont isolés et les plots larges,
ce qui limite l’usure des frotteurs (mais les rend très visibles). La version d’origine comporte un rail en acier creux. A partir de 1981, le profilé en maillechort plein est adopté, il est préférable
d’opter pour ce dernier. Gros avantage, la gamme est toujours au catalogue actuel et a fait l’objet d’importants développements. En 1979 apparait un rail flexible de 90 cm, en 1981 des
aiguillages à grand rayon très élégants (angle de déviation de 14°) et une TJD. Cette voie est donc un très bon compromis entre collection et réalisme. Après avoir utilisé la voie modèle
Märklin pour mon réseau en 1992, je l’ai entièrement reconverti en voie K en 2008 sur ballast Merkur, et je ne le regrette pas.
Publicité dans la revue Modélisme et Maquettes numéro 20 de janvier-mars 1960 présente la voie « Perfect Pullman 60 » qui propose une chaîne de plots montés sur
un travelage plastique. C’est avec 10 ans d’avance, ce que Märklin proposera. Pour la version flexible il faudra encore attendre 1979.
 La voie K de la série 2100 des débuts a un profilé acier roulé, la série 2200, commercialisée à partir de 1981, possède des rails en maillechort plein bien meilleurs
conducteurs.
La voie K de la série 2100 des débuts a un profilé acier roulé, la série 2200, commercialisée à partir de 1981, possède des rails en maillechort plein bien meilleurs
conducteurs.
 La voie K vu de dessus et de dessous comparé à la voie M.
La voie K vu de dessus et de dessous comparé à la voie M.
 Bien entendu, Märklin prévoit un élément de transition de 18cm qui permet de compenser la différence de hauteur.
Bien entendu, Märklin prévoit un élément de transition de 18cm qui permet de compenser la différence de hauteur.

 Le catalogue 1970 comprend déjà des nouveautés pour la voie K comme l’aiguillage triple et les éléments courbes à grands rayons.
Le catalogue 1970 comprend déjà des nouveautés pour la voie K comme l’aiguillage triple et les éléments courbes à grands rayons.
 <
Le catalogue 1978 montre clairement le choix toujours possible (jusqu’en 2000) entre les voies K et M. Le dessin montre les 6 liaisons entre chaque élément de
voie K, les 2 éclisses, les deux languettes conductrices et les deux accouplements à rotule en plastique.
<
Le catalogue 1978 montre clairement le choix toujours possible (jusqu’en 2000) entre les voies K et M. Le dessin montre les 6 liaisons entre chaque élément de
voie K, les 2 éclisses, les deux languettes conductrices et les deux accouplements à rotule en plastique.
 Les nouveaux aiguillages à moteur extra plat sont dotés de lanternes lumineuses mobiles comme ceux de la voie M mais de taille plus réduite.
Les nouveaux aiguillages à moteur extra plat sont dotés de lanternes lumineuses mobiles comme ceux de la voie M mais de taille plus réduite.
 Construit initialement en voie Modèle Märklin (Voir description dans Loco Revue 706), reconversion de mon réseau AL en voie K au début des années 2010. Il faut vivre avec le progrès.
Construit initialement en voie Modèle Märklin (Voir description dans Loco Revue 706), reconversion de mon réseau AL en voie K au début des années 2010. Il faut vivre avec le progrès.

 Le réseau en voie K du catalogue 1969 est présenté dans Märklin Magazin. L’un des tous premiers avec ce nouveau matériel.
Le réseau en voie K du catalogue 1969 est présenté dans Märklin Magazin. L’un des tous premiers avec ce nouveau matériel.
 Dans le catalogue 1970 figure le plan du réseau en voie K. A noter que des aiguillages courbes sont sur ce plan alors qu’ils ne figurent pas encore au catalogue 1969. Ils ne seront
commercialisés que l’année suivante.
Dans le catalogue 1970 figure le plan du réseau en voie K. A noter que des aiguillages courbes sont sur ce plan alors qu’ils ne figurent pas encore au catalogue 1969. Ils ne seront
commercialisés que l’année suivante.
Märklin avait sorti son système de caténaire doté de mâts en plastique (ref 7009) et de caténaire en métal souple estampé en 1952. Il était conçu pour être solidaire de la voie M, sans aucune fixation externe, il n’est pas nécessaire d’en visser les socles. Avec la voie K, l’accrochage des poteaux de caténaire autour du ballast des anciens poteaux ne fonctionne plus. Fidèle à un moyen de fixation autonome, Märklin invente un système de glissière entre les traverses avec les poteaux réf 7509 à partir de 1969. Comme le pas de distance entre chaque poteau est dépendant de la position des traverses, un astucieux système de glissière permet l’ajustement fin ente celles-ci. On en profite pour moderniser le type de poteaux (version d’après-guerre de la DB). Les pylônes destinés aux suspension transversales sont aussi modernisés et affinés. La ligne aérienne en tôle matricée reste identique à la version initiale de 1952. Les anciens poteaux pour la voie M subsistent aux catalogues jusqu’en 1974. Une version du nouveau poteau dotée d’un socle spécifique surélevé pour la voie M est livrable à partir de cette date, toujours sous la référence initiale, 7009.
 Pour la voie K, Märklin invente un système de glissière entre les traverses (à gauche). On en profite pour moderniser le type de poteaux avec une reproduction de la
version d’après-guerre de la DB à treillis perpendiculaires. Les pylônes destinés aux suspension transversales sont aussi modernisés et affinés. A partir de 1974, les nouveaux poteaux seront
disponibles avec des socles surélevés destinés à la voie M (au centre). A droite, les anciens poteaux pour voie M fabriqués de 1952 à 1974.
Pour la voie K, Märklin invente un système de glissière entre les traverses (à gauche). On en profite pour moderniser le type de poteaux avec une reproduction de la
version d’après-guerre de la DB à treillis perpendiculaires. Les pylônes destinés aux suspension transversales sont aussi modernisés et affinés. A partir de 1974, les nouveaux poteaux seront
disponibles avec des socles surélevés destinés à la voie M (au centre). A droite, les anciens poteaux pour voie M fabriqués de 1952 à 1974.
 La ligne aérienne pour la voie K est mise en valeur dans le catalogue 1972 avec ce large triage.
La ligne aérienne pour la voie K est mise en valeur dans le catalogue 1972 avec ce large triage.
 Grâce à la voie K, les beaux modèles peuvent maintenant circuler sur de beaux réseaux fidèles comme ceux réalisés par Bern Schmid modéliste allemand célèbre.
Ici les nouveaux poteaux Märklin réf 7509 sont dotés de fils de caténaire Sommerfeld pour un meilleur réalisme.
Grâce à la voie K, les beaux modèles peuvent maintenant circuler sur de beaux réseaux fidèles comme ceux réalisés par Bern Schmid modéliste allemand célèbre.
Ici les nouveaux poteaux Märklin réf 7509 sont dotés de fils de caténaire Sommerfeld pour un meilleur réalisme.

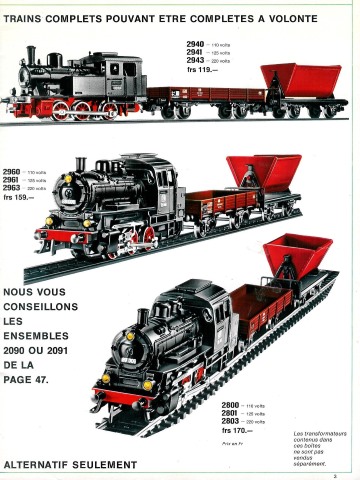 Panachage des coffrets en voie M et K dans le catalogue 1969 à gauche. Le coffret de départ comprenant la vapeur réf 3000 est livrable en deux versions, voie K
ou M illustré dans le catalogue 1970 à droite.
Panachage des coffrets en voie M et K dans le catalogue 1969 à gauche. Le coffret de départ comprenant la vapeur réf 3000 est livrable en deux versions, voie K
ou M illustré dans le catalogue 1970 à droite.
 Le coffret de luxe doté d’aiguillage et comprenant la Pacific 01 est lui proposé en voie K, alors que celui doté de la locomotive diesel V200 reste lui équipé de voie M.
Le coffret de luxe doté d’aiguillage et comprenant la Pacific 01 est lui proposé en voie K, alors que celui doté de la locomotive diesel V200 reste lui équipé de voie M.
 Retour à 100% de coffret en voie M à partir du catalogue 1973.
Retour à 100% de coffret en voie M à partir du catalogue 1973.
 Le système SET avec les coffrets évolutifs et le toporama proposé à partir de 1974 sera le prétexte au retour à la voie M pour les coffrets de départ.
Le système SET avec les coffrets évolutifs et le toporama proposé à partir de 1974 sera le prétexte au retour à la voie M pour les coffrets de départ.

 Malgré l’arrivé de la voie K, le catalogue 1970 met en vedette ce dépôt électrique en pleine page réalisé dans la bonne vieille voie M (à gauche). Le beau réseau en
voie M du catalogue 1964 est à nouveau illustré en pleine page avec cette ambiance particulière dans le catalogue 1970 (à droite)
Malgré l’arrivé de la voie K, le catalogue 1970 met en vedette ce dépôt électrique en pleine page réalisé dans la bonne vieille voie M (à gauche). Le beau réseau en
voie M du catalogue 1964 est à nouveau illustré en pleine page avec cette ambiance particulière dans le catalogue 1970 (à droite)
Les deux grandes marques allemandes de trains miniature se lance simultanément dans les circuits d’autos miniatures en 1967 à la foire de Nuremberg. Pour Märklin, le domaine n’est pas
une véritable nouveauté. En 1934, à la grande époque des trains à l’échelle 0 et I, la firme lance son circuit automobile électrique fonctionnant sous 20 volt alternatif. Les pistes sont constituées
de tronçons qui s’emboitent avec en partie centrale deux conducteurs électriques de profil haut et isolés. Les voitures sont de type Alfa Roméo en métal livrable en deux couleurs, rouge et
blanc. Pour le guidage, un ingénieux système de tambours rotatif vient enserrer les conducteurs à l’avant et à l’arrière.
 . A l’avant, deux frotteurs amènent le courant. Ce système, une fois la voiture en place, permet une tenue de route fantastique. Il y a deux phares dotés d’ampoules électriques à l’avant pour les
courses de nuit. La piste est à voie unique, mais deux rayons de courbure permettent de la doubler et ainsi de pourvoir organiser des courses. Un système de pont et de compte tour complète
l’ensemble. Cette autoroute Märklin ne restera que trois ans au catalogue et disparait en 1938.
. A l’avant, deux frotteurs amènent le courant. Ce système, une fois la voiture en place, permet une tenue de route fantastique. Il y a deux phares dotés d’ampoules électriques à l’avant pour les
courses de nuit. La piste est à voie unique, mais deux rayons de courbure permettent de la doubler et ainsi de pourvoir organiser des courses. Un système de pont et de compte tour complète
l’ensemble. Cette autoroute Märklin ne restera que trois ans au catalogue et disparait en 1938.
Le catalogue Märklin 1937 à la page des « autoroutes électrique », première intrusion de la marque dans le domaine du slot car.
 Les voitures de type Alfa Roméo sont en métal, équipées d’un moteur 20 V alternatif. Des ampoules électriques éclairent les phares. Les pilotes sont en caoutchouc.
Les voitures de type Alfa Roméo sont en métal, équipées d’un moteur 20 V alternatif. Des ampoules électriques éclairent les phares. Les pilotes sont en caoutchouc.

Le système d’accrochage et de prise de courant sur les conducteurs centraux est très particulier. Il permet de coller à la route.

 Dans les années 60, la concurrence dans le domaine des autos de course électrique est rude avec des firmes qui en ont fait leur spécialité comme Scalextric et Circuit 24. L’échelle adoptée
majoritairement est le 1/32 ième.
Dans les années 60, la concurrence dans le domaine des autos de course électrique est rude avec des firmes qui en ont fait leur spécialité comme Scalextric et Circuit 24. L’échelle adoptée
majoritairement est le 1/32 ième.
 L’auteur de ce site est lui-même un fan des Scalextric, le principal concurrent du Märklin Sprint avec Carrera en Allemagne.
L’auteur de ce site est lui-même un fan des Scalextric, le principal concurrent du Märklin Sprint avec Carrera en Allemagne.
 La particularité de Scalextric est de proposer de nombreux accessoires pour le décor autour des pistes. Notez les pistes de déviation qui permettent aux voitures
d’entrée dans les stands.
La particularité de Scalextric est de proposer de nombreux accessoires pour le décor autour des pistes. Notez les pistes de déviation qui permettent aux voitures
d’entrée dans les stands.
 Tout comme Märklin, Scalextric propose des voitures éclairées. Mais aussi des lampadaires de piste et de stand. L’ambiance d’une course de slot car la nuit,
façon 24h du Mans et quelque chose d’incroyable à vivre en miniature.
Tout comme Märklin, Scalextric propose des voitures éclairées. Mais aussi des lampadaires de piste et de stand. L’ambiance d’une course de slot car la nuit,
façon 24h du Mans et quelque chose d’incroyable à vivre en miniature.
 Pour bien affirmer la filiation avec la célèbre course, Scalextric propose des pistes de départ style le Mans.
Pour bien affirmer la filiation avec la célèbre course, Scalextric propose des pistes de départ style le Mans.
 Des modèles reproduisant des vedettes des années 50, Aston-Martin, Vanwall, Cooper, Lister-Jaguar, Mercedes et bien entendu Ferrari.
Des modèles reproduisant des vedettes des années 50, Aston-Martin, Vanwall, Cooper, Lister-Jaguar, Mercedes et bien entendu Ferrari.
 La compétition comme liev motiv autour des circuits électriques. Le jeu permet de s’incarner en champion automobile. Mais chez Märklin, pas de décor. C’est
fonctionnel, mais plus austère.
La compétition comme liev motiv autour des circuits électriques. Le jeu permet de s’incarner en champion automobile. Mais chez Märklin, pas de décor. C’est
fonctionnel, mais plus austère.

 La gamme 1971 des voitures électriques du début des années 70, essentiellement des modèles allemands. La chaparral 2 E de la série américaine Canam et
son gigantesque aileron est une exception. Les GT sont représentés par deux icones de cette époque, la Porsche 911 et la Jaguar type E.
La gamme 1971 des voitures électriques du début des années 70, essentiellement des modèles allemands. La chaparral 2 E de la série américaine Canam et
son gigantesque aileron est une exception. Les GT sont représentés par deux icones de cette époque, la Porsche 911 et la Jaguar type E.
 Märklin reproduit tout de même quelques voitures des années 50 comme cette Ferrari rivale des flèches d’argents de Mercedes.
Märklin reproduit tout de même quelques voitures des années 50 comme cette Ferrari rivale des flèches d’argents de Mercedes.
 La Chaparral 2 E et son aileron, difficile à trouver intact de nos jours, après des courses infernales.
La Chaparral 2 E et son aileron, difficile à trouver intact de nos jours, après des courses infernales.
 Les éléments de piste, bien que rigides, permettent malgré tout de laisser libre court à son imagination.
Les éléments de piste, bien que rigides, permettent malgré tout de laisser libre court à son imagination.
 Le modèle phare de Märklin Sprint, la Porsche Carrera 6 de 1966. Pourtant à cette époque ce sont les monstrueuses Porsche 917de 5 l de cylindré qui sévissent
sur les circuits et pas ce petit prototype de 2l.
Le modèle phare de Märklin Sprint, la Porsche Carrera 6 de 1966. Pourtant à cette époque ce sont les monstrueuses Porsche 917de 5 l de cylindré qui sévissent
sur les circuits et pas ce petit prototype de 2l.
 Les voitures Sprint sont sophistiquées avec une direction fonctionnelle et des patins en aciers alors que les autres fabricants utilisent des tresses qui s’usent
rapidement.
Les voitures Sprint sont sophistiquées avec une direction fonctionnelle et des patins en aciers alors que les autres fabricants utilisent des tresses qui s’usent
rapidement.
 Märklin envisage un système de télécommande. Ce projet est évoqué dans le catalogue 1970, mais il ne sera jamais commercialisé.
Märklin envisage un système de télécommande. Ce projet est évoqué dans le catalogue 1970, mais il ne sera jamais commercialisé.
 Sans doute que les efforts d’investissements nécessaires pour sortir à la fois la gamme à l’échelle I et la nouvelle voie K en sont la raison, mais les nouveautés en matière de matériel roulant
H0 seront très pauvres en 1969. Seul deux nouvelles références côté matériel roulant. Après le diesel industriel Heinschel DHG 500 sorti en 1966, Märklin en extrapole la version EA 800 qui
est mue électriquement avec des batteries rechargeables sur les caténaires de la DB. La livrée est passée du bleu au rouge. Le pantographe unijambiste est emprunté à la BB SNCF
Capitole.
Sans doute que les efforts d’investissements nécessaires pour sortir à la fois la gamme à l’échelle I et la nouvelle voie K en sont la raison, mais les nouveautés en matière de matériel roulant
H0 seront très pauvres en 1969. Seul deux nouvelles références côté matériel roulant. Après le diesel industriel Heinschel DHG 500 sorti en 1966, Märklin en extrapole la version EA 800 qui
est mue électriquement avec des batteries rechargeables sur les caténaires de la DB. La livrée est passée du bleu au rouge. Le pantographe unijambiste est emprunté à la BB SNCF
Capitole.
Le catalogue 1969 est pauvre en nouveautés. Seul la motrice EA 800 est une semi-nouveauté. A noter en tête des pages du catalogue, Märklin donne la parole aux
modélistes qui expliquent en une phrase pourquoi ils sont des adeptes de la marque.
 Basés sur la carrosserie du locotracteur industriel Heinschel DHG 500, elle hérite du pantographe unijambiste de la BB Capitole SNCF et la caisse passe du bleu
ou rouge.
Basés sur la carrosserie du locotracteur industriel Heinschel DHG 500, elle hérite du pantographe unijambiste de la BB Capitole SNCF et la caisse passe du bleu
ou rouge.
 Le locotracteur EA 800 manœuvre en gare. Particularité, il fonctionne sur batterie électrique rechargeable sur la caténaire DB grâce au pantographe.
Le locotracteur EA 800 manœuvre en gare. Particularité, il fonctionne sur batterie électrique rechargeable sur la caténaire DB grâce au pantographe.
 Le locotracteur EA 800 dispose d’une illustration spécifique sur sa boite.
Le locotracteur EA 800 dispose d’une illustration spécifique sur sa boite.
A noter une régression de la locomotive vapeur BR 23. L’ancienne référence 3005 est proposée sous une forme simplifiée avec un embiellage réduit à sa plus simple expression en prenant
une nouvelle référence 3097. Elle dispose également d’une transmission simplifiée avec l’entrainement uniquement sur un seul essieu (les deux autres étant entrainés par les bielles).
Ce modèle aura une très brève existence sur 2 catalogues, celui de 1971 annonçant la reprise du modèle 3005. La seule évolution étant la disparition des rambardes frontales devant les
phares, le moule ayant dû être modifié dans l’intermède. Ce modèle réapparaitra sous la sous-marque Primex à la fois sous sa forme simplifiée entre 1973 et 1977 et sous une forme à
embiellage complet pour une renaissance en 1985 comme série spéciale.
 Existence éphémère au catalogues Märklin 1969 et 1970 de la vapeur 131 BR23 en version à embiellage simplifié sous la nouvelle référence 3097. Elle poursuivra
ensuite sa carrière sous la sous-marque Primex jusqu’en 1977 et le catalogue 1971 affichera la reprise de l’ancienne référence 3005 datant de 1954 pour 2 années encore sous sa forme
à embiellage complet.
Existence éphémère au catalogues Märklin 1969 et 1970 de la vapeur 131 BR23 en version à embiellage simplifié sous la nouvelle référence 3097. Elle poursuivra
ensuite sa carrière sous la sous-marque Primex jusqu’en 1977 et le catalogue 1971 affichera la reprise de l’ancienne référence 3005 datant de 1954 pour 2 années encore sous sa forme
à embiellage complet.
Autre nouveauté qui va séduire les collectionneurs, la version Union Pacific du fameux diesel américain F7. Doté de son dummy sans moteur, ces modèles auront une durée de vie limitée
puisqu’ils disparaissent en 1972. Cette existance réduite à 3 ans va faire rapidement monter sa cote. Pour attiser encore la demande, Märklin sortira le B-Unit (unité sans cabine) qui sera
commercialisé de 1996 à 1999. Cette icone de la fameuse compagnie qui dessert la Californie reste un modèle phare de Mäklin, ceci a fait monter sa côte très haut. L’expérience sera renouvelée
dans les années 2000 avec un coffret comprenant une unité A, deux unités B et un fourgon caboose aux couleurs de l’Union Pacific. La décoration et les détails sont plus fouillés avec des
rambardes ajoutées sur la face avant.
 Le diesel F7 aux couleurs de l’Union Pacific Railroad commercialisé de 1969 à 1972 est devenu un modèle recherché. En 1996 Märklin commercialise en
complément les unités B sans cabine en complément.
Le diesel F7 aux couleurs de l’Union Pacific Railroad commercialisé de 1969 à 1972 est devenu un modèle recherché. En 1996 Märklin commercialise en
complément les unités B sans cabine en complément.
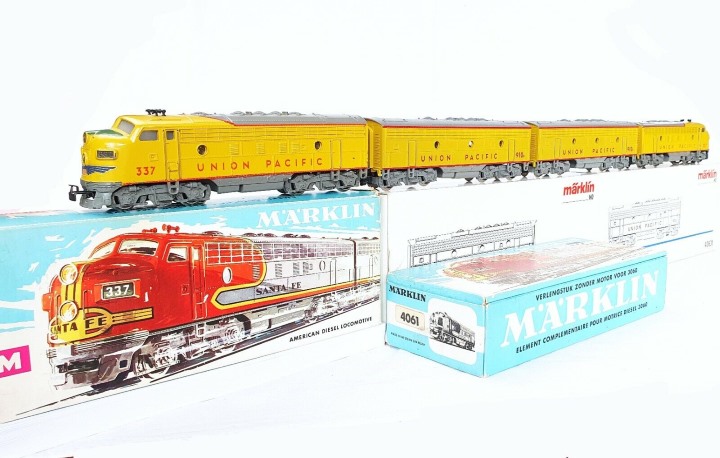 L’illustration sur les emballages ne reproduit pas la décoration Union Pacific, mais la version Santa-Fé.
L’illustration sur les emballages ne reproduit pas la décoration Union Pacific, mais la version Santa-Fé.
 Illustré dans le catalogue 1970 les deux versions des diesels F7 devant des décors US. Celui concernant la version Union Pacific évoque le grand canyon et la
côte Ouest des USA.
Illustré dans le catalogue 1970 les deux versions des diesels F7 devant des décors US. Celui concernant la version Union Pacific évoque le grand canyon et la
côte Ouest des USA.
 La version Union Pacific prend le numéro 337 pour rester cohérent avec le bord number lumineux gravé depuis les précédentes versions, Santa Fé ou New-Haven.
La version Union Pacific prend le numéro 337 pour rester cohérent avec le bord number lumineux gravé depuis les précédentes versions, Santa Fé ou New-Haven.
 Dans les années 2010 Märklin ressort un coffret de F7 aux couleurs de l’Union Pacific comprenant une unité A et deux unités B plus un wagon d’accompagnement.
Dans les années 2010 Märklin ressort un coffret de F7 aux couleurs de l’Union Pacific comprenant une unité A et deux unités B plus un wagon d’accompagnement.
 Le diesel F7 de la nouvelle version est plus détaillée avec des rambardes rapportées.
Le diesel F7 de la nouvelle version est plus détaillée avec des rambardes rapportées.
 Le fourgon caboose du coffret dans une très belle livrée Union Pacific.
Le fourgon caboose du coffret dans une très belle livrée Union Pacific.
La traversée des lieux touristiques du Rhin romantique par ce train de luxe attire de nombreux touristes. Pour les satisfaire, le Rheingold est doté en 1962 avec du matériel entièrement revu. Des voitures de 26m40, aptes à la vitesse de 160km/h sont conçues par l’Office Central du Chemin de Fer Fédéral Allemand. Le parc remorqué pour ce train comprend des voitures panoramiques, une première en Europe. Elles rappellent les fameuses « Vista-dôme » américaines. Une coupole vitrée centrale de 8m permet d’admirer le panorama du Rhin romantique. Avec ce matériel de haut niveau, le Rheingold atteint les normes de confort fixées pour les TEE, ce qui sera validé et 1965. Les rames, à l’origine bleu et crème, seront repeintes aux couleurs TEE, rouge et crème. Entre 1965 et 1967, le Rheingold présentait une mosaïque de couleurs : du rouge et crème, du bleu et crème. Pour tracter le Rheingold, des locomotives électriques E10 sont transformées avec des bogies aptes aux 160km/h. Il faudra attendre le début des années 70 pour voir les séries E03 (qui deviendront 103) remplacer ces locomotives en tête du Rheingold. Märklin se devait de reproduire la célèbre rame allemande. Les voitures sorties en 1966 adoptent directement les couleurs rouge et ivoire. L’une des 4 motrices de présérie de la 103, le type E 03 N° 002 est adoptée pour la traction de cette belle rame composée de 4 types de voitures de la série 24 cm. Logiquement la rame est complétée en 1969 par la célèbre voiture panoramique associée à l’image du Rheingold. Le Rheingold bleu et crème des origines, tracté par la BB E10.3, est proposé par Märklin bien plus tard, en 1996 dans la gamme pour débutants, « Märklin Hobby ». C’est un coffret avec une motrice et trois voitures. Ensuite viendra, en 2018, une nouvelle décoration de la E10 de première série et de l’ensemble des voitures , toujours en version tôle, façon vintage.
 La belle rame TEE de la série tôle de 24cm sortie en 1966 est maintenant complétée en 1969 par la voiture panoramique au centre.
La belle rame TEE de la série tôle de 24cm sortie en 1966 est maintenant complétée en 1969 par la voiture panoramique au centre.
 Variation autour des voitures panoramiques avec celles de HOrnby-acHO à gauche et celles de Märklin. On y retrouve les versions 24cm rouge et crème de 1968 et
bleu et crème de 1996 au premier plan. Puis, en 1974, la tôle est abandonnée pour enfin adopter le plastique. Les voitures s’allongent à 27cm, sans toutefois être reproduites exactement à
l’échelle.
Variation autour des voitures panoramiques avec celles de HOrnby-acHO à gauche et celles de Märklin. On y retrouve les versions 24cm rouge et crème de 1968 et
bleu et crème de 1996 au premier plan. Puis, en 1974, la tôle est abandonnée pour enfin adopter le plastique. Les voitures s’allongent à 27cm, sans toutefois être reproduites exactement à
l’échelle.
 Entrée en gare de Lidentale de Faller de la rame TEE maintenant complète avec sa voiture panoramique.
Entrée en gare de Lidentale de Faller de la rame TEE maintenant complète avec sa voiture panoramique.
 Le catalogue 1969 affiche la nouveauté avec la voiture panoramique. Depuis 1968, toutes les voitures TEE sont maintenant équipées d’un aménagement intérieur.
Le catalogue 1969 affiche la nouveauté avec la voiture panoramique. Depuis 1968, toutes les voitures TEE sont maintenant équipées d’un aménagement intérieur.


Entre le bleu et le rouge, variation autour de la rame Rheingold avec un point commun, la voiture panoramique au centre.
 Le Rheingold atteint les normes de confort fixées pour les TEE en 1965 ce qui lui permet de troquer sa livrée bleu et crème pour le rouge et crème. Pour tracter le
Rheingold, des locomotives électriques E10 sont transformées en attendant les CC 103. Märklin reproduira la rame en couleur d’origine en 1996 dans la gamme pour débutants, « Märklin
Hobby », puis en 2018 dans la gamme normale.
Le Rheingold atteint les normes de confort fixées pour les TEE en 1965 ce qui lui permet de troquer sa livrée bleu et crème pour le rouge et crème. Pour tracter le
Rheingold, des locomotives électriques E10 sont transformées en attendant les CC 103. Märklin reproduira la rame en couleur d’origine en 1996 dans la gamme pour débutants, « Märklin
Hobby », puis en 2018 dans la gamme normale.
 Pour compléter sa rame Suisse de voitures modernes allégées Märklin propose une voiture restaurant équipée d’un pantographe unijambiste. Celui-ci peut être utilisé pour alimenter l’éclairage
de la rame indépendamment du courant de traction et donc délivrer un éclairage permanent à l’arrêt.
Pour compléter sa rame Suisse de voitures modernes allégées Märklin propose une voiture restaurant équipée d’un pantographe unijambiste. Celui-ci peut être utilisé pour alimenter l’éclairage
de la rame indépendamment du courant de traction et donc délivrer un éclairage permanent à l’arrêt.
 En réalité, le pantographe permet une alimentation des cuisines, même si le wagon n’est pas alimenté par la ligne de train, rame en gare et en attente.
En réalité, le pantographe permet une alimentation des cuisines, même si le wagon n’est pas alimenté par la ligne de train, rame en gare et en attente.
Tout comme la France, l’Allemagne a métallisé ses anciennes voitures à trois essieux et à portières latérales de type prussien. L’objectif était de constituer des rames omnibus pour desservir les lignes secondaire à moindre frais, tout en améliorant le confort des voyageurs. Certaines voitures étaient couplées par deux unités de manière définitive. Les deux modèles ; 2ième classe et mixte fourgon sont entièrement en plastique, ce qui est une nouveauté chez Märklin même si l’aventure du plastique avait déjà commencé en 1964 avec la voiture inox SNCF. Le système de roulement permet le débattement de l’essieu central, comme sur les anciennes voitures à portières latérales en tôle. A noter que pour ces dernières, Märklin affiche une reprise de la référence 4005 de cette voiture équipée d’une vigie serre frein qui avait disparu depuis quelques années.
 Les deux voitures métallisées à trois essieux nouveauté 1969. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les
voitures voyageurs.
Les deux voitures métallisées à trois essieux nouveauté 1969. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les
voitures voyageurs.
 La version 2ième classe. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les voitures voyageurs.
La version 2ième classe. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les voitures voyageurs.
Dans la série des wagon apparait un wagon porte-citerne d’acide. Ce modèle à longtemps était la spécialité de la marque Allemande de l’est Piko qui dans les années 60 le reproduisant déjà fidèlement. Le modèle Märklin est détaillé avec un châssis plastique inséré autour d’une tôle qui joue le rôle de lest. Les 12 citernes d’acide sont moulées en orange et une patine brune complète l’ensemble. La rambarde d’extrémité est en tôle emboutie et possède une manivelle serre-frein mobile en plastique. Le wagon est en décoration VTG.
 Le wagon de transport d’acide de Märklin à l’arrière-plan. Ce modèle à longtemps était la spécialité de la marque Allemande de l’est Piko (puis Sachemodel) qui dans
les années 60 le reproduisait déjà fidèlement.
Le wagon de transport d’acide de Märklin à l’arrière-plan. Ce modèle à longtemps était la spécialité de la marque Allemande de l’est Piko (puis Sachemodel) qui dans
les années 60 le reproduisait déjà fidèlement.
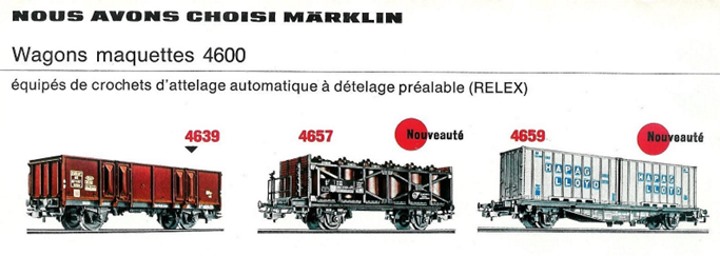 Les deux nouveaux modèles de wagon marchandise de la série 4600 nouveautés 1969, le transport d’acide et le porte conteneur.
Les deux nouveaux modèles de wagon marchandise de la série 4600 nouveautés 1969, le transport d’acide et le porte conteneur.
A partir des années 70 le trafic marchandise va vivre une évolution profonde. On parle beaucoup de déclin au profit de la route, mais pour le ferroviaire il s’agit de s’adapter à la montée en puissance du transport combiné multimodal (route, fer, voie navigable). La pièce centrale de ce mode de transport est le conteneur, des boites empilables dotées d’éléments permettant le levage, la manutention et le transfert entre les modes de transport. Les conteneurs répondent à une normalisation internationale ISO en différentes tailles de 20, 30 ou 40 pieds. Le chemin de fer n’étant pas adapté dans l’esprit des économistes à l’acheminement d’un train composé ayant chacun sa destination propre, c’est le déclin des triages qui disparaissent peu à peu. S’il est nécessaire de ventiler le chargement d’un train entre plusieurs destinations, il y a une solution des caisses mobiles avec les chantiers intermodaux. Le chargement des conteneurs se mécanise avec des portiques dans des chantiers de transbordement. C’est donc la fin des charmants trains de marchandises à la composition hétéroclite pour des trains entiers de composition homogène. Fini les halles à marchandises avec ses manutentionnaires. Cette évolution va aussi se ressentir sur les réseaux miniatures H0 modernes.
 Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie
Nouvelle des Cadres).
Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie
Nouvelle des Cadres).
Märklin sera une des premières marques à proposer des wagons porte-conteneurs en 1969. Bien d’autres marques suivront. La première décoration en 1969. Là aussi, le châssis est en plastique. La toute première décoration (il y en aura ensuite une longue série) est aux couleurs de la société « Hapag Lloyds ». Les conteneur ISO de 20 pieds sont encliquetés solidement dans le châssis. A noter qu’une série de 4 conteneurs dans différentes décoration sera proposée à partir de 1974 comme accessoire.
 En 1969 apparait la première décoration « Hapag Lloyd » du porte conteneur Märklin. D’autres suivront comme la version Sea-Land de 1974, le Renault de 1994 ou
la version Märklin Magazin de 1990. Une série de 4 conteneurs dans différentes décorations sera proposée à partir de 1974 comme accessoire.
En 1969 apparait la première décoration « Hapag Lloyd » du porte conteneur Märklin. D’autres suivront comme la version Sea-Land de 1974, le Renault de 1994 ou
la version Märklin Magazin de 1990. Une série de 4 conteneurs dans différentes décorations sera proposée à partir de 1974 comme accessoire.
Jusqu’à présent Märklin se distinguait par sa gamme de signaux mécaniques à palettes et cible typique de la signalisation allemande (ou Alsace Lorraine pour ce qui nous concerne). Seul deux signaux lumineux figuraient dans sa gamme avant 1969. Changement de cap en 1969 avec un assortiment complet de signaux modernes, tel que ceux en vigueur à la DB à cette époque. Ces signaux sont conçus de manière fort réaliste, autour de micro-ampoules, ce qui se fait de mieux à cette époque. Gros progrès, ils sont prévus pour être séparé de leurs électroaimant de commande et implanté directement en bord de voie grâce à de petites équerres support. Les liaisons électriques se font via des bornes. Comme sur les anciens signaux à palettes (qui restent commercialisé pour encore de nombreuses années) les électroaimants possèdent des contacts de coupure indépendants pour la voie et pour la caténaire. Des plaques de bases sont prévues pour la voie K ou pour la voie M. La gamme proposée en 1969 comporte trois types de signaux d’arrêt (dotés de 2 ou 3 lampes) associés à trois sortes d’avertissements avancés (à 4 lampes) plus un signal de manœuvre à placer à même le sol. Un bien bel ensemble qui permet toutes les combinaisons pour les amateurs. Un nouveau type de relais utilise la commande de ces signaux. Une brochure sera éditée, spécifique pour ces signaux modernes. Les signaux mécaniques datant de 1953 resteront produits pour très longtemps encore, jusqu’au milieu des années 2000.
 La nouvelle gamme de signaux lumineux de la DB dans le catalogue 1969.
La nouvelle gamme de signaux lumineux de la DB dans le catalogue 1969.
 Publicité dans le journal RMF de septembre 1971 vantant les mérites de la nouvelle signalisation en la proposant aux amateurs du système 2 rail continu. En fait,
les signaux Märklin ont toujours été adaptables aux deux systèmes.
Publicité dans le journal RMF de septembre 1971 vantant les mérites de la nouvelle signalisation en la proposant aux amateurs du système 2 rail continu. En fait,
les signaux Märklin ont toujours été adaptables aux deux systèmes.
 Outre le nouveau relais de commande, plus plat que celui des signaux mécaniques, les signaux de la série 7200 peuvent en être séparé de manière à monter les
signaux séparément de leurs relais. Pour cela, des supports sont proposés au catalogue.
Outre le nouveau relais de commande, plus plat que celui des signaux mécaniques, les signaux de la série 7200 peuvent en être séparé de manière à monter les
signaux séparément de leurs relais. Pour cela, des supports sont proposés au catalogue.
 La brochure de réseau pour voie K dans sa version imprimée avant 1972, avec l’ancien logo Märtklin.
La brochure de réseau pour voie K dans sa version imprimée avant 1972, avec l’ancien logo Märtklin.
 Et la version dotée du nouveau logo intermédiaire des années 1973 à 1975.
Et la version dotée du nouveau logo intermédiaire des années 1973 à 1975.

 Des exemples de réseau en configurations classiques qui existaient déjà dans le plan de réseau en voie M.
Des exemples de réseau en configurations classiques qui existaient déjà dans le plan de réseau en voie M.
 En 1970, il y a maintenant 3 écartements dans la gamme des trains Märklin. Après le I redémarré en 1969, s’ajoute le 0e Minex, nouveauté 1970.
En 1970, il y a maintenant 3 écartements dans la gamme des trains Märklin. Après le I redémarré en 1969, s’ajoute le 0e Minex, nouveauté 1970.
 Curieuse intrusion de Märklin dans le domaine de la voie étroite et de l’échelle 0 avec le Minex. Des perspectives nouvelles pour les modélistes amateurs de voie
étroite. L’échelle permet plus de détails sur une surface équivalente au H0. Mais le concept était-il trop en avance sur son temps ?
Curieuse intrusion de Märklin dans le domaine de la voie étroite et de l’échelle 0 avec le Minex. Des perspectives nouvelles pour les modélistes amateurs de voie
étroite. L’échelle permet plus de détails sur une surface équivalente au H0. Mais le concept était-il trop en avance sur son temps ?

 Les deux nouvelles voitures.Le catalogue 1970 illustre la diversité des productions Märklin, Les principaux produits que sont les trains H0 et les circuits Sprint
occupent la 1ière de couverture. Les produits complémentaires que sont le Minex, le Märklin I, le Märklin Métal et les voitures au 1/43ième occupent la 4Ième de couverture autour d’une
photo illustrant le caractère familial du montage d’un réseau. A noter, l’intéressant diorama avec tunnel destiné aux trains Minex.
Les deux nouvelles voitures.Le catalogue 1970 illustre la diversité des productions Märklin, Les principaux produits que sont les trains H0 et les circuits Sprint
occupent la 1ière de couverture. Les produits complémentaires que sont le Minex, le Märklin I, le Märklin Métal et les voitures au 1/43ième occupent la 4Ième de couverture autour d’une
photo illustrant le caractère familial du montage d’un réseau. A noter, l’intéressant diorama avec tunnel destiné aux trains Minex.

 A gauche, publicité pour les nouveaux modèles dans Loco Revue de mars 1970. A droite, description de la nouveauté Märklin Minex dans la revue spécial nouveautés
de la foire de Nuremberg 1970.
A gauche, publicité pour les nouveaux modèles dans Loco Revue de mars 1970. A droite, description de la nouveauté Märklin Minex dans la revue spécial nouveautés
de la foire de Nuremberg 1970.

Minex, c’est un mot nouveau qui apparaît en début d’année 1970 chez les amateurs de trains miniatures, et plus particulièrement ceux de la voie étroite. Pourtant il a déjà été utilisé. Avant 1914, Märklin avait racheté le brevet à l’Anglais Meccano pour fabriquer le célèbre jeu de construction métallique. Après la guerre 14-18, fini les royalties, Märklin poursuit la production de manière autonome. En 1939, un jeu semblable au Märklin Métal est proposé, mais de taille deux fois plus réduite. L’objectif est simple : pouvoir fabriquer des accessoires pour le tout nouveau train miniature à l’échelle 00 que Märklin propose depuis 1935. Les barres en métal sont maintenant en aluminium. L’histoire s’est brusquement interrompue en 1940 avec la guerre et ce jeu de construction n’a jamais été repris après le conflit de 1939-1945, contrairement au jeu de construction Märklin Métal classique. De nos jours, une boîte de construction Minex dans son état d’origine est donc d’une grande rareté.
 Présentation des 3 types de boîtes de construction métallique Minex dans le catalogue Märklin 1939. Au bas de la page, comparaison de la taille réduite de moitié entre le Märklin Métal classique
et le Minex.
Présentation des 3 types de boîtes de construction métallique Minex dans le catalogue Märklin 1939. Au bas de la page, comparaison de la taille réduite de moitié entre le Märklin Métal classique
et le Minex.
 Une rarissime boite N°2 Märklin Minex en état d’origine.
Une rarissime boite N°2 Märklin Minex en état d’origine.

 Le catalogue 1940, le dernier avant le conflit, présente la grande boîte Minex et les réalisations possibles.
Le catalogue 1940, le dernier avant le conflit, présente la grande boîte Minex et les réalisations possibles.
Pour quelle raison, Mârklin reprend le signe « Minex » pour sa nouvelle échelle commerciale, le 0e, c’est-à-dire la voie étroite à l’échelle 0, cela reste un mystère. Il est de tradition à Göppingen d’utiliser des terminaisons en EX, comme « Relex » (système d’attelage) ou « Primex » (Sous-marque à prix réduit pour la grande distribution). Toujours est-il que l’écartement de la voie de 750mm donne au 1/45ième approximativement 16,5mm. L’idée de Märklin est donc simple : utiliser la voie H0, la bonne vieille voie M en métal à plots, pour un matériel au gabarit plus important, en visant notamment les enfants. L’avantage de la méthode est que le stock de rails peut ensuite être réutilisé pour un passage vers le modélisme et l’échelle H0.

 Les pages du catalogue Märklin 1971 dédiées à la grande nouveauté, le Minex.
Les pages du catalogue Märklin 1971 dédiées à la grande nouveauté, le Minex.
 Quasiment tout l’assortiment Märklin Minex sur une seule image. La très brève vie de cette gamme a stoppé brusquement son développement.
Quasiment tout l’assortiment Märklin Minex sur une seule image. La très brève vie de cette gamme a stoppé brusquement son développement.
 La fraîcheur de la jeunesse, cible prioritaire du Minex, illustrée dans le catalogue 1972. De gros jouets pour de petites mains. En 2023 les amateurs qui collectionnent
ces beaux trains ont bien grandi.
La fraîcheur de la jeunesse, cible prioritaire du Minex, illustrée dans le catalogue 1972. De gros jouets pour de petites mains. En 2023 les amateurs qui collectionnent
ces beaux trains ont bien grandi.
Le premier modèle disponible en France, début 1970, est un locotracteur à 3 essieux type Bdh de la firme Gmeinder & Co./Mosbach datant de 1965. En réalité cette locomotive diesel est à 2 essieux, mais, comme Märklin a ajouté des bandages isolants sur le seul essieu moteur pour la force de traction, il est plus prudent d’ajouter un essieu pour la prise de courant. A part cette entorse à la réalité, la maquette reproduit avec réalisme le locotracteur. Le modèle de Märklin possède une caisse en plastique, le châssis moteur est dans la tradition Märklin, en zamac. Le modèle est lourd et la mécanique est fidèle au système 3 rails. Les 3 feux avant sont éclairés par conduit de lumière. La cabine est vitrée et aménagée avec son pupitre, mais pas de conducteur dans le petit diesel.
 Premier modèle livré en 1970, le locotracteur de la firme Gmeinder & Co./Mosbach datant de 1965, type V 12/16.
Premier modèle livré en 1970, le locotracteur de la firme Gmeinder & Co./Mosbach datant de 1965, type V 12/16.
 Ce locotracteur, résolument moderne pour son époque, est conçu pour être affecté au trafic marchandises.
Ce locotracteur, résolument moderne pour son époque, est conçu pour être affecté au trafic marchandises.
Le second modèle sera la grande vedette du Minex côté matériel de traction. C’est la vapeur 030T, référence 3400 de Märklin. Une reproduction d’une vapeur construite par la firme A. Borsig de Berlin. Elle était en service aux chemins de fer Wurtembergeois WEB (Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft) qui exploitaient une voie métrique secondaire entre Amstetten et Laichingen. Pour construire sa 030T, Märklin utilise les roues à rayons qui sont empruntées au modèle H0 de la Pacific 01. Contrairement au locotracteur, les 3 essieux sont entraînés par engrenages droits. Le troisième essieu est muni d’un bandage, ce qui procure au modèle une grande puissance de traction. L’embiellage et sa distribution Allan sont relativement bien reproduits. La cabine comportera un personnage à partir de 1972. Ce personnage, reproduction assez grossière, est composé de matière caoutchouc molle sur une armature métallique. Les yeux et la bouche sont évoqués par de la peinture. Un éclairage à trois feux est présent à l’avant, les lanternes arrière sont fictives.
 Un super beau jouet que cette 030T Borsig.
Un super beau jouet que cette 030T Borsig.
 La 030T Wurtembergeoise reste la plus belle réalisation de Märklin pour sa gamme Minex. Particularité de la machine, elle est livrée avec son chauffeur en caoutchouc (Gummi en allemand).
Il est sérieusement décoré avec les yeux et la bouche peints. De la voie K Märklin sur ballast Merkur améliore le réalisme.
La 030T Wurtembergeoise reste la plus belle réalisation de Märklin pour sa gamme Minex. Particularité de la machine, elle est livrée avec son chauffeur en caoutchouc (Gummi en allemand).
Il est sérieusement décoré avec les yeux et la bouche peints. De la voie K Märklin sur ballast Merkur améliore le réalisme.

 L’annonce du lancement d’un assortiment de trains à voie étroite chez Märklin crée la surprise dans le magazine maison de janvier 1970. La firme propose déjà des modèles pour 3
écartements, et il en viendra un 4ième en 1972 avec le Z.
L’annonce du lancement d’un assortiment de trains à voie étroite chez Märklin crée la surprise dans le magazine maison de janvier 1970. La firme propose déjà des modèles pour 3
écartements, et il en viendra un 4ième en 1972 avec le Z.
 La 030T Wurtembergeoise au sortir du tunnel. La distribution Allan est bien reproduite, mais cependant simplifiée.
La 030T Wurtembergeoise au sortir du tunnel. La distribution Allan est bien reproduite, mais cependant simplifiée.

 A gauche, sur une page intérieure du catalogue 1970, la photo du réseau de présentation du Minex à la foire de Nuremberg cette année-là. A droite, toutes les productions Minex sans exception
sur une seule page du catalogue 1972, dernière apparition. Trois années d’une bien courte aventure.
A gauche, sur une page intérieure du catalogue 1970, la photo du réseau de présentation du Minex à la foire de Nuremberg cette année-là. A droite, toutes les productions Minex sans exception
sur une seule page du catalogue 1972, dernière apparition. Trois années d’une bien courte aventure.
Il n’y aura qu’un modèle de voiture à deux essieux. Le modèle est fidèle, avec des fenêtres à cadre en relief peint reproduisant le bois. Des rambardes métalliques bordent les plateformes d’extrémité. Les voitures possèdent un bel aménagement intérieur reproduisant les rustiques banquettes en bois. Dans la lignée du grand frère LGB, les portes sont ouvrantes et le toit est amovible pour permettre d’installer les passagers. Ce dernier est patiné à l’aérographe sur les côtés, ce qui est du plus bel effet. Deux versions sont disponibles, verte et rouge. Le châssis est en plastique, mais les fusées des roues tournent dans des paliers métalliques.
 Avec son toit amovible, son aménagement intérieur et ses portes ouvrantes, cette voiture est pleine de bonnes surprises.
Avec son toit amovible, son aménagement intérieur et ses portes ouvrantes, cette voiture est pleine de bonnes surprises.
 Märklin démarre sa série de wagons marchandises Minex par deux références en 1971. Tous les wagons utiliseront le même châssis que les voitures. Il y a un tombereau du SWEG livrable
en deux couleurs, brune ou verte. L’intérieur est peint en gris. L’autre wagon de la gamme initiale est un plat avec deux bennes basculantes rouges. Il est dans la tradition des wagons-jouets
fonctionnels que Märklin. L’attelage est celui à boucle des modèles H0, de type « Relex » doté du système à dételage préalable déjà longuement éprouvé depuis 1956. En 1972, seconde
année de vie du Märklin Minex, apparaît un nouveau wagon couvert. Ils disposent de deux portes coulissantes. Märklin a décliné ce modèle en trois versions sous des décorations différentes :
une de couleur brune classique, une version isotherme de couleur blanche et une amusante version bleue avec des fleurs et des marquages Märklin.
Märklin démarre sa série de wagons marchandises Minex par deux références en 1971. Tous les wagons utiliseront le même châssis que les voitures. Il y a un tombereau du SWEG livrable
en deux couleurs, brune ou verte. L’intérieur est peint en gris. L’autre wagon de la gamme initiale est un plat avec deux bennes basculantes rouges. Il est dans la tradition des wagons-jouets
fonctionnels que Märklin. L’attelage est celui à boucle des modèles H0, de type « Relex » doté du système à dételage préalable déjà longuement éprouvé depuis 1956. En 1972, seconde
année de vie du Märklin Minex, apparaît un nouveau wagon couvert. Ils disposent de deux portes coulissantes. Märklin a décliné ce modèle en trois versions sous des décorations différentes :
une de couleur brune classique, une version isotherme de couleur blanche et une amusante version bleue avec des fleurs et des marquages Märklin.
 La gamme des wagons marchandises, sur la base de 3 types différents ; Tombereaux, bennes basculantes et couverts. Notez les belles boîtes bleu roi, spécifiques de l’époque du Minex avec
le traditionnel MÄRKLIN de couleur rouge ou verte. Ce sigle traditionnel vit en 1970 ses dernières années avant sa modernisation.
La gamme des wagons marchandises, sur la base de 3 types différents ; Tombereaux, bennes basculantes et couverts. Notez les belles boîtes bleu roi, spécifiques de l’époque du Minex avec
le traditionnel MÄRKLIN de couleur rouge ou verte. Ce sigle traditionnel vit en 1970 ses dernières années avant sa modernisation.
 La mode chez Märklin est, au cours des années 70, de décorer certains wagons à ses couleurs, comme la citerne à mazout H0. Le couvert bleu MINEX est dans le vent du mouvement Hippy,
d’un style très « Happy flowers ». Bien que peu réalistes, 50 ans plus tard, ces wagons sont parmi les plus recherchés.
La mode chez Märklin est, au cours des années 70, de décorer certains wagons à ses couleurs, comme la citerne à mazout H0. Le couvert bleu MINEX est dans le vent du mouvement Hippy,
d’un style très « Happy flowers ». Bien que peu réalistes, 50 ans plus tard, ces wagons sont parmi les plus recherchés.
 Flyer publicitaire édité en 1970 qui vante les avantages du Minex en première de couverture, avec l’écartement H0 en double page centrale et le I en couverture arrière. A cette époque Märklin
croit encore en sa nouveauté.
Flyer publicitaire édité en 1970 qui vante les avantages du Minex en première de couverture, avec l’écartement H0 en double page centrale et le I en couverture arrière. A cette époque Märklin
croit encore en sa nouveauté.
Märklin sortira son unique accessoire destiné au Minex à l’échelle 0 sous la forme d’un magnifique sémaphore de type allemand. Il est directement monté sur une section ½ droite de voie M et
câblé sur une coupure du conducteur central. Un second élément est livré isolé pour permettre de constituer le canton d’arrêt en intercalant des éléments de voie. Une commande manuelle
agit à la fois sur la palette du sémaphore et comme interrupteur sur le courant de
 traction du conducteur central. Un moyen simple de jouer à même le sol et d’agir sur les trains sans aucun
câblage. Ce seul accessoire destiné au Minex est une très belle pièce devenue rare et difficile à trouver complète dans sa boîte d’origine.
traction du conducteur central. Un moyen simple de jouer à même le sol et d’agir sur les trains sans aucun
câblage. Ce seul accessoire destiné au Minex est une très belle pièce devenue rare et difficile à trouver complète dans sa boîte d’origine.
 Ce qui a sans aucun doute manqué au Märklin Minex, ce sont des accessoires à l’échelle 0. Les amateurs sont obligés pour reproduire un réseau réaliste de tout fabriquer de leurs mains,
comme cette gare construite de toute pièce.
Ce qui a sans aucun doute manqué au Märklin Minex, ce sont des accessoires à l’échelle 0. Les amateurs sont obligés pour reproduire un réseau réaliste de tout fabriquer de leurs mains,
comme cette gare construite de toute pièce.
 Les réseaux d’amateur en Märklin Minex sont rares. Présenté dans Voie Libre N° 104, le très rare réseau Minex de Jean Pierre Bonnet. Une manière originale d’associer collection et réalisme.
La voie est de la Märklin M noyée dans le sol pour plus de réalisme.
Les réseaux d’amateur en Märklin Minex sont rares. Présenté dans Voie Libre N° 104, le très rare réseau Minex de Jean Pierre Bonnet. Une manière originale d’associer collection et réalisme.
La voie est de la Märklin M noyée dans le sol pour plus de réalisme.
Plus aucune trace de l’écartement 0e dans le catalogue 1973. Sans doute trop cher pour jouer ou trop en avance pour intéresser les modélistes, le Märklin Minex entre ainsi dans l’histoire des échecs commerciaux. Il n’en reste pas moins que ce sont de très belles pièces et l’on rêve d’être un enfant des années 70 recevant pour Noël ce magnifique jouet.
Vers le milieu des années 30, la Deutsch Reichbahn décide d’augmenter la vitesse de ses trains. Des essais sont effectués avec deux exemplaire de Pacific 03 en l’équipant d’un carénage.
La Pacific 03 était une version allégée de la Pacific 01 possédait une charge par essieu limité à 17t. Mais sa puissance était limitée, s’agissant d’une locomotive à deux cylindres. Pour
l’augmenter, la DR passe commande de 140 machines de type 03 10 plus puissante, à 3 cylindres et équipé d’un carénage. C’est la firme Borsig de Berlin qui livra les deux premiers
exemplaires en 1939,aptes à rouler à 150km/h. Les locomotives sont accompagnées d’un tender aérodynamique de type T34 à carénage entièrement soudé (plus de rivets sur sa surface).
La mode est au Stromlinienzug avec une série de réalisation comme le train Henschel-Wegmann qui attend 170km/h ou les prototypes 005 001 ou 002 dont cette dernière atteint 200,4 km/h
en mai 1936.
 Le carénage des série 03 en est largement inspiré avec cependant un dégagement de l’embiellage pour des questions de facilité d’entretien. Avec la guerre, la commande ne fût
honorée que partiellement avec 58 unités livrées jusqu’en 1941, l’heure n’était plus à la vitesse. L’effectif restant fût partagé après 1945 entre la DB (26) la DR (21) et les chemins de fer
polonais (10). Les carénages vont beaucoup souffrir pour être démontés entièrement à la DB lors des grandes révisions à partir de 1949. La D Märklin reproduit donc la pacific 03 dans sa
forme d’avant-guerre. L’activité de la dernière 03 10 de la DR cessa en 1971
Le carénage des série 03 en est largement inspiré avec cependant un dégagement de l’embiellage pour des questions de facilité d’entretien. Avec la guerre, la commande ne fût
honorée que partiellement avec 58 unités livrées jusqu’en 1941, l’heure n’était plus à la vitesse. L’effectif restant fût partagé après 1945 entre la DB (26) la DR (21) et les chemins de fer
polonais (10). Les carénages vont beaucoup souffrir pour être démontés entièrement à la DB lors des grandes révisions à partir de 1949. La D Märklin reproduit donc la pacific 03 dans sa
forme d’avant-guerre. L’activité de la dernière 03 10 de la DR cessa en 1971
 Les deux versions de la Pacific carénée BR 03 10, la noire sortie en 1979 et la rouge, nouveauté 1971.
Les deux versions de la Pacific carénée BR 03 10, la noire sortie en 1979 et la rouge, nouveauté 1971.
La sortie de la Pacific 03 en version carénée marque une évolution technique pour Märklin. Pour la première fois sur une locomotive de cette taille, seul un des essieux moteurs est entrainé par la cascade d’engrenage droit. Cet essieu est bandagé. Les autres roues sont entrainées uniquement par les bielles. Cette disposition sera adoptée pour les machines suivantes de la période (BR18 et BR 86). Cela permet d’ajourer les rayons des grandes roues motrices et aussi de dégager la zone sous la chaudière de manière réaliste. Nouveauté également, l’arrière de la chaudière, et le tableau de commande dans la cabine de conduite est reproduit, certes très reculé, mais le moteur n'est plus visible. Pour le reste cette Pacific 03 carénée reste de conception classique avec son châssis et sa caisse en zamac injecté
 Nouveauté dans la conception mécanique chez Märklin, un seul essieu est entrainé par engrenages droits. Auparavant, sur un modèle de cette importance, un train d’engrenage dispatchait la
puissance sur tous les essieux moteurs. Ici ce sont uniquement les bielles qui jouent ce rôle.
Nouveauté dans la conception mécanique chez Märklin, un seul essieu est entrainé par engrenages droits. Auparavant, sur un modèle de cette importance, un train d’engrenage dispatchait la
puissance sur tous les essieux moteurs. Ici ce sont uniquement les bielles qui jouent ce rôle.
 Ma rame Rheingold en tôle sortie par Märklin en 1988 est ici tractée par une Pacific 03 carénée. Une brève période de prestige des chemins de fer Allemand avant de sombrer dans la guerre.
Ma rame Rheingold en tôle sortie par Märklin en 1988 est ici tractée par une Pacific 03 carénée. Une brève période de prestige des chemins de fer Allemand avant de sombrer dans la guerre.
 Autre vedette Märklin illustrant les années 30, le Schienenzeppelin qui sortira lui en 1975. La période des années 30 est à la vitesse et aux carénages.
Autre vedette Märklin illustrant les années 30, le Schienenzeppelin qui sortira lui en 1975. La période des années 30 est à la vitesse et aux carénages.
 Cette Pacific Carénée n’est pas une première pour Märklin. Rappelons nous, en 1939 apparait la fameuse SK800, reproduction de la série 06.
Cette Pacific Carénée n’est pas une première pour Märklin. Rappelons nous, en 1939 apparait la fameuse SK800, reproduction de la série 06.
 Comparaison des deux bêtes carénées devant le catalogue 1947 de la renaissance d’après-guerre, l’une des origines et l’autre plus de 30 années plus tard. Elle a bien entendu gagné en
finesse de reproduction.
Comparaison des deux bêtes carénées devant le catalogue 1947 de la renaissance d’après-guerre, l’une des origines et l’autre plus de 30 années plus tard. Elle a bien entendu gagné en
finesse de reproduction.
Matériel original, les rames ETA 150 (Elektrische Triebwagen für Akkumulatorbetrieb ; Automotrice électrique à batterie) ont été ensuite numérotées BR 515 à la DB. Construite à partir de 1956 à 229 exemplaires, Associé a des remoques équipées de poste de pilotage pour la réversibilité des rames. Elles possèdent une autonomie de 200 à 500km selon les profils et les vitesses des parcours. La vitesse de pointe est de 100km/h. La motrice possède 220 éléments de batterie qui fournissent une tension de 440 volts aux moteurs. A l’heure de la recherche de moyens de locomotion à faible taux d’émission de carbone, la DB était déjà très en avance.

 La rame automotrice à accumulateurs est décrite dans le Märklin Magazin N°3 de 1971 et agrémente les beaux décors du réseau montés par le célèbre modéliste Allemand Bern Schmid.
Notez l’utilisation des nouveaux ponts en position inversée.
La rame automotrice à accumulateurs est décrite dans le Märklin Magazin N°3 de 1971 et agrémente les beaux décors du réseau montés par le célèbre modéliste Allemand Bern Schmid.
Notez l’utilisation des nouveaux ponts en position inversée.
Märklin va reproduire avec beaucoup de rigueur la rame automotrice de la série 515 qui apparait au catalogue 1974 pour disparaitre en 1979. Les deux éléments sont attelés définitivement entre eux avec une liaison électrique. Le moteur entraine les 4 essieux d’un des bogies de la motrice. Les caisses sont en matière plastique dotées de fenêtres avec cadres en relief. Le luxe concerne l’aménagement intérieur des éléments qui possède un éclairage intérieur. Cette rame possède aussi une inversion d’éclairage 3 feux blancs et 2 feux rouge en fonction du sens de marche, commandé par l’inverseur à surtension. Un beau modèle assez coûteux (84 DM en 1970, ce qui correspond au prix de la locomotive à vapeur 030T BR 80 à l’échelle I) ce qui, associé au manque de prestige de l’engin reproduit, explique sa brève carrière.
 La rame série 515 constitue un bel ensemble nécessitant une boite spécifique de grande longueur.
La rame série 515 constitue un bel ensemble nécessitant une boite spécifique de grande longueur.
 deux nouveautés 1970, la rame série 515 et la pacific 03 10 carénée en gare de Schönblick, un modèle très courant de Faller et utilisé par de nombreux amateurs à cette époque car peu
encombrant.
deux nouveautés 1970, la rame série 515 et la pacific 03 10 carénée en gare de Schönblick, un modèle très courant de Faller et utilisé par de nombreux amateurs à cette époque car peu
encombrant.

 Après la voie K et les nouveau signaux, Märklin entre dans l'ère moderne du plastique avec ces nouveaux ponts en plastique.
Après la voie K et les nouveau signaux, Märklin entre dans l'ère moderne du plastique avec ces nouveaux ponts en plastique.
 L’attelage entre les deux éléments des rames 515 est permanent, avec les liaisons électriques permettant l’alimentation de l’éclairage intérieur de la remorque pilote et l’inversion des feux 3
blancs et 2 rouges en fonction du sens de marche.
L’attelage entre les deux éléments des rames 515 est permanent, avec les liaisons électriques permettant l’alimentation de l’éclairage intérieur de la remorque pilote et l’inversion des feux 3
blancs et 2 rouges en fonction du sens de marche.
 Comme chaque année, Märklin ajoute des nouveautés à sa gamme de wagon marchandise série 4600. Elle voit apparaitre en 1970 deux nouveaux modèles. Le premier est un wagon citerne
à bogie. Il est disponible en deux décorations ; blanche aux couleurs de Gazolin et rouge aux couleurs d’Avia. Ces deux décorations auront une durée de vie limitée, jusqu'en 1971 pour le
premier et 1973 pour le second. Ce modèle apparaitra ensuite en de nombreuses autres décorations ; BP, Texaco, Esso, Schell ou Aral. Autre modèle, le nouveau plat à rancher du type
SSImas 53 de la DB. Le châssis est en zamac pour le poids, les renforts de châssis en tôle emboutie. Chaque Rancher est pivotant. A noter aussi que le wagon frigorifique Transfesa
Interfrigo sorti en 1966 passe de la couleur blanche à une seyante couleur bleu. Du côté des wagons à monter de la série 4900 deux nouveautés apparaissent ; le couvert bleu Ford, modèle
exclusif avec une caisse spécifique et le frigorifique vert de la société Staufen Bräu, producteur de bière basée à Göppingen.
Comme chaque année, Märklin ajoute des nouveautés à sa gamme de wagon marchandise série 4600. Elle voit apparaitre en 1970 deux nouveaux modèles. Le premier est un wagon citerne
à bogie. Il est disponible en deux décorations ; blanche aux couleurs de Gazolin et rouge aux couleurs d’Avia. Ces deux décorations auront une durée de vie limitée, jusqu'en 1971 pour le
premier et 1973 pour le second. Ce modèle apparaitra ensuite en de nombreuses autres décorations ; BP, Texaco, Esso, Schell ou Aral. Autre modèle, le nouveau plat à rancher du type
SSImas 53 de la DB. Le châssis est en zamac pour le poids, les renforts de châssis en tôle emboutie. Chaque Rancher est pivotant. A noter aussi que le wagon frigorifique Transfesa
Interfrigo sorti en 1966 passe de la couleur blanche à une seyante couleur bleu. Du côté des wagons à monter de la série 4900 deux nouveautés apparaissent ; le couvert bleu Ford, modèle
exclusif avec une caisse spécifique et le frigorifique vert de la société Staufen Bräu, producteur de bière basée à Göppingen.
 Les nouveautés 1970. Le wagon citerne en décoration Texaco sortira en 1978. Le frigorifique Transfesa est maintenant livré en décoration bleue (initialement blanche).
Les nouveautés 1970. Le wagon citerne en décoration Texaco sortira en 1978. Le frigorifique Transfesa est maintenant livré en décoration bleue (initialement blanche).
 Le plat à ranchers possède un châssis en zamac pour le poids. Chaque Rancher en plastique est pivotant. La boite est spécifique aux nouvelles couleurs de Märklin et l’on doit y ranger le
wagon ranchers repliés.
Le plat à ranchers possède un châssis en zamac pour le poids. Chaque Rancher en plastique est pivotant. La boite est spécifique aux nouvelles couleurs de Märklin et l’on doit y ranger le
wagon ranchers repliés.
 Deux nouveautés au chapitre des wagons à construire ; le couvert Ford et le frigorifique vert Staufen Bräu. Le wagon citerne à mazout à grande capacité est livrable tout monté en livrée
blanche et marquage Märklin. Il reste disponible dans la livrée grise originale pour la version à monter.
Deux nouveautés au chapitre des wagons à construire ; le couvert Ford et le frigorifique vert Staufen Bräu. Le wagon citerne à mazout à grande capacité est livrable tout monté en livrée
blanche et marquage Märklin. Il reste disponible dans la livrée grise originale pour la version à monter.
Le problème des anciens éléments de ponts produit depuis 1948, c’est qu’ils comportaient les éléments de voie inclus dans le tablier. Avec la voie K, leur utilisation reste possible, moyennant l’utilisation d’éléments de transition. Mais il fallait une modernisation. Elle intervient avec les nouveaux éléments dotés de tablier en plastique. On peut y placer des éléments de voie K ou M au choix. Dans un premier temps, les rambardes pour la protection des piétons seront en métal découpé. Elles seront ensuite en plastique moulé.
 Illustré dans le catalogue 1970, la nouvelle gamme de pont est essentiellement destinée à la voie K, les ponts métalliques pour la voie M restent disponibles en 1970 pour disparaitre du
catalogue 1971.
Illustré dans le catalogue 1970, la nouvelle gamme de pont est essentiellement destinée à la voie K, les ponts métalliques pour la voie M restent disponibles en 1970 pour disparaitre du
catalogue 1971.
 Dans le catalogue 1972, un curieux décor entre montagne et lac met en valeur les ponts en matière plastique. Maintenant, les ponts métalliques ont disparu de la vente et la gamme possède
un élément spécial pour la voie M (les entraxes entre voies et rayons de courbure sont différents entre les deux systèmes). Avantage pour cette dernière, des éléments de pont sont disponibles
pour les deux rayons de courbure.
Dans le catalogue 1972, un curieux décor entre montagne et lac met en valeur les ponts en matière plastique. Maintenant, les ponts métalliques ont disparu de la vente et la gamme possède
un élément spécial pour la voie M (les entraxes entre voies et rayons de courbure sont différents entre les deux systèmes). Avantage pour cette dernière, des éléments de pont sont disponibles
pour les deux rayons de courbure.
 Après la voie K, les nouveaux signaux Märklin entrent dans l'ère moderne du plastique avec ces nouveaux ponts.
Après la voie K, les nouveaux signaux Märklin entrent dans l'ère moderne du plastique avec ces nouveaux ponts.
Comme c’est la tradition, Märklin présente un réseau dans le catalogue 1970. Il est plutôt modeste, sur un plateau monobloc de 3,2m x 1,15m. Il est à nouveau composé de voie M, comme un retour aux sources. Nouveauté tout de même, l’utilisation des nouveaux ponts à tablier plastique. Ce réseau utilise au maximum les possibilités du système 3 rails avec deux boucles de retournement intégrées au tracé.

 Les premières pages du catalogue 1970 montrent le réseau de l’année dans une belle complicité familiale. C’est à la page des coffrets de départ, comme pour rappeler que l’objectif est bien de
réaliser un bel ensemble comme celui-ci.
Les premières pages du catalogue 1970 montrent le réseau de l’année dans une belle complicité familiale. C’est à la page des coffrets de départ, comme pour rappeler que l’objectif est bien de
réaliser un bel ensemble comme celui-ci.

 Illustré dans le catalogue 1970 le plan de réseau ovale utilise les nouveaux éléments de pont plastique. Mais contrairement au réseau vedette du catalogue 1969, il n’est pas en voie K mais
revient aux premiers amours de Märklin, la bonne vieille voie M.
Illustré dans le catalogue 1970 le plan de réseau ovale utilise les nouveaux éléments de pont plastique. Mais contrairement au réseau vedette du catalogue 1969, il n’est pas en voie K mais
revient aux premiers amours de Märklin, la bonne vieille voie M.
 Le plan de réseau dans les pages du catalogue 1970. Ce réseau utilise au maximum les possibilités de la voie 3 rails avec deux boucles de retournement au centre du réseau. C’est un réseau
monobloc ovale sur un plateau de 3m20 x 1M15.
Le plan de réseau dans les pages du catalogue 1970. Ce réseau utilise au maximum les possibilités de la voie 3 rails avec deux boucles de retournement au centre du réseau. C’est un réseau
monobloc ovale sur un plateau de 3m20 x 1M15.
Relativement peu de nouveauté dans le catalogue 1971. Après les importants investissements réalisés pour lancer les écartements I et le Minex, ainsi que les importantes gammes que constituent la nouvelle voie K, les nouveaux signaux modernes de la série 7200 et les systèmes de ponts et de caténaires renouvelés, l’année marque une pause. Des ultimes compléments sont apportés à la gamme Minex. La principale nouveauté restera la superbe locomotive à vapeur BR 86.

 Les pages de couverture du catalogue 1971 marque la diversité des produits (Märtklin Sprint et Märklin Métal) et des échelles de trains miniatures (Le I, le 0e et le H0). La principale nouveauté,
la locomotive tender BR 86 est au premier plan.
Les pages de couverture du catalogue 1971 marque la diversité des produits (Märtklin Sprint et Märklin Métal) et des échelles de trains miniatures (Le I, le 0e et le H0). La principale nouveauté,
la locomotive tender BR 86 est au premier plan.
 Rappelez-vous le bon vieux modèle TT 800, massif à souhait, et bien Märklin remet le couvert 20 ans après avec une locotender BR 86 cette fois alliant plastique et métal, ce qui se fait de
mieux en 1971.
Rappelez-vous le bon vieux modèle TT 800, massif à souhait, et bien Märklin remet le couvert 20 ans après avec une locotender BR 86 cette fois alliant plastique et métal, ce qui se fait de
mieux en 1971.
 Ce nouveau modèle est une synthèse des nouvelles techniques alliant la finesse du plastique avec un solide châssis en métal. Des techniques prévoyant les modèles Hamo en 2 rails continu
sont intégrées comme le moulage des cylindres en plastique. L’embiellage est encore affiné et des tuyauteries sont moulées finement en plastique. Le modèle est équipé de l’attelage Telex,
système permettant grâce à l’inverseur à surtension possédant 4 positions. La cabine est équipée de mains montoirs rapportées. Une pièce en plastique reproduit le système de freinage
entre les roues motrices. Comme c’est maintenant la coutume, seul l’essieu arrière est moteur, les 3 autres étant entrainés par les bielles. Un très beau modèle qui aura une belle carrière
Ce nouveau modèle est une synthèse des nouvelles techniques alliant la finesse du plastique avec un solide châssis en métal. Des techniques prévoyant les modèles Hamo en 2 rails continu
sont intégrées comme le moulage des cylindres en plastique. L’embiellage est encore affiné et des tuyauteries sont moulées finement en plastique. Le modèle est équipé de l’attelage Telex,
système permettant grâce à l’inverseur à surtension possédant 4 positions. La cabine est équipée de mains montoirs rapportées. Une pièce en plastique reproduit le système de freinage
entre les roues motrices. Comme c’est maintenant la coutume, seul l’essieu arrière est moteur, les 3 autres étant entrainés par les bielles. Un très beau modèle qui aura une belle carrière
 Comparaison de deux reproductions de la locomotives 141T BR 86 ; le modèle TT 800 de 1951 et la réf 3096 de 1971. Il y a pourtant un perfectionnement qui a disparu, la porte de la boite à
fumée ouvrante qui donne accès à la commande manuelle de l’inverseur de sens de marche à surtension.
Comparaison de deux reproductions de la locomotives 141T BR 86 ; le modèle TT 800 de 1951 et la réf 3096 de 1971. Il y a pourtant un perfectionnement qui a disparu, la porte de la boite à
fumée ouvrante qui donne accès à la commande manuelle de l’inverseur de sens de marche à surtension.
 BR 86 au sortir de son abri, un modèle Pola.
BR 86 au sortir de son abri, un modèle Pola.

 La BR 86 est un modèle courant à la DB avec 385 unités en service dans les années 50 sur les 774 unités construites par la Deutsche Reichbahn. Les autres sont soit en Allemagne de l’est,
soit détruites suite à la guerre. A droite, la BR 86 est sur le réseau de Bern Schmid.
La BR 86 est un modèle courant à la DB avec 385 unités en service dans les années 50 sur les 774 unités construites par la Deutsche Reichbahn. Les autres sont soit en Allemagne de l’est,
soit détruites suite à la guerre. A droite, la BR 86 est sur le réseau de Bern Schmid.
 Nous sommes dans les années 30, le BR 86 assure la correspondance avec un rapide tracté par la 03 10. Les bâtiments sont de la gamme Vollmer.
Nous sommes dans les années 30, le BR 86 assure la correspondance avec un rapide tracté par la 03 10. Les bâtiments sont de la gamme Vollmer.
 Passé la guerre 39-45, l’Allemagne c’est remis économiquement et c’est largement modernisé. Maintenant c’est la motrice 103 qui assure une circulation inter-City. La gare a été intégralement
reconstruite, le faisceau est électrifié. La banlieue comprend maintenant de nombreux immeubles et les peupliers ont grandi.
Passé la guerre 39-45, l’Allemagne c’est remis économiquement et c’est largement modernisé. Maintenant c’est la motrice 103 qui assure une circulation inter-City. La gare a été intégralement
reconstruite, le faisceau est électrifié. La banlieue comprend maintenant de nombreux immeubles et les peupliers ont grandi.
Après les 4 prototypes E 003 présentés en 1965 et capable d’atteindre les 200km/h, la DB passe commande de 143 exemplaires de la version de série baptisée maintenant 103 conformément à la nouvelle numérotation. Les premières sont livrées en 1970 et pendant plus de 20 ans elles constitueront la colonne vertébrale du transport rapide des voyageurs à la DB dont elle reste la motrice la plus puissante avec près de 9000Cv. Pendant longtemps elle a détenu le record de vitesse à la DB avec 283km/h obtenus en 1985. Les différences entre les deux versions sont importantes. Elles portent sur les modifications des persiennes d’aération. Sur le nouveau modèle, la toiture est beige et non plus couleur aluminium. Si la caisse en plastique est une nouvelle gravure, Märklin peut réutiliser le châssis en zamac de la première version sortie en 1966.
 Les différentes versions de CC 103 au fond la E 003 002 sortie en 1966. Devant la reproduction du dernier des 4 prototypes E 003 004 ressorti par Märklin en 2002 avec sa version en Z de
2004. Les versions de série 103 113-7 en H0 de 1971 et en Z de 1974 sont au premier plan.
Les différentes versions de CC 103 au fond la E 003 002 sortie en 1966. Devant la reproduction du dernier des 4 prototypes E 003 004 ressorti par Märklin en 2002 avec sa version en Z de
2004. Les versions de série 103 113-7 en H0 de 1971 et en Z de 1974 sont au premier plan.
 Dans le catalogue 1971, la CC 103 est titrée « fabrication la plus récente de la DB ».
Dans le catalogue 1971, la CC 103 est titrée « fabrication la plus récente de la DB ».
 Passage du TEE Rheingold tracté par la nouvelle CC 103 dans le pont en arc nouvelle version de Märklin.
Passage du TEE Rheingold tracté par la nouvelle CC 103 dans le pont en arc nouvelle version de Märklin.

 Dans le catalogue 1972 la nouvelle CC 103 version de série est illustrée en pleine page. Elle fait aussi la une de Märklin Magazin du deuxième trimestre 1971.
Dans le catalogue 1972 la nouvelle CC 103 version de série est illustrée en pleine page. Elle fait aussi la une de Märklin Magazin du deuxième trimestre 1971.
 Les CC séries E 003 ou 103 ont toujours tenu la vedette dans les catalogues depuis 1966 à travers les années en H0 et en Z. En 2002 Mârklin ressort la rame Rheingold en rouge et crème à
caisse plastique longue.
Les CC séries E 003 ou 103 ont toujours tenu la vedette dans les catalogues depuis 1966 à travers les années en H0 et en Z. En 2002 Mârklin ressort la rame Rheingold en rouge et crème à
caisse plastique longue.
Difficile de comprendre les raisons qui ont conduit Märklin à sortir sa rame TEE néerlando-suisse en version simplifiée. Elle figurait depuis 1965 au catalogue sous les références 3070 et
4070 pour la voiture complémentaire. C’était la reproduction de la rame Suisse Ram 502. Bien que légèrement raccourcie, elle n’avait recueilli que des louanges. Mécaniquement, il n’y a pas
de changement sur la version simplifiée référencée 3071-4071. Elle dispose toujours d’un basculement de l’alimentation sur les frotteurs d’extrémité de la rame, suivant le sens de marche
associé à la réversibilité des fanaux rouges et blancs. La ligne de train existe toujours, mais avec des nouveaux types de connecteurs plus commode à assembler. La simplification réside
dans la suppression de l’éclairage intérieur (peut être parce que l’échauffement des lampes provoquait la déformation du toit des caisses en plastique). Mais il y a aussi la suppression totale
des inscriptions à l’exception des logos Trans Europ Express et des plaques d’itinéraire. Cette absence est difficilement excusable pour un tel modèle. A noter aussi la disparition de la patine
du toit à l’aérographe qui contribuait au réalisme du modèle précédent. De même, l’encadrement des fenêtres de couleur aluminium à disparu.Bref un modèle au rabais, peu digne du prestige
d’un TEE. Le prix est passé à 306F pour la rame de 3 éléments 3071 à comparer aux 313 F du tarif 1969 de la 3070, pas certain que le modéliste gagne grand-chose. Ce modèle sera fabriqué
jusqu’en 1986. Mais sur les mêmes moules, Märklin sortira une nouvelle version à nouveau détaillée et éclairée en 1995, sous la référence 3471. Cette fois il s’agit concernant les inscriptions
de la rame NS DE 1001

 La rame TEE en version simplifiée est présentée comme une nouveauté. Ce n’est pas un progrès, cette nouvelle version est dépouillée d’éclairage et d’inscriptions et d’encadrement de fenêtre
de couleur aluminium.
La rame TEE en version simplifiée est présentée comme une nouveauté. Ce n’est pas un progrès, cette nouvelle version est dépouillée d’éclairage et d’inscriptions et d’encadrement de fenêtre
de couleur aluminium.
 Illustré dans un décor reconstitué au sein du catalogue 1972, la rame TEE dans sa version simplifiée.
Illustré dans un décor reconstitué au sein du catalogue 1972, la rame TEE dans sa version simplifiée.

 Illustré dans le catalogue 1971, les nouvelles voitures et fourgons assortis de chemin de fer privé. Les caisses sont en plastique et la voiture est dotée d’un aménagement intérieur. Ces modèles
auront une très longue vie et restent disponibles de nos jours dans la gamme Märklin Start-Up dans leur décoration verte ou rouge et crème. Plus de 50 années de longévité, un bel exploit.
Illustré dans le catalogue 1971, les nouvelles voitures et fourgons assortis de chemin de fer privé. Les caisses sont en plastique et la voiture est dotée d’un aménagement intérieur. Ces modèles
auront une très longue vie et restent disponibles de nos jours dans la gamme Märklin Start-Up dans leur décoration verte ou rouge et crème. Plus de 50 années de longévité, un bel exploit.
Dans le catalogue 1970, Märklin propose son premier signal lumineux à commande manuel pour la voie K. Le commutateur et le mat sont directement fixés et raccordés sur l’élément de voie joint. Il agit à la fois sur l’interruption du courant traction et sur le changement des feux du rouge au vert. Un second élément de voie, isolé sur le conducteur central permet de définir le secteur d’arrêt. Un seul fil est à branché (jaune) afin d’obtenir l’illumination des feux indépendamment du courant de traction. En 1971 le même principe de « signal pour jouer » est proposé pour la voie M et ce sera aussi le cas du signal réf 7400 proposé pour le Minex. Seule différence pour ce dernier, c’est un sémaphore à aile dont le mouvement est commandé par le commutateur, mais il ne possède pas d’éclairage.
 Le signal à commande manuelle pour la voie M. Un seul fil jaune à raccorder sur le courant d’éclairage et le signal à commande manuelle est opérationnel avec influence sur la marche des
trains. A l’avant plan, le demi-élément de voie isolé sur le conducteur central.
Le signal à commande manuelle pour la voie M. Un seul fil jaune à raccorder sur le courant d’éclairage et le signal à commande manuelle est opérationnel avec influence sur la marche des
trains. A l’avant plan, le demi-élément de voie isolé sur le conducteur central.
Il est de tradition, dans les catalogues Märklin, de découvrir des réseaux emblématiques. Dans celui de 1971, il est particulièrement spectaculaire. Mais en plus, ce qui est nouveau, c’est que des images, sous forme de bandeau en double page, décrivent sa construction au fur et à mesure que l'on feuillète lecatalogue. On y retrouve un père et ses enfants se concentrer sur sa construction. Un véritable témoignage sur ce qui faisait le lien familial autour de notre Hobby dans les années 70. Image d’un bonheur perdu, hélas. A noter, que le réseau est toujours en voie M. La voie K est pourtant beaucoup plus réaliste, mais Märklin tient sa voie M historique.
 Image du bonheur familial dans les années 70. Un père et son fils coopèrent pour construire le réseau emblématique du catalogue 1971.
Image du bonheur familial dans les années 70. Un père et son fils coopèrent pour construire le réseau emblématique du catalogue 1971.
 Tout commence par un déballage des coffrets de départ, un dimanche pluvieux, histoire de se familiariser avec le matériel.
Tout commence par un déballage des coffrets de départ, un dimanche pluvieux, histoire de se familiariser avec le matériel.
 Il est temps de passer au projet d’un réseau important. Le schéma de voie est tracé sur la base de la brochure de plan de réseau et du catalogue. On peut imaginer la validation d’un budget
illimité.
Il est temps de passer au projet d’un réseau important. Le schéma de voie est tracé sur la base de la brochure de plan de réseau et du catalogue. On peut imaginer la validation d’un budget
illimité.
 Rien de mieux que de construire le réseau à même le plateau pour valider le tracé. Avec la voie M, rien de plus facile.
Rien de mieux que de construire le réseau à même le plateau pour valider le tracé. Avec la voie M, rien de plus facile.
 Un travail de menuiserie est indispensable pour les plateformes de voie. Au passage, l’on se forme quelque peu au travail du bois.
Un travail de menuiserie est indispensable pour les plateformes de voie. Au passage, l’on se forme quelque peu au travail du bois.
 Une fois les voies posées, il faut passer au décor, avec dans un premier temps le flocage herbe. L’âme d’artiste peut s’exprimer.
Une fois les voies posées, il faut passer au décor, avec dans un premier temps le flocage herbe. L’âme d’artiste peut s’exprimer.
 Il est temps de passer au montage des ponts en version plastique, et ce réseau en comporte beaucoup.
Il est temps de passer au montage des ponts en version plastique, et ce réseau en comporte beaucoup.
 Le montage de la caténaire est délicat et c’est une bonne formation à la patience.
Le montage de la caténaire est délicat et c’est une bonne formation à la patience.
 Le câblage est aussi complexe, mais il constitue une merveilleuse école de formation à l’électrotechnique.
Le câblage est aussi complexe, mais il constitue une merveilleuse école de formation à l’électrotechnique.
 C’est l’heure des premiers essais. Les copains sont présents pour assister à l’événement. Pour cela, rien de tel que la lourde 150 BR44 avec son châssis articulé.
C’est l’heure des premiers essais. Les copains sont présents pour assister à l’événement. Pour cela, rien de tel que la lourde 150 BR44 avec son châssis articulé.
 La satisfaction est grande de voir les premières rames circuler.
La satisfaction est grande de voir les premières rames circuler.
 Le plan du fameux réseau, avec la liste des références nécessaires qui est fort longue et donc fort chère. J’ai beaucoup rêvé de ce réseau en consultant le catalogue lorsque j’avais 12 ans.
J’aurai tant aimé être à la place du petit garçon. Mais mon père n’avait pas autant de moyens à consacrer au petit train, et je devais me contenter de ma plaque Jouef. Plus tard, avec mes
premières paies en 1984, le Märklin H0 sera mes premiers achats.
Le plan du fameux réseau, avec la liste des références nécessaires qui est fort longue et donc fort chère. J’ai beaucoup rêvé de ce réseau en consultant le catalogue lorsque j’avais 12 ans.
J’aurai tant aimé être à la place du petit garçon. Mais mon père n’avait pas autant de moyens à consacrer au petit train, et je devais me contenter de ma plaque Jouef. Plus tard, avec mes
premières paies en 1984, le Märklin H0 sera mes premiers achats.
 La disposition en 8 du réseau permet un spectaculaire croisement des rames entre le niveau 0 et les nouveaux ponts en arc.
La disposition en 8 du réseau permet un spectaculaire croisement des rames entre le niveau 0 et les nouveaux ponts en arc.
 Vue du réseau à l’autre extrémité. Le tracé est entrelacé pour allonger le parcours de la double voie. Ainsi les rames passent dans la gare dans les deux sens. Particularité du système 3 rails,
les retournements sont aussi possibles dans les 2 sens à travers le triage.
Vue du réseau à l’autre extrémité. Le tracé est entrelacé pour allonger le parcours de la double voie. Ainsi les rames passent dans la gare dans les deux sens. Particularité du système 3 rails,
les retournements sont aussi possibles dans les 2 sens à travers le triage.
La grande nouveauté 1972 est la naissance de l’échelle Z. En moins de 5 ans, c’est la troisième abordée par Märklin après le I et le 0e. Mais ces deux productions resteront limitées, ce qui
dès le départ ne sera pas le cas du Mini-club. Les raisons qui ont poussé la vielle firme de Göppingen à concevoir une échelle totalement inédite, plutôt que de se consacrer au N comme tout
le monde, demeurent un mystère. Pourtant, dès 1962, Märklin étudie cette possibilité qui est quasi prête à la commercialisation deux ans plus tard. Mais ce ne sera pas le choix de firme. Elle
l’annonce officiellement dans une publicité de la revue MIBA de 1968. Pour quelles raisons ? On peut citer, le prix important des micro-échelles qui n’est pas proportionnel à la taille et que
pour le justifier, il faut aller plus loin et donc passer au 1/22ième et à l’écartement de 6,5mm pour que cela vaille le coup. Elle peut aussi revendiquer le titre honorifique de « plus petit train
électrique au monde ». L’aspect « gadget est poussé à son comble. Ce n’est plus une clientèle d’enfant, mais d’adultes qui est visée. Märklin espère que ce train sera adopté par les modélistes
au titre d’un divertissement. Les publicités d’époque parlent de « chemin de fer auxiliaire ». L’Effet cadeau est recherché, la clientèle féminine est aussi visée, les trains, miniaturisés à
l’extrême s’apparentent à des bijoux. Et puis, Märklin en tant que pionnier du train miniature, ne veut pas se laisser imposer une nouvelle échelle. En temps que pilote du marché, elle veut
imposer sa marque (c’était Arnold Rapido qui avait imposé le N). Toujours est-il qu’une firme comme Märklin, de réputation mondiale, ne s’est pas lancée à l’aveuglette dans l’aventure sans
s’appuyer sur une solide étude de marché. Une remarquable opération de promotion est lancée à la rentrée 1972 avec une distribution d’une série spéciale de locomotive BR 89 avec caisse
en or (sans doute plaqué) aux détaillants. Offert en boite spécial et tiré à 100 exemplaires pour la France (2000 pour l’Allemagne) ce modèle est très côté.
 La gamme offerte dès le départ,
en 1972, tend à confirmer que ce n’est pas qu’un ballon d’essai. En effet, plus de 50 références sont présentées la première année ; 4 locomotives, 10 voitures, 11 wagons de marchandise,
4 rayons de courbure, des accessoires, des bâtiments et des signaux. C’est un ensemble complet qui permet, dès la première année, de composer son réseau. Et pour une nouvelle
échelle, beaucoup d’amateurs, dont je faisais partie, vont se sentir une âme de pionnier et se lancer à la conquête de l’Ouest.
La gamme offerte dès le départ,
en 1972, tend à confirmer que ce n’est pas qu’un ballon d’essai. En effet, plus de 50 références sont présentées la première année ; 4 locomotives, 10 voitures, 11 wagons de marchandise,
4 rayons de courbure, des accessoires, des bâtiments et des signaux. C’est un ensemble complet qui permet, dès la première année, de composer son réseau. Et pour une nouvelle
échelle, beaucoup d’amateurs, dont je faisais partie, vont se sentir une âme de pionnier et se lancer à la conquête de l’Ouest.



 Dès la première page intérieure du catalogue Märklin 1972 (à gauche), la couleur est affichée. La nouveauté est présentée comme l’exploit de la création du plus petit train électrique au
monde. Idem pour ce dépliant publicitaire à droite.
Dès la première page intérieure du catalogue Märklin 1972 (à gauche), la couleur est affichée. La nouveauté est présentée comme l’exploit de la création du plus petit train électrique au
monde. Idem pour ce dépliant publicitaire à droite.
Au début des années 60, la marche vers la miniaturisation va se poursuivre, mais cette fois avec des modèles fonctionnels. Les logements modernes de plus en plus exigus posent des problèmes de place pour les amateurs. Depuis les années 40, a déjà eu lieu le passage généralisé de la plupart des grands fabricants du 0 au H0. La firme Arnold, de Nuremberg, veut aller très loin et lance en 1960 une série appelée Rapido 200, fonctionnant sur une voie d’écartement 9mm. Elle est censée être à l’échelle du 1/200e soit deux fois plus réduite que l’écartement TT. Au départ ce petit train ultra miniaturisé a plus une vocation de gadget ou de jouet. La première locomotive, de type diesel V200, est largement surdimensionnée en hauteur et en largeur par rapport à l’échelle affichée. Mais en 1961, Arnold reprend sa copie et adopte les caractéristiques de la future échelle N : 1/160e sur voie de 9 mm.
 Ce nouveau petit train révolutionnaire
va prendre le nom commercial d’Arnold Rapido et va rapidement se développer. Le premier modèle français sera une BB 9200 qui sortira en 1966. Ce modèle est encore très approximatif,
mais le mouvement est lancé et ce coup-ci, la mayonnaise va prendre. L’échelle N est intégrée en 1963 aux Normes Européennes de Modélisme (NEM) MOROP. La firme Arnold Rapido
entraînera rapidement dans son sillage d’autres fabricants au milieu des années 60, comme Trix avec son Minitrix Electric, Lima ou Rivarossi. Mais les constructeurs français comme Jouef
et HOrnby-acHO se montrent frileux et ne tenteront pas l’aventure. Cette réticence de nos constructeurs nationaux aura pour conséquence de limiter dans un premier temps le développement
de cette petite échelle en France.
Ce nouveau petit train révolutionnaire
va prendre le nom commercial d’Arnold Rapido et va rapidement se développer. Le premier modèle français sera une BB 9200 qui sortira en 1966. Ce modèle est encore très approximatif,
mais le mouvement est lancé et ce coup-ci, la mayonnaise va prendre. L’échelle N est intégrée en 1963 aux Normes Européennes de Modélisme (NEM) MOROP. La firme Arnold Rapido
entraînera rapidement dans son sillage d’autres fabricants au milieu des années 60, comme Trix avec son Minitrix Electric, Lima ou Rivarossi. Mais les constructeurs français comme Jouef
et HOrnby-acHO se montrent frileux et ne tenteront pas l’aventure. Cette réticence de nos constructeurs nationaux aura pour conséquence de limiter dans un premier temps le développement
de cette petite échelle en France.
 Une des premières publicités dans le magazine Miniaturbahnen de septembre 1960 pour le Rapido 200. Il est annoncé, ainsi que son nom l’indique, comme étant à l’échelle du 1/200ième,
un compte qui sonne plus rond.
Une des premières publicités dans le magazine Miniaturbahnen de septembre 1960 pour le Rapido 200. Il est annoncé, ainsi que son nom l’indique, comme étant à l’échelle du 1/200ième,
un compte qui sonne plus rond.
 Rapidement le concept s’exporte aux USA, comme le montre cette publicité dans la revue de référence du Nouveau Monde, Model Railroader de juin 1963. Le succès est sans doute favorisé
par la présence sur le sol allemand de GI’s qui raffolent de gadgets faciles à transporter en avion lors du retour au pays. Pour ce qui concerne Märklin et l’échelle Z, ce ne sera qu’à partir de
1984 qu’il s’intéressera à ce marché.
Rapidement le concept s’exporte aux USA, comme le montre cette publicité dans la revue de référence du Nouveau Monde, Model Railroader de juin 1963. Le succès est sans doute favorisé
par la présence sur le sol allemand de GI’s qui raffolent de gadgets faciles à transporter en avion lors du retour au pays. Pour ce qui concerne Märklin et l’échelle Z, ce ne sera qu’à partir de
1984 qu’il s’intéressera à ce marché.
 Extrait du catalogue 1964 à la rubrique des engins de traction. Le choix est déjà large, avec une vocation internationale, des modèles allemands, suisse et américains.
Extrait du catalogue 1964 à la rubrique des engins de traction. Le choix est déjà large, avec une vocation internationale, des modèles allemands, suisse et américains.
 En 1966, la gamme Arnold Rapido s’est déjà considérablement agrandie, l’échelle N du 1/160e est officiellement reconnue et le premier modèle français apparaît avec la BB 9200 et les
voitures inox.
En 1966, la gamme Arnold Rapido s’est déjà considérablement agrandie, l’échelle N du 1/160e est officiellement reconnue et le premier modèle français apparaît avec la BB 9200 et les
voitures inox.
Très rapidement le N prend son essor avec le premier duo composé d’Arnold Rapido bientôt rejoint par Minitrix (version électrique) durant les années 60. Les tout premiers rails, à traverses
en carton, sont remplacés dès 1962 par une voie à profilés acier bruni sur travelage plastique. Les aiguillages sont à angle réduit de 15° et il y a un grand rayon de courbure, ce que de
nombreuses firmes H0 ne proposent pas encore à la même époque. En 1962, Arnold modifie son attelage pour choisir ce qui deviendra universel pour le N ; là aussi, l’échelle H0 était loin
du compte en termes de standardisation.
 En 1967 apparaissent des voitures d’une longueur respectant exactement l’échelle. La même année, autre nouveauté : les moteurs d’aiguillages
amovibles et qui peuvent s’encastrer dans le sol. En 1968, c’est la première plaque tournante modulaire qui apparaît, avec des éléments de voie amovibles pour l’adapter à chaque
configuration. Encore une fois, l’équivalent n’existe pas ailleurs. Ce qui marque aussi la différence, c’est la grande qualité des réseaux et dioramas construits par l’usine.
En 1967 apparaissent des voitures d’une longueur respectant exactement l’échelle. La même année, autre nouveauté : les moteurs d’aiguillages
amovibles et qui peuvent s’encastrer dans le sol. En 1968, c’est la première plaque tournante modulaire qui apparaît, avec des éléments de voie amovibles pour l’adapter à chaque
configuration. Encore une fois, l’équivalent n’existe pas ailleurs. Ce qui marque aussi la différence, c’est la grande qualité des réseaux et dioramas construits par l’usine.
 En 1964, Arnold Rapido est rejoint par le second constructeur qui se lance dans la production de matériel à l’échelle N, Minitrix ; mais cette fois, c’est en version électrique. Les premiers
attelages sont à crochet. Rapidement, à partir de 1965, Minitrix adopte l’attelage Arnold Rapido. L’union fait la force, lorsqu’il s’agit de lancer une nouvelle échelle.
En 1964, Arnold Rapido est rejoint par le second constructeur qui se lance dans la production de matériel à l’échelle N, Minitrix ; mais cette fois, c’est en version électrique. Les premiers
attelages sont à crochet. Rapidement, à partir de 1965, Minitrix adopte l’attelage Arnold Rapido. L’union fait la force, lorsqu’il s’agit de lancer une nouvelle échelle.

La miniaturisation ne s’arrêtera pas à l’échelle du 1/160e. Une étude de marché faite par Märklin montre la faible part potentielle de cette échelle, soit entre 13 et 15%. Et comme plusieurs
fabricants sont déjà sur ce secteur, il fût décider d’abandonner, bien que 2 locomotives, des voitures et des wagons sont déjà prêt pour être commercialisé dès 1968. Voulant se démarquer,
Märklin, la firme pionnière du H0, refuse de l’adopter et l’étude d’une échelle plus petite, garantissant des débouchés plus prometteurs est entamée. Elle lance en 1972 une nouvelle échelle,
dénommée Z (sans doute pour bien marquer, avec la dernière lettre de l’alphabet, que l’on ne pourra pas faire plus petit).
 L’écartement adopté est de 6,5mm et l’échelle du 1/220ième. On mesure le chemin parcouru en à peine 12 ans, entre la naissance du N et cette nouvelle échelle. Les petites échelles ont un
attrait que Märklin a judicieusement mis en valeur. Arnold puis Märklin ont successivement monopolisé le titre envié de plus petit train électrique du monde.
L’écartement adopté est de 6,5mm et l’échelle du 1/220ième. On mesure le chemin parcouru en à peine 12 ans, entre la naissance du N et cette nouvelle échelle. Les petites échelles ont un
attrait que Märklin a judicieusement mis en valeur. Arnold puis Märklin ont successivement monopolisé le titre envié de plus petit train électrique du monde.
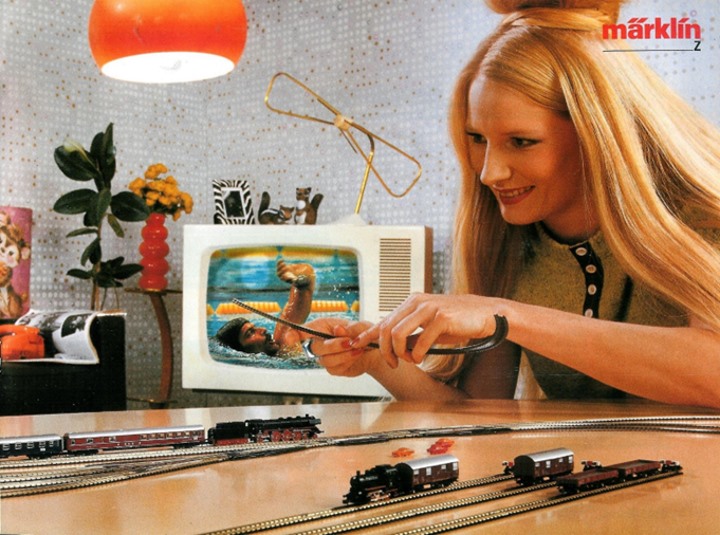 La brochure des nouveautés 1997 Märklin fête les 25 ans du Mini-Club avec cette reconstitution évocatrice de son année de naissance, 1972 : intérieur kitch, couleur orange mode, téléviseur
portatif en couleur qui diffuse l’Américain Marc Spitz réalisant ses exploits en natation lors des JO de Munich. Et cette jeune femme qui découvre la petitesse du Mini Club et qui l’apprécie tel
un bijou.
La brochure des nouveautés 1997 Märklin fête les 25 ans du Mini-Club avec cette reconstitution évocatrice de son année de naissance, 1972 : intérieur kitch, couleur orange mode, téléviseur
portatif en couleur qui diffuse l’Américain Marc Spitz réalisant ses exploits en natation lors des JO de Munich. Et cette jeune femme qui découvre la petitesse du Mini Club et qui l’apprécie tel
un bijou.
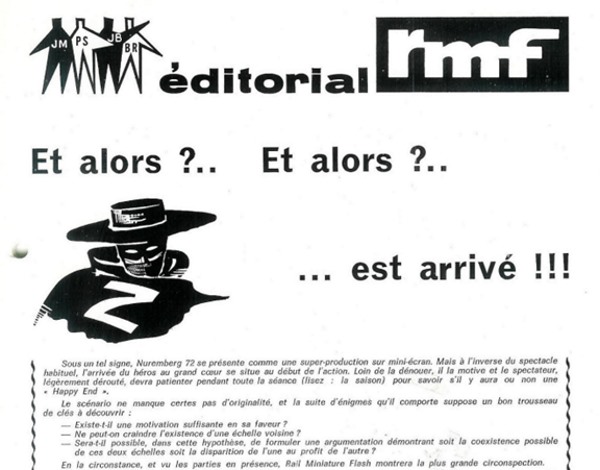 Editorial de la revue RMF de mars 1972 spécial Nuremberg. Le journal est circonspect vis-à-vis de l’avenir de cette échelle. Et pourtant plus de 50 ans après, elle est toujours bien vivante.
Editorial de la revue RMF de mars 1972 spécial Nuremberg. Le journal est circonspect vis-à-vis de l’avenir de cette échelle. Et pourtant plus de 50 ans après, elle est toujours bien vivante.

 Les extrêmes selon Märklin, de l’échelle I (1 :32ième) relancée en 1969 à la micro-dimension du Z (1/220ième) grande nouveauté de 1972.
Les extrêmes selon Märklin, de l’échelle I (1 :32ième) relancée en 1969 à la micro-dimension du Z (1/220ième) grande nouveauté de 1972.

 Plutôt présenté au départ comme un loisir « gadget » pour épater les amis, Märklin compte bien malgré le lancement du Z conserver ses nombreux clients H0.
Plutôt présenté au départ comme un loisir « gadget » pour épater les amis, Märklin compte bien malgré le lancement du Z conserver ses nombreux clients H0.

 Au centre de la brochure spécifique Mini Club de 1972, le tout premier réseau présenté par l’usine à la foire de Nuremberg 1972. Et toujours cette ambiance familiale traditionnelle un peu
désuète. Plus tard, en 1974, Märklin s’attachera à rajeunir l’image du Mini-Club. Le Mini-Club doit séduire une nouvelle clientèle. Les emballages présentation bois de teck permettent de
distinguer les articles en Z. Les deux premières boites de départ proposées en 1972 ne disposent pas d’alimentation. Ce sera corrigé en 1974 avec un coffret de départ doté de son
transformateur, toujours sur la base de la 030T BR 89.
Au centre de la brochure spécifique Mini Club de 1972, le tout premier réseau présenté par l’usine à la foire de Nuremberg 1972. Et toujours cette ambiance familiale traditionnelle un peu
désuète. Plus tard, en 1974, Märklin s’attachera à rajeunir l’image du Mini-Club. Le Mini-Club doit séduire une nouvelle clientèle. Les emballages présentation bois de teck permettent de
distinguer les articles en Z. Les deux premières boites de départ proposées en 1972 ne disposent pas d’alimentation. Ce sera corrigé en 1974 avec un coffret de départ doté de son
transformateur, toujours sur la base de la 030T BR 89.
D’emblée, 4 engins moteur sont proposés. Deux micros-engins, de moins de 49mm de longueur, la 030T BR 89 et le diesel de manœuvre série 260. La BB diesel série 216 et le modèle
phare la Pacific 231 série 03 complètent l’offre. Tous les châssis sont en zamac pour le poids. Les caisses le sont également sauf pour la BB diesel qui adopte le plastique. La miniaturisation
des moteurs est un élément clé pour une si petite échelle. Les ingénieurs de Märklin se sont surpassés pour établir un record pour l’époque. Pour leur petite taille les engins fonctionnent à
merveille. Cette qualité mécanique fera que l’amateur que je suis, habitué aux caprices de fonctionnement du Jouef H0 de l’époque, adoptera en 1980 cette échelle Z après avoir testé un
premier coffret doté de la petite 030 T.
 L’offre en matériel traction de 1972. Notez à gauche le premier type de boite pour locomotive avec l’ancien sigle Märklin. A droite, la nouvelle boite avec le logo de 1976. Le point commun est
la pipe qui sert de support de la 030T BR 89. Mais la blonde offre un look plus moderne sur la boite de droite pour rajeunir l’image du petit train. Associés à des bijoux, les modèles Mini-Club
tentent une percée vers la clientèle féminine, à minima pour offrir.
L’offre en matériel traction de 1972. Notez à gauche le premier type de boite pour locomotive avec l’ancien sigle Märklin. A droite, la nouvelle boite avec le logo de 1976. Le point commun est
la pipe qui sert de support de la 030T BR 89. Mais la blonde offre un look plus moderne sur la boite de droite pour rajeunir l’image du petit train. Associés à des bijoux, les modèles Mini-Club
tentent une percée vers la clientèle féminine, à minima pour offrir.
 L’offre en matériel traction de 1972. Quatre modèles, tous électriques ou diesel. Le catalogue spécifique Mini-Club présente les modèles à taille réelle. La catenaire ne sera proposée qu’en
1975.
L’offre en matériel traction de 1972. Quatre modèles, tous électriques ou diesel. Le catalogue spécifique Mini-Club présente les modèles à taille réelle. La catenaire ne sera proposée qu’en
1975.
 Pour un amateur de Märklin H0, la taille du Mini-club surprend. Les emballages pour locomotives datant de 1972 sont identifiables aussi à l’intérieur par leur notice avec l’ancien logo Märklin et
par l’insert floqué de velours gris. Après 1972 il sera blanc et brut de plastique.
Pour un amateur de Märklin H0, la taille du Mini-club surprend. Les emballages pour locomotives datant de 1972 sont identifiables aussi à l’intérieur par leur notice avec l’ancien logo Märklin et
par l’insert floqué de velours gris. Après 1972 il sera blanc et brut de plastique.
 L’ensemble du matériel moteur disponible en 1972 en action sur l’un des réseaux disponibles cette année-là. Au premier plan, un élément dételeur disponible dès 1972 dans la gamme des
éléments de voie.
L’ensemble du matériel moteur disponible en 1972 en action sur l’un des réseaux disponibles cette année-là. Au premier plan, un élément dételeur disponible dès 1972 dans la gamme des
éléments de voie.
 Le modèle phare sorti en 1972, la BR 01 arrive dans la reproduction de la gare de Göppingen d’architecture moderne. Sur les vapeurs, l’embiellage est simplifié, une concession à la petitesse.
Le modèle phare sorti en 1972, la BR 01 arrive dans la reproduction de la gare de Göppingen d’architecture moderne. Sur les vapeurs, l’embiellage est simplifié, une concession à la petitesse.
 Si l’on compare les modèles H0 et Z du diesel série 260, on note seulement quelques petites simplifications. L’absence d’éclairage fonctionnel, du faux essieu moteur, d’une bielle matricée
rouge et les rayons des roues non débouchant. Pour le reste, inscriptions et rambardes sont conformes.
Si l’on compare les modèles H0 et Z du diesel série 260, on note seulement quelques petites simplifications. L’absence d’éclairage fonctionnel, du faux essieu moteur, d’une bielle matricée
rouge et les rayons des roues non débouchant. Pour le reste, inscriptions et rambardes sont conformes.
 Pour le diesel série 260, Märklin a respecté l’entraxe différent des essieux et n’a pas réutilisé le châssis de la vapeur BR 89.
Pour le diesel série 260, Märklin a respecté l’entraxe différent des essieux et n’a pas réutilisé le châssis de la vapeur BR 89.
Les voitures étudiées par l’Office central de la Bundesbahn mises en service à partir de 1954 sont omniprésentes à la DB et dans les catalogues Märklin depuis 1959. Cependant en réalité, elle mesure 26,4m soit à l’échelle H0 environ 30cm. Vu les rayons de courbure utilisé en H0, pas question de reproduire cette longueur et Märklin cantonne ses premières productions en tôle à 24cm pour basculer à partir de 1972 sur 27cm pour les reproductions à caisses en plastique. A l’échelle Z la longueur exacte est 12cm et cette fois, elle est bien respectée. Les voitures sont remarquablement reproduites avec leurs bogies Minden-Deutz directement équipés de l’attelage Mini-Club. Les encadrements de fenêtre possèdent des cadres en relief peint couleur aluminium. Les inscriptions sont parfaitement lisibles avec une loupe. De très beaux modèles disponibles suivant quatre moules différents, 1ière classe, 2ième classe, fourgon et voitures restaurant de la DSG. Deux décorations sont proposées, les teintes classiques verte, bleu et rouge des voitures durant les années 60 et les nouvelles teintes dites « pop » qui sont expérimentales à la DB au début des années 70 et qui ne seront pas adoptées finalement, à part sur quelques voitures.

 Le catalogue spécifique pour le Z propose sur sa double page les modèles de wagons et voitures. Les véhicules sont présentés en taille réelle.
Le catalogue spécifique pour le Z propose sur sa double page les modèles de wagons et voitures. Les véhicules sont présentés en taille réelle.
 Les nouvelles voitures sont bien à l’échelle, contrairement aux modèles H0 très raccourcis. En réalité elles mesurent 26,4m soit à l’échelle H0 environ 30cm et 12cm à l’échelle Z.
Les modèles Märklin H0 font 24cm, mais 12cm en Z.
Les nouvelles voitures sont bien à l’échelle, contrairement aux modèles H0 très raccourcis. En réalité elles mesurent 26,4m soit à l’échelle H0 environ 30cm et 12cm à l’échelle Z.
Les modèles Märklin H0 font 24cm, mais 12cm en Z.
 Les voitures en décoration Pop de Mini Club. Des nouvelles couleurs expérimentées par la DB sur quelques voitures, mais qui ne seront pas adoptées en définitif.
Les voitures en décoration Pop de Mini Club. Des nouvelles couleurs expérimentées par la DB sur quelques voitures, mais qui ne seront pas adoptées en définitif.
 L’ensemble des wagons à deux essieux de la gamme Z initiale de 1972 (il manque le citerne Esso).
L’ensemble des wagons à deux essieux de la gamme Z initiale de 1972 (il manque le citerne Esso).
Globalement, le matériel remorqué est à la hauteur du matériel moteur, voir plus détaillé. Il ne manque rien, tous les détails sont scrupuleusement reproduits. Les peintures satinées sont soignées et les délimitations sont nettes. C’est pour les inscriptions que Märklin réalise des exploits. Chaque mot est lisible à la loupe. Les ensembles roues et essieux sont maintenus en place par deux doigts en plastique. Les axes sont en métal et les roues en plastique sur les premières productions Mini-Club. A partir de 1979, Märklin adoptera des roues en métal, c’est donc un moyen de distinguer les toutes premières production Min-Club. Les attelages adoptés par Märklin sont inédits, même s’ils ressemblent vaguement aux premières production HOrnby-acHO. Le reproche que l’on peut faire est leur forte taille, mais cet inconvénient disparait après couplage. Ils sont très souples et fonctionne correctement malgré le faible poids des wagon qui peut descendre à 3g. Comme l’attelage HOrnby-acHO, on peut retirer un véhicule d’une rame par simple préhension vertical sans toucher aux coupleurs. Un avantage important à cette échelle. Le dételage peut être commandé à distance par un élément spécial comprenant une rampe électromagnétique. Le comportement au roulement du matériel est excellent. En fait, le Mini-Club a tout d’un grand train.
 Les mêmes wagons en situation sur le grand réseau Toporama Mini Club.
Les mêmes wagons en situation sur le grand réseau Toporama Mini Club.
 Ou sur le second petit réseau Mini-Club de 1972. Le Schienenbus sera produit à partir de 1973 et la remise en 1974. Pour le reste nous avons sur cette photo les éléments de la gamme
initiale de 1972 du Mini-Club.
Ou sur le second petit réseau Mini-Club de 1972. Le Schienenbus sera produit à partir de 1973 et la remise en 1974. Pour le reste nous avons sur cette photo les éléments de la gamme
initiale de 1972 du Mini-Club.
 Les premières générations de wagon Mini-Club sont dotées de roues en plastique jusqu’en 1979. Les premières boites sont dotées d’inserts floqués de gris façon velours. Ils seront ensuite
en plastique blanc brut. Les rambardes des wagons citerne sont en tôle emboutie d’une incroyable finesse.
Les premières générations de wagon Mini-Club sont dotées de roues en plastique jusqu’en 1979. Les premières boites sont dotées d’inserts floqués de gris façon velours. Ils seront ensuite
en plastique blanc brut. Les rambardes des wagons citerne sont en tôle emboutie d’une incroyable finesse.
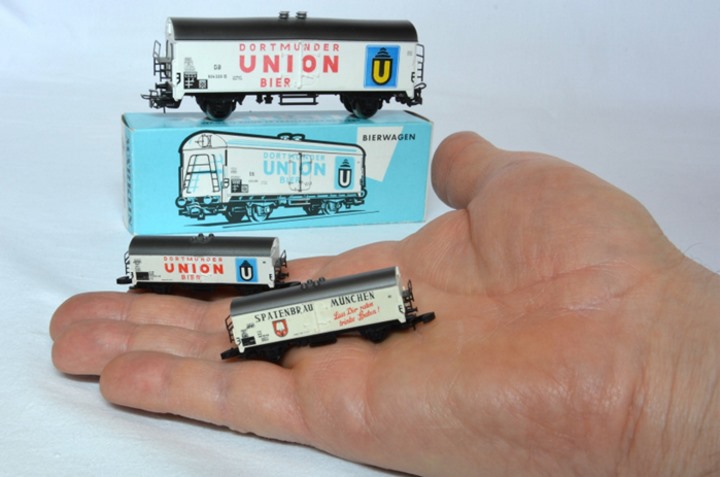 Il est maintenant possible de dire "donnez moi une poignée de wagons". Comparaison des versions H0 et Z du wagon frigorifique Dortmünder Union.
Il est maintenant possible de dire "donnez moi une poignée de wagons". Comparaison des versions H0 et Z du wagon frigorifique Dortmünder Union.
 Les inscriptions sont d’une incroyable finesse, lisible uniquement à la loupe. Notez sur le wagon frigorifique l’inscription rouge « Lass Dir raten, trinke Spaten » « Laisse toi conseiller, bois de
suite ».
Les inscriptions sont d’une incroyable finesse, lisible uniquement à la loupe. Notez sur le wagon frigorifique l’inscription rouge « Lass Dir raten, trinke Spaten » « Laisse toi conseiller, bois de
suite ».
 Le wagon frigorifique type Ichqrs 50 donnera lieu à d’innombrables décorations dont certaines en versions françaises. Une expression ferroviaire de la passion internationale pour les
spiritueux.
Le wagon frigorifique type Ichqrs 50 donnera lieu à d’innombrables décorations dont certaines en versions françaises. Une expression ferroviaire de la passion internationale pour les
spiritueux.
La voie à l’échelle Z est très inspirée des voies I et K sorti es par Märklin à la même époque, à l’exception de la taille bien entendu. L’écartement entre les faces internes des champignons est
donc de 6,5mm, ce qui correspond à de la voie métrique à l’échelle N. Cette caractéristique sera beaucoup utilisée ensuite par les modélistes. Les profilés sont en maillechort pour une bonne
conductibilité électrique. Les tirefonds sont venus de moulage avec le travelage en plastique brun. La largeur du champignon est très en dehors de l’échelle, ce point est rendu nécessaire
pour assurer une surface de contact suffisante pour la captation du courant par les roues.
 Les traverses sont dotées de trous régulièrement espacés pour permettre la fixation par de
minuscules petits clous. L’éclissage se fait de façon classique avec un peu d’attention et sous un bon éclairage. Un système de verrouillage par encliquetage parfait la bonne tenue des
éléments de voie entre eux. Ce système est une particularité héritée des voies à l’échelle I et de la voie K H0.
Les traverses sont dotées de trous régulièrement espacés pour permettre la fixation par de
minuscules petits clous. L’éclissage se fait de façon classique avec un peu d’attention et sous un bon éclairage. Un système de verrouillage par encliquetage parfait la bonne tenue des
éléments de voie entre eux. Ce système est une particularité héritée des voies à l’échelle I et de la voie K H0.
Particularité de la voie Mini-Club, le système de verrouillage par encliquetage présent sous les éclisses qui vient solidariser le travelage plastique. C’est un système hérité de la voie K qui
consolide grandement les assemblages.
 Les aiguillages ont un moteur extra plat. Des lamelles de contact au fond de la pointe de cœur assurent la continuité électrique. Notez la taille monstrueuse des fiches. A droite les attelages
à mâchoire Mini-Club.
Les aiguillages ont un moteur extra plat. Des lamelles de contact au fond de la pointe de cœur assurent la continuité électrique. Notez la taille monstrueuse des fiches. A droite les attelages
à mâchoire Mini-Club.
Les aiguillages sont d’emblée disponibles en deux versions, manuelles ou à commande électromagnétique. Les moteurs extra-plats et de faible encombrement s’inscrivent dans la partie courbe, ce qui permet n’importe quelle combinaison de plusieurs éléments successifs. Cependant je les ai toujours trouvés trop encombrants visuellement. Ils possèdent un très faible angle de déviation de 13° et un grand rayon de courbure de 490mm. Ceci permet une prise en voie déviée très souple. Particularité de ces aiguillages, des lamelles de contact sont placés au fond des ornières de la pointe de cœur pour assurer la continuité électrique de l’alimentation des matériels moteur. Cette conception permet le franchissement des engins à faible empattement. Ce prolongement maximum des zones de contact sécurise les passages à faible vitesse pour les manœuvres sans risque d’arrêt (un des grands soucis du système 2 rails que Märklin, adepte du 3 rails pour sa fiabilité de l’alimentation électrique, veut à tout prix éviter).
 La page du catalogue 1972 propose une gamme d’éléments de voie déjà très complète avec 4 rayons de courbure, croisement, aiguillages manuels ou à commandes électromagnétiques,
élément dételeur et un premier élément de télécommande droit (plus tard suivront, TJD et aiguillages courbes)
La page du catalogue 1972 propose une gamme d’éléments de voie déjà très complète avec 4 rayons de courbure, croisement, aiguillages manuels ou à commandes électromagnétiques,
élément dételeur et un premier élément de télécommande droit (plus tard suivront, TJD et aiguillages courbes)
 Les moteurs d’aiguillage sont extra-plats, cependant peu discrets pour ce qui concerne la surface à mon goût. Le poste d’aiguillage de Göppingen n’apparaitra lui qu’en 1973, ainsi que le
premier set de 6 voitures, dont bien entendu, la fameuse coccinelle VW.
Les moteurs d’aiguillage sont extra-plats, cependant peu discrets pour ce qui concerne la surface à mon goût. Le poste d’aiguillage de Göppingen n’apparaitra lui qu’en 1973, ainsi que le
premier set de 6 voitures, dont bien entendu, la fameuse coccinelle VW.
 Les transformateurs et relais du Mini-Club fonctionnant sous 9v continu, le seul élément de la gamme H0 que Märklin peut réutiliser sont les pupitres de commande. Pour des questions
d’encombrement, j’ai préféré installer des poussoirs et commutateurs Brawa. Ainsi 6 aiguillages, 7 signaux, 4 éléments dételeur, l’ouverture des portes de la remise et l’éclairage des
bâtiments et des lampadaires sont commandés depuis un tableau de quelques centimètres carrés.
Les transformateurs et relais du Mini-Club fonctionnant sous 9v continu, le seul élément de la gamme H0 que Märklin peut réutiliser sont les pupitres de commande. Pour des questions
d’encombrement, j’ai préféré installer des poussoirs et commutateurs Brawa. Ainsi 6 aiguillages, 7 signaux, 4 éléments dételeur, l’ouverture des portes de la remise et l’éclairage des
bâtiments et des lampadaires sont commandés depuis un tableau de quelques centimètres carrés.
 Tout est offert par Märklin pour constituer, dès 1972, un premier réseau à la nouvelle échelle Z. Märklin inaugure son système de Toporama, des tapis à dérouler qui sont tout prêt à recevoir
voies et accessoires.
Tout est offert par Märklin pour constituer, dès 1972, un premier réseau à la nouvelle échelle Z. Märklin inaugure son système de Toporama, des tapis à dérouler qui sont tout prêt à recevoir
voies et accessoires.
L’effet bombe de l’échelle Z à la foire de Nuremberg 1972 est encore accentué par la présence d’un réseau complet proposé d’emblée au public médusé. Le fait de se retrouver en dehors de toute échelle normalisée imposait de créer d’un seul coup tout un système intégrant voie et éléments de décors. Les bâtiments de Märklin seront uniquement livrables en boite de construction. La première gamme comprend deux types de gares, Celle de Göppingen, de grande taille et de style résolument moderne et celle de Dünan, une petite halte bien plus modeste. Pour accompagner la grande gare, un quai vitré est livrable en deux parties. Hors bâtiment ferroviaire, l’on trouve deux constructions civiles. Il y a un imposant immeuble moderne à 4 étages et dont la partie supérieure peut aussi être utilisée séparément comme une petite villa moderne à toit plat. Le second bâtiment est une maison avec garage composé de deux appartements en copropriété. A noter que la création de l’échelle Z oblige la firme à investir le domaine des bâtiments en plastique à construire auquel il n’avait jamais touché, laissant pour le H0 les spécialistes tels que Faller, Kibri ou Vollmer s’en occuper. Dans les années 50 les derniers accessoires de Märklin étaient fabriqués en tôle imprimée. C’est donc une technique entièrement nouvelle pour le fabricant, et de plus, ce sont les premiers kits d’une si petite taille au 1/22ième. La grande firme de Göppingen s’en sort bien, avec quelques innovations à la clé. Les moulages en plusieurs teintes sont précis, des tenons facilitent le positionnement des murs. Les inserts des fenêtres sont regroupés en plaques de manière à limiter le nombre de pièces de toute petite taille. Tous les bâtiments sont prévus pour l’éclairage intérieur. On peut leur reprocher une certaine froideur, l’esprit est moderne et technocratique, on ne retrouve pas le charme et la poésie de certaines productions Faller ou Kibri. Mais Märklin s’en tire fort bien dans un domaine particulier où, jusque-là, il n’avait pas d’expérience, apportant des solutions nouvelles et des astuces d’assemblage. Cette toute première série de Bâtiment aura une vie relativement courte jusqu’en 1989. Elle sera succédée par des productions des spécialistes, Kibri dans un premier temps, puis Faller. Mais Märklin gardera une gamme de kit qui évoluera au fil de ses catalogues. Pour faciliter la tâche et inciter à se lancer dans la nouvelle échelle sans difficulté, Märklin va encore plus loin en proposant deux tapis de réseaux complet, inaugurant un principe qui se développera sous le nom de « Toporama ». L’un des destiné à un réseau de faible encombrement ; 1m x 35cm doté d’une voie unique avec des courbes de petit rayon 145mm. L’autre est à double voie, avec des rayons plus larges pour une dimension de 125cm x 48cm. Les tapis sont imprimés en couleur évoquant le ballast, l’herbe, les routes et chemins et les plans d’eau. Le grand réseau, désigné officiellement « Toporama » dispose de surface de près floquée d’herbe verte. Les tapis sont disponibles soit emballés dans des boites en étant roulés, soit montés sur une planche de bois équipés de la voie installée en usine. Pour ce dernier cas, le décor (bâtiments et arbres) livré sous forme de boite de construction. Il n’y a pas de matériel roulant. La durée de vie au catalogue de ces deux réseaux a été très courte, en 1974, ils disparaissent au profit d’un nouveau type de Toporama équipé d’aiguillages courbes, de traversé jonction double et pouvant recevoir la nouvelle caténaire sortie cette année-là. Les deux réseaux tout montés on eux existé au catalogue qu’une seule année en 1972. Sans doute était-il trop cher pour un achat direct par les amateurs. Peut-être étaient-ils simplement destinés aux détaillants comme réseau de vitrine ou de démonstration. Que ceux qui en possède un monté en usine me le signale pour compléter cette rubrique. Le catalogue 1972 ne précise pas s’ils étaient dots d’aiguillage manuels ou à commande électromagnétique.
 Deux gares, un quai, une grande maison de copropriété avec garage et un immeuble constituent la toute première gamme de bâtiment en Z. Pour Märklin, le kit plastique à monter est un
domaine entièrement nouveau qu’il n’avait jamais pratiqué, et de plus, ce sont les premiers d’une si petite taille au 1/220ième.
Deux gares, un quai, une grande maison de copropriété avec garage et un immeuble constituent la toute première gamme de bâtiment en Z. Pour Märklin, le kit plastique à monter est un
domaine entièrement nouveau qu’il n’avait jamais pratiqué, et de plus, ce sont les premiers d’une si petite taille au 1/220ième.
 La page des accessoires du petit catalogue Z de 1972 avec les deux types de réseaux qui peuvent être livrés, assemblés avec la voie fixée sur une planche. Sous cette forme de réseau
« usine », la diffusion semble extrêmement limitée et uniquement sur l’année 1972. A noter le signal deux feux qui utilise la technique des conduits de lumière avec des ampoules logées
dans le socle.
La page des accessoires du petit catalogue Z de 1972 avec les deux types de réseaux qui peuvent être livrés, assemblés avec la voie fixée sur une planche. Sous cette forme de réseau
« usine », la diffusion semble extrêmement limitée et uniquement sur l’année 1972. A noter le signal deux feux qui utilise la technique des conduits de lumière avec des ampoules logées
dans le socle.
 Le grand réseau désigné « Toporama » à double voie mesurant 125cm x 48cm. Il dispose d’une herbe verte floquée. Il utilise l’ensemble des bâtiments disponibles en 1972. Notez la présence
du pupitre de commande, seul accessoire issu de la gamme H0 pouvant être utilisé pour le Z, et qui parait énorme sur le plateau. Au fond, la boite d’origine « façon teck » dans laquelle est
roulé le toporama.
Le grand réseau désigné « Toporama » à double voie mesurant 125cm x 48cm. Il dispose d’une herbe verte floquée. Il utilise l’ensemble des bâtiments disponibles en 1972. Notez la présence
du pupitre de commande, seul accessoire issu de la gamme H0 pouvant être utilisé pour le Z, et qui parait énorme sur le plateau. Au fond, la boite d’origine « façon teck » dans laquelle est
roulé le toporama.
 Le petit réseau est encore plus compact avec ses dimensions de 1m x 35cm. Un record de largeur minimum en utilisant le petit rayon. Il offre cependant de nombreuses possibilités de
manœuvre. Je l’ai équipé ici du poste d’aiguillage de Göppingen et de la remise moderne à double voies, des accessoires qui ne sortiront qu’en 1974.
Le petit réseau est encore plus compact avec ses dimensions de 1m x 35cm. Un record de largeur minimum en utilisant le petit rayon. Il offre cependant de nombreuses possibilités de
manœuvre. Je l’ai équipé ici du poste d’aiguillage de Göppingen et de la remise moderne à double voies, des accessoires qui ne sortiront qu’en 1974.
 L’immeuble moderne dont la partie supérieure peut aussi être utilisée séparément comme villa à toit plat. Le Toporama dispose d’herbe floquée. Routes et plans d’eau sont reproduits. La voie
peut être directement posée sur une surface imitant le ballast. L’avantage est que ce montage est d’une très grande propreté garantissant un bon fonctionnement (sans grain de sable) de
ces minuscules mécaniques.
L’immeuble moderne dont la partie supérieure peut aussi être utilisée séparément comme villa à toit plat. Le Toporama dispose d’herbe floquée. Routes et plans d’eau sont reproduits. La voie
peut être directement posée sur une surface imitant le ballast. L’avantage est que ce montage est d’une très grande propreté garantissant un bon fonctionnement (sans grain de sable) de
ces minuscules mécaniques.
 Plus tard, j’ai utilisé le petit diorama comme base pour un réseau de type américain. Il est entièrement équipé d’accessoires électromagnétiques et permet d’incroyables possibilités de
manœuvre sur 0,35m2
Plus tard, j’ai utilisé le petit diorama comme base pour un réseau de type américain. Il est entièrement équipé d’accessoires électromagnétiques et permet d’incroyables possibilités de
manœuvre sur 0,35m2
 Vu d’ensemble de mon micro-réseau ludique. Avec sur la gauche son tableau de commande des 12 accessoires à commande électromagnétique et des 9 signaux agissant sur des secteurs
isolés. Le câblage sous le réseau est extrêmement dense.
Vu d’ensemble de mon micro-réseau ludique. Avec sur la gauche son tableau de commande des 12 accessoires à commande électromagnétique et des 9 signaux agissant sur des secteurs
isolés. Le câblage sous le réseau est extrêmement dense.
Pour le Mini-Club, Märklin développe des micromoteurs à courant continu 9 volts, dotés d’aimants permanents et d’induits 3 pôles, mesurant 12mm x 9,1mm. Pour chaque type de locomotive , tous les essieux moteurs sont entrainés par cascade d’engrenages. Les roues sont constituées d’une âme en plastique rouge isolante qui reproduit les rayons. Les embiellages des machines à vapeur sont très simplifiés, échelle oblige.

 Deux mécaniques assez différentes des débuts du Mini-Club ; La BB à bogie diesel série 216 à droite qui utilise des techniques d’entrainement assez similaires aux modèles à l’échelle N et la
minuscule 030T série 89. Les deux ont toutes les roues motrices, mais sans bandage d’adhérence pour favoriser la prise de courant par rapport à la force de traction.
Deux mécaniques assez différentes des débuts du Mini-Club ; La BB à bogie diesel série 216 à droite qui utilise des techniques d’entrainement assez similaires aux modèles à l’échelle N et la
minuscule 030T série 89. Les deux ont toutes les roues motrices, mais sans bandage d’adhérence pour favoriser la prise de courant par rapport à la force de traction.
 La mécanique du modèle le plus sophistiqué de la gamme de 1972. Châssis et caisse sont en zamac. Seuls les pare-fumée sont en tôle rapportée. Le modèle est équipé de 3 feux avant
fonctionnels.
La mécanique du modèle le plus sophistiqué de la gamme de 1972. Châssis et caisse sont en zamac. Seuls les pare-fumée sont en tôle rapportée. Le modèle est équipé de 3 feux avant
fonctionnels.
 Les porte-charbons sont directement en contact avec les lamelles de cuivre qui captent le courant. L’antiparasitage est assuré par des pastilles condensateur
pincés entre les porte-charbons. Tous les essieux sont moteurs. Depuis en Z, on n’a pas fait de mécanique plus petite que ces deux machines.
Les porte-charbons sont directement en contact avec les lamelles de cuivre qui captent le courant. L’antiparasitage est assuré par des pastilles condensateur
pincés entre les porte-charbons. Tous les essieux sont moteurs. Depuis en Z, on n’a pas fait de mécanique plus petite que ces deux machines.
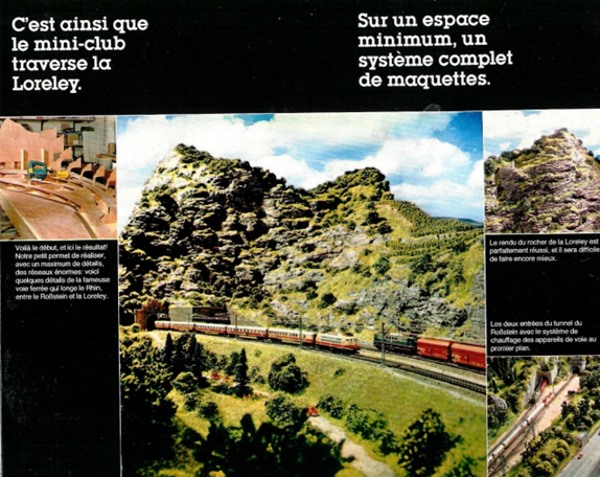 La petitesse de l’échelle permet de reproduire des sections de lignes comme celles évoquées par Bernhard Stein. Ici la ligne le long du Rhin entre Loreley et Rosstein exposée lors de la
foire de Nuremberg 1982.
La petitesse de l’échelle permet de reproduire des sections de lignes comme celles évoquées par Bernhard Stein. Ici la ligne le long du Rhin entre Loreley et Rosstein exposée lors de la
foire de Nuremberg 1982.
 Le goût de l’exploit me poussera à construire mon réseau Z de style français entre 1981 et 1984 avec bâtiment, signalisation et matériel conforme. Je me suis amusé à déporter les moteurs
d’aiguillage sous la surface. La fibre optique est utilisée pour les signaux. Beaucoup d’effort pour obtenir un niveau de réalisme équivalent au H0.
Le goût de l’exploit me poussera à construire mon réseau Z de style français entre 1981 et 1984 avec bâtiment, signalisation et matériel conforme. Je me suis amusé à déporter les moteurs
d’aiguillage sous la surface. La fibre optique est utilisée pour les signaux. Beaucoup d’effort pour obtenir un niveau de réalisme équivalent au H0.
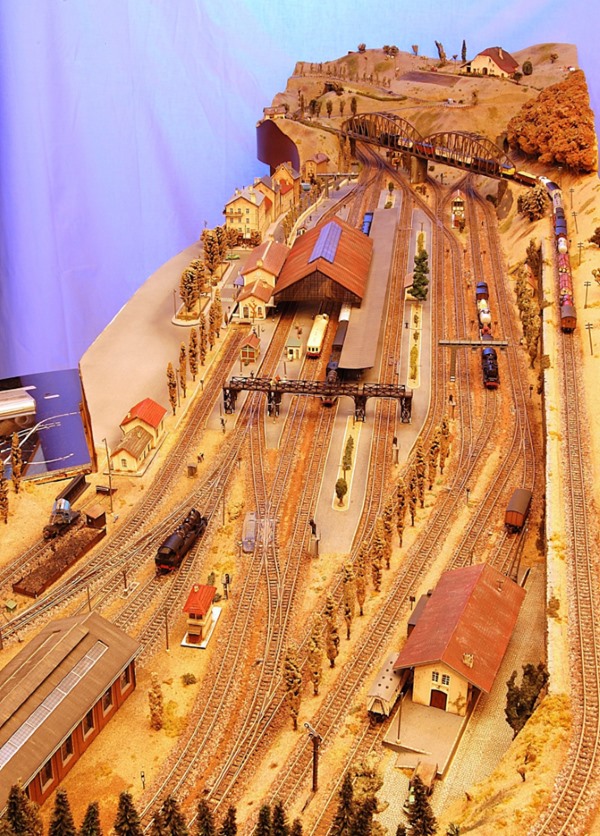 Des faisceaux de voie sont possibles sur un petit espace. Comme c’est mon tout premier réseau sérieux, j’ai commis quelques maladresses sur le tracé trop rigide de la voie haute. Notez
en gare l’autorail Picasso construit sur un châssis Märklin.
Des faisceaux de voie sont possibles sur un petit espace. Comme c’est mon tout premier réseau sérieux, j’ai commis quelques maladresses sur le tracé trop rigide de la voie haute. Notez
en gare l’autorail Picasso construit sur un châssis Märklin.

 Utiliser les locomotives Märklin « francisable » et à construire des wagons marchandise de toute pièce.
Utiliser les locomotives Märklin « francisable » et à construire des wagons marchandise de toute pièce.

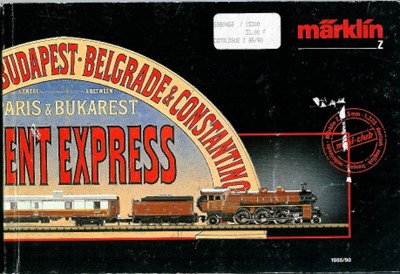
 Et évidement j’en fait l’acquisition dans ses deux versions avec ses wagons complémentaires.
Et évidement j’en fait l’acquisition dans ses deux versions avec ses wagons complémentaires.
 Même si la Pacific Bavaroise déguisée en décoration de la compagnie du Nord n’est pas conforme, quel plaisir de voir des voitures CIWL en Z.
Même si la Pacific Bavaroise déguisée en décoration de la compagnie du Nord n’est pas conforme, quel plaisir de voir des voitures CIWL en Z.
Ce sont les chemins de fer Royaux Bavarois qui sont à l’origine de cette série de machines confrontée à l’augmentation du poids des convois. Les Königliche Bayerische Staatsbahn, K.Bay.sts.B., passent commande d'une locomotive rapide et puissante dont les premiers exemplaires sont livrés par la firme Maffei de Munich en Juillet 1908. La nouvelle locomotive du type S 3/6 offre des caractéristiques modernes pour l'époque, la surchauffe, une forme aérodynamique et surtout un mécanisme moteur à quatre cylindres fonctionnant sur le principe de la double expansion. Entre 1908 et 1918, la Bavière reçoit 89 machines S 3/6 livrées en lots successifs. Certaines machines sont destinées au réseau du Palatinat sous administration bavaroise, d'autres sont cédées à la France et à la Belgique au titre des réparations de guerre. A la fondation de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, en 1925, la série S 3/6 devient la série 18.4. Malgré l'apparition des machines plus récentes de la série 01, locomotives "unifiées" standardisées pour toute l'Allemagne en 1925, la Reichsbahn repasse commande de locomotives S 3/6 au constructeur Maffei, en raison du manque de machines au poids par essieu limité à 16 t. Au total, 159 machines sont construites en 15 lots successifs de 1908 à 1930. Ses performances leur valent d'être engagées hors de Bavière à la traction du très prestigieux train de luxe "Rheingold" entre Hoek van Holland et Bâle, lancé en 1928, et de l'Orient-Express sur son parcours allemand. Après 1945, la majorité des machines se retrouvent dans la zone occidentale qui deviendra la RFA, 21 des machines, en mauvais état après la guerre, sont réformées par la nouvelle Deutsche Bundesbahn, administration ferroviaire créée en Allemagne de l'Ouest, trente autres, issues des lots de 1926-1930 sont modernisées entre 1953 et 1957, recevant une chaudière neuve et diverses modifications, Dans les années soixante, sous les coups conjugués de l'électrification et de la livraison des locomotives Diesel de moyenne puissance V200, l'effectif des S 3/6 diminue rapidement et se regroupe dans le Sud de l'Allemagne, le dernier exemplaire quitte le service commercial en 1969. Un modèle célèbre avec une longue carrière qui métitait bien une belle reproduction par Märklin en H0. Ce sera chose faite en 1972 ;
 Esthétiquement, la Pacific Bavaroise séduit par sa ligne, ses grandes roues dégagées, sa cabine en coupe-vent, sa boite à fumée ovoïde.
Esthétiquement, la Pacific Bavaroise séduit par sa ligne, ses grandes roues dégagées, sa cabine en coupe-vent, sa boite à fumée ovoïde.
Classiquement, la première version du modèle de BR 18 de Märklin est réalisé en zamac, châssis et carrosserie. On reste dans la tradition. Mais des innovations existent. Du fait de la transmission unique sur le dernier essieu moteur déjà adopté depuis 1970 sur la Pacific 03 carénée, le vide entre châssis et chaudière est pour la première fois reproduit.
 Une première chez Märklin, le dessous de la chaudière est dégagé, ce qui est permis par l’entrainement par engrenage droit uniquement sur l’essieu arrière, les autres l’étant via les bielles.
Le catalogue 1972 met en valeur la nouveauté et cette particularité.
Une première chez Märklin, le dessous de la chaudière est dégagé, ce qui est permis par l’entrainement par engrenage droit uniquement sur l’essieu arrière, les autres l’étant via les bielles.
Le catalogue 1972 met en valeur la nouveauté et cette particularité.
 La Pacific Bavaroise est une machine fine à belle allure avec sa cabine coupe vent.
La Pacific Bavaroise est une machine fine à belle allure avec sa cabine coupe vent.
La famille des Pacific Bavaroise S 3/6 à l'échelle H0 ne va pas arrêter de s'agrandir. En 1974, c'est une version verte des chemins de fer royaux Bavarois qui est proposée. Une livrée vert foncé avec cerclage de chaudière et liserés jaune. En 1977 c'est une version française de couleur vert foncé des chemins de fer de l'état qui apparait avec des pare-fumées spécifiques. Cinq années plus tard, c'est une version Belge en livrée brune qui est proposée. Avec l'apparition de la rame Rheingold en tôle en 1988, Märklin améliore sa Bavaroise et en propose une version de la Deutsche Reichsbahn. Elle est dotée d'un moteur haute performance, de roues et d'un embiellage affiné. Les sabots de frein entre les roues motrices sont maintenant reproduits et signe distinctif pour la traction du Rheingold, une banderole blanche et rouge est enroulée autour de la cheminée dont le cerclage supérieur est de teinte laiton. Enfin en 1993, ce sera une version immatriculée à la SNCF 231 A 995 qui est proposée. Il y aura ensuite bien d'autres versions, de plus en plus détaillées, mais ceci est une autre histoire.
 L'apparition de la rame Rheingold en tôle commercialisée en 1988 fait de la Bavaroise la locomotive idéale pour sa traction.
L'apparition de la rame Rheingold en tôle commercialisée en 1988 fait de la Bavaroise la locomotive idéale pour sa traction.
 En 1982, Märklin propose une belle version Belge en livrée brune et noir.
En 1982, Märklin propose une belle version Belge en livrée brune et noir.
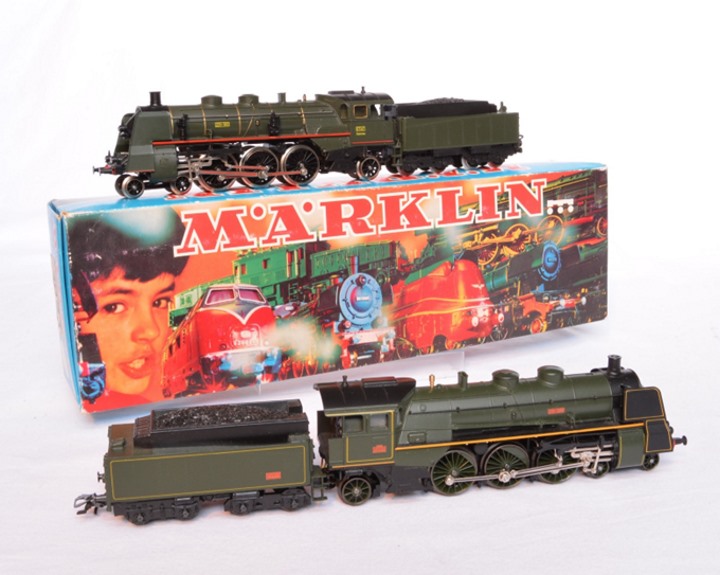 Les deux versions Française du réseau de l’Etat. Au titre des dommages de guerre, 16 exemplaires sont cédés à la France en 1919. Märklin en sortira deux versions en 1977 (modèle du haut)
et en 1991 immatriculé à la SNCF cette fois (En bas).
Les deux versions Française du réseau de l’Etat. Au titre des dommages de guerre, 16 exemplaires sont cédés à la France en 1919. Märklin en sortira deux versions en 1977 (modèle du haut)
et en 1991 immatriculé à la SNCF cette fois (En bas).
 La version Etat en instance de départ vers le nouveau monde.
La version Etat en instance de départ vers le nouveau monde.
 La rame transatlantique en route pour Le Havre vers le paquebot Normandie et le départ pour l’Amérique.
La rame transatlantique en route pour Le Havre vers le paquebot Normandie et le départ pour l’Amérique.
La reproduction en tôle imprimée de la série des voitures modernes de la DB débute en 1958 en longueur standard de 24cm, pour se terminer en 2005 avec de nombreux modèles et de nombreuses variantes. En 1972 les wagons de 1ière et seconde classe sont remplacés par de nouvelles références équipées d’aménagements intérieurs. Les inscriptions changent également pour adopter la numérotation UIC. La voiture bleue de 1ière classe est dotée d’un liséré jaune comme c’est la norme dans les années 60-70. Le wagon restaurant rouge de la DSG qui n’était en fait que la reproduction d’un exemplaire unique conçu pour l’United States Army Transportation Corps (USTC). Le modèle réel n’a en fait jamais été commandé pour la DSG. En 1972 c’est l’occasion de coller à la réalité en incorporant un modèle de type WE üm en décoration POP bordeaux et beige. Autre nouveauté la voiture grise italienne des FS en version 1 ière classe. L’existence très brève de 1972 à 1976 en fera un modèle recherché des collectionneurs.

 Les nouvelles voitures voyageurs du catalogue 1972. La série en tôle de 24cm est complétée alors que la révolution apparait avec les nouvelles voitures POP de 27cm à caisse plastique.
Les nouvelles voitures voyageurs du catalogue 1972. La série en tôle de 24cm est complétée alors que la révolution apparait avec les nouvelles voitures POP de 27cm à caisse plastique.
 La voiture grise italienne des FS en version 1ière classe aura une existence très brève de 1972 à 1976 ce qui en fera un modèle très recherché des collectionneurs.
La voiture grise italienne des FS en version 1ière classe aura une existence très brève de 1972 à 1976 ce qui en fera un modèle très recherché des collectionneurs.
 Renouvellement de la gamme des voitures modernes de la DB qui sont maintenant toutes (sauf le fourgon) équipées d’aménagement intérieur d’origine. La voiture restaurant change de
modèle et adopte la nouvelle livrée POP.
Renouvellement de la gamme des voitures modernes de la DB qui sont maintenant toutes (sauf le fourgon) équipées d’aménagement intérieur d’origine. La voiture restaurant change de
modèle et adopte la nouvelle livrée POP.
 En 2010 Märklin complète la collection des voitures vintage en tôle par une version seconde place de la voiture grise des FS. En bas, comparaison des versions 1ière classe réf 4027 de 1964
(en haut) et la nouvelle version réf 4051 de 1972 dotée d’aménagement intérieur, d’inscription UIC et du liseré jaune de première classe.
En 2010 Märklin complète la collection des voitures vintage en tôle par une version seconde place de la voiture grise des FS. En bas, comparaison des versions 1ière classe réf 4027 de 1964
(en haut) et la nouvelle version réf 4051 de 1972 dotée d’aménagement intérieur, d’inscription UIC et du liseré jaune de première classe.
 Une innovation qui fera du chemin, l’adoption pour la toute première fois en 1972 des LED pour les feux de fin de convois avec la voiture 1ière classe réf 4053. Une platine regroupe
les résistances et fait office de support. Pour l’aménagement intérieur des voitures de 1ière classe, la cloison de couloir transparente est constituée d’un rhodoïd imprimé.
Une innovation qui fera du chemin, l’adoption pour la toute première fois en 1972 des LED pour les feux de fin de convois avec la voiture 1ière classe réf 4053. Une platine regroupe
les résistances et fait office de support. Pour l’aménagement intérieur des voitures de 1ière classe, la cloison de couloir transparente est constituée d’un rhodoïd imprimé.
 Fin de carrière pour le wagon restaurant rouge datant de 1958 (en haut à gauche) qui était en réalité un prototype unique construit pour l’United States Army Transportation Corps (USTC) et
jamais commandé en série. Pour la restauration de sa population au 1/87ième Märklin adopte en 1972 le type WE üm en décoration POP bordeaux et beige. Il existait déjà en décoration
TEE au premier plan et sera ensuite décliné dans sa version d’origine rouge lit de vin bien plus tard en 1987 dans la série « Hobby ». Ce sera aussi le moyen de restauration pour les
nouvelles voitures de la série 27cm dont on peut comparer la longueur avec les voitures en tôle imprimée à droite.
Fin de carrière pour le wagon restaurant rouge datant de 1958 (en haut à gauche) qui était en réalité un prototype unique construit pour l’United States Army Transportation Corps (USTC) et
jamais commandé en série. Pour la restauration de sa population au 1/87ième Märklin adopte en 1972 le type WE üm en décoration POP bordeaux et beige. Il existait déjà en décoration
TEE au premier plan et sera ensuite décliné dans sa version d’origine rouge lit de vin bien plus tard en 1987 dans la série « Hobby ». Ce sera aussi le moyen de restauration pour les
nouvelles voitures de la série 27cm dont on peut comparer la longueur avec les voitures en tôle imprimée à droite.
Märklin est resté longtemps fidèle à la technique classique et éprouvée de la tôle imprimée pour réaliser ses voitures. Bien que la concurrence directe que sont les constructeurs Fleischmann et TRIX l’ai adopté depuis le milieu des années 60, la firme a longtemps tardé à appliquer la technique classique d’une voiture entièrement en matière plastique moulée, technique universelle de nos jours. Cette petite révolution à Göppingen s’opère en 1972 avec la série des voitures POP de la DB (bien qu’il y ai eu deux précédents avec la voiture inox de la SNCF et les voitures suédoises qui nécessitaient la reproduction des nervures en relief). Un autre pas est franchi en ce qui concerne la longueur puisque l’on passe de 24cm à 27cm. Converti à l’échelle H0, cette série dee voitures aurait mesuré 30,4cm. Or la clientèle de l’époque reste des « modélistes ludiques » qui pour la plupart n’auraient pas pu accepter sur leurs réseaux à faible rayon de courbure de telles voitures. Un compromis est donc trouvé avec la réalité avec cette longueur de 27cm. Plus tard Märklin poussera le bouchon de la réalité encore plus loin avec des voitures de 28 cm ne pouvant circuler que sur les rayons de 36cm.
 Superbe livrée orange de la voiture de première classe de la nouvelle série de 27cm tel que l’amateur peut la découvrir en 1972. Elle est livrée emballée dans son papier soie de protection
avec une série de décalcomanies pour les plaques d’itinéraire.
Superbe livrée orange de la voiture de première classe de la nouvelle série de 27cm tel que l’amateur peut la découvrir en 1972. Elle est livrée emballée dans son papier soie de protection
avec une série de décalcomanies pour les plaques d’itinéraire.
 La rame complète des voitures de la série plastique de 27cm avec leur première livrée POP. Pour la première fois sur le fourgon, Märklin rend les persiennes de chargement fonctionnelles
avec un système qui permet leur coulissement. En cela la firme rejoint son concurrent Fleischmann qui dotait ses fourgons de ce gadget depuis 196x.
La rame complète des voitures de la série plastique de 27cm avec leur première livrée POP. Pour la première fois sur le fourgon, Märklin rend les persiennes de chargement fonctionnelles
avec un système qui permet leur coulissement. En cela la firme rejoint son concurrent Fleischmann qui dotait ses fourgons de ce gadget depuis 196x.
 Pour la première fois sur le fourgon, Märklin rend les persiennes de chargement fonctionnelles avec un système qui
permet leur coulissement. En cela la firme rejoint son concurrent Fleischmann qui dotait ses fourgons de ce gadget depuis 1962. Märklin rattrape aussi son
retard sur Fleischmann avec des caisses de voiture voyageur en plastique moulé.
Pour la première fois sur le fourgon, Märklin rend les persiennes de chargement fonctionnelles avec un système qui
permet leur coulissement. En cela la firme rejoint son concurrent Fleischmann qui dotait ses fourgons de ce gadget depuis 1962. Märklin rattrape aussi son
retard sur Fleischmann avec des caisses de voiture voyageur en plastique moulé.
La toute première série de voitures pop de 27cm aura une existence relativement courte jusqu'en 1974. A cette date elles changeront de livrée pour adopter la livrée unifiée de la DB bleu et beige. Si au départ elles sont dotées d'un châssis métallique et de bogies à armature en tôle, en 1974, ce sera une fabrication intégralement en plastique avec des bogies Minden Deutz. Les essieux sont pour la première fois à pivots avec des axes à pointes. Ceci obligera Märklin à offrir une nouvelle version de l'éclairage intérieur pour ces nouvelles fabrications postérieures à 1974 (dont le châssis est marqué d'une lettre A). En plus du ski qui capte le courant sur les plots centraux, le bogie doit être équipé de frotteurs de masse en cuivre découpé captant le courant sur les axes des essieux. La répartition de la lumière avec ce type d'éclairage est excellente, d'un bout à l'autre de la voiture et de ses 27cm.
 Belle élégance aussi pour la voiture de seconde classe avec son bandeau bleu nuit.
Belle élégance aussi pour la voiture de seconde classe avec son bandeau bleu nuit.
C’est bien connu, Märklin ne mégote pas sur la qualité des locomotives qu’il met dans ses coffrets de départ. Il ne s’agit pas de décourager l’enfant qui découvre les joies du train miniature. Une mécanique simple pour être bon marché ne veut pas dire une mécanique médiocre. Pour remplacer sa petite 030T réf 3029 datant de 1960, un autre modèle représentatif des réseaux locaux est proposé en 1972. Deux versions sont proposées, une sobre robe noire ou une belle version bicolore verte et noire . Le châssis est en zamac selon la technologie habituelle, mais encore plus long et plus massif que le précédent modèle. Plus de poids = meilleur fonctionnement. C’est une réalisation simple et compacte. Seul l’essieu arrière est entrainé. Il est muni de bandages d’adhérence. Les deux autres essieux sont libre. Il n’y a qu’une seule bielle motrice. La caisse est en plastque moulé avec une allure caractéristique avec sa haute cheminée munie de pare-escarbille. Des inscriptions et sur la version verte et noire, des filets sont finement déposés. Pas d’éclairage pour ces modèles qui doivent rester économique afin d’appeler les vocations.

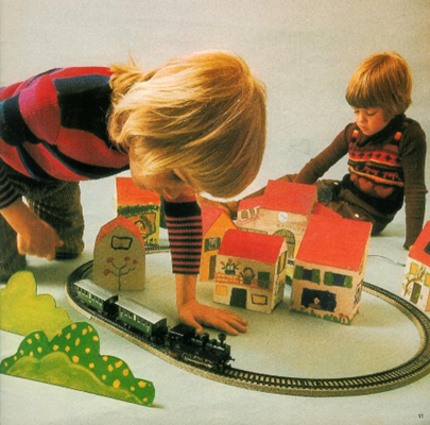 Simplicité et prix d’appel pour cette petite 030T qui a pour vocation de garnir les coffrets de départ les moins chers, mais aussi de bien fonctionner et de résister aux jeux, comme le montre les
illustrations du catalogue 1972.
Simplicité et prix d’appel pour cette petite 030T qui a pour vocation de garnir les coffrets de départ les moins chers, mais aussi de bien fonctionner et de résister aux jeux, comme le montre les
illustrations du catalogue 1972.
 Deux générations de locomotives simples destinées aux coffrets les plus économiques. La réf 3029 de 1960 et la réf 3087 de 1972. Une même philosophie.
Deux générations de locomotives simples destinées aux coffrets les plus économiques. La réf 3029 de 1960 et la réf 3087 de 1972. Une même philosophie.
 Quelle fierté de recevoir un coffret de train Märklin.
Quelle fierté de recevoir un coffret de train Märklin.
Märklin n’oublie pas de compléter sa série des wagons de marchandise. Cependant avec l’éffort nécessaire pour la création de la gamme à l’échelle Z, il reste peu de place pour investir dans ce domaine. Comme wagon citerne à bogies apparait une noouvelle décoration Esso qui remplace la version Avia sur une même citerne blanche. Cette dernière n’aura vécu que deux petites années au catalogue. Nouvelles décorations aussi pour le wagon à bière, le porte conteneur et le petit Caboose US à deux essieux.

 Peu de nouveautés au rayon des wagons marchandise du catalogue 1972, uniquement des nouvelles décorations.
Peu de nouveautés au rayon des wagons marchandise du catalogue 1972, uniquement des nouvelles décorations.
 Belle décoration du couvert à bière aux couleurs du Würburger Hofbrän avec un toit bleu et des étoiles en décalcomanie. Mais il y a toujours cette fâcheuse tendance du toit à se déformer
comme sur le premier modèle de 1963.
Belle décoration du couvert à bière aux couleurs du Würburger Hofbrän avec un toit bleu et des étoiles en décalcomanie. Mais il y a toujours cette fâcheuse tendance du toit à se déformer
comme sur le premier modèle de 1963.
 Curieux modèle de Coboose américain qui apparait en de nombreuses variantes à partir de 1971, alors que la gamme US est par ailleurs laissée à l’abandon.
Curieux modèle de Coboose américain qui apparait en de nombreuses variantes à partir de 1971, alors que la gamme US est par ailleurs laissée à l’abandon.
 Entre 1969 et 1970, Märklin change la couleur de ses emballages en passant du bleu ciel au bleu plus fonçé. C’est vrai à l’échelle H0 et à l’échelle I.
Entre 1969 et 1970, Märklin change la couleur de ses emballages en passant du bleu ciel au bleu plus fonçé. C’est vrai à l’échelle H0 et à l’échelle I.
 Le bleu foncé est la troisième couleur adoptée par Märklin pour les boites de ses wagons de marchandise.
Le bleu foncé est la troisième couleur adoptée par Märklin pour les boites de ses wagons de marchandise.
 A partir de 1970, nouveau look pour les boites de matériel roulant, toujous sur la base du bleu foncé.
A partir de 1970, nouveau look pour les boites de matériel roulant, toujous sur la base du bleu foncé.
 Pour le matériel roulant, des nouveaux emballages avec photo sont de mise. Pour le H0 ils sont standardisés par tailles. Pour le I ou le Minex ils sont spécifiques au type de matériel.
Le Z va se distinguer en 1972 avec ses fameux emballages façon bois de teck.
Pour le matériel roulant, des nouveaux emballages avec photo sont de mise. Pour le H0 ils sont standardisés par tailles. Pour le I ou le Minex ils sont spécifiques au type de matériel.
Le Z va se distinguer en 1972 avec ses fameux emballages façon bois de teck.
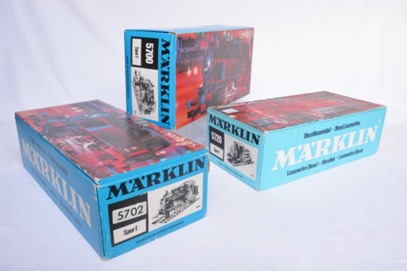
 A ses débuts en 1969, la F7 aux couleurs de l’Union Pacific utilise la boite illustrée de la version Santa Fé, puis, elle utilisera la boite standardisée.
A ses débuts en 1969, la F7 aux couleurs de l’Union Pacific utilise la boite illustrée de la version Santa Fé, puis, elle utilisera la boite standardisée.
 Pour le Z, pas de confusion possible avec les emballages façon teck. On reconnait les produits de 1972 de part l’utilisation de l’ancien sigle Märklin qui disparait à partir de 1973.
Pour le Z, pas de confusion possible avec les emballages façon teck. On reconnait les produits de 1972 de part l’utilisation de l’ancien sigle Märklin qui disparait à partir de 1973.